En vue des élections européennes, prévues en juin 2024, il semble intéressant de faire un focus sur les narrations identitaires qui ont façonné l’Europe d’hier et celles qui racontent l’Europe d’aujourd’hui.
C’est pourquoi cet article propose d’interroger les écritures et fictions créatrices à l’oeuvre, à travers les dynamiques culturelles et historiques dans lesquelles elles s’inscrivent.
Pour ce faire, opérons sans attendre un petit retour en arrière, afin de mieux appréhender les prémices de ces « communautés imaginées » et revenons un instant sur l’origine des « nations » – du latin natio, qui dérive du verbe nascere « naître ».
La formation des nations en Europe découle d’un processus complexe, influencé par plusieurs facteurs historiques, culturels, politiques et sociaux.
Les principales étapes de ce processus incluent la fin du féodalisme et la centralisation du pouvoir, qui ont favorisé l’unification territoriale et l’identité nationale autour d’un pouvoir central. La Renaissance et les Lumières, qui ont stimulé la réflexion sur l’identité et la souveraineté, promouvant des idées de souveraineté populaire et de droits civiques. Les guerres et les conflits, qui ont renforcé le sentiment d’unité nationale face à des ennemis communs, tandis que les mouvements nationalistes du XIXe siècle ont revendiqué l’indépendance ou l’unification de groupes partageant une identité commune. Enfin, les réformes linguistiques et politiques ont contribué à la création d’une culture et d’une identité nationales partagées.
À travers leurs théories, Thomas Hobbes, John Locke, et Jean-Jacques Rousseau ont jeté les bases de la souveraineté et du contrat social, fondamentaux dans l’émergence des États-nations. Leurs propositions respectives se rejoignent sur le fait que les sociétés naissent d’un accord entre les individus visant à établir une entité politique organisée. Pourtant, chacun d’eux propose une vision distincte de cet accord et de ses implications sur la relation entre les individus et l’autorité.
Dans le Léviathan (1651), Thomas Hobbes présente une vision pessimiste de l’état de nature, qu’il décrit comme une condition de guerre de tous contre tous – « bellum omnium contra omnes » -, où la vie est « solitaire, pauvre, méchante, brutale et courte ».
Pour échapper à cet état de nature, les individus consentent à un contrat social, dans lequel ils cèdent leurs droits illimités à un souverain absolu – métaphore du Léviathan, un monstre puissant et redouté, qui domine les créatures marines dans la mythologie -, qui garantit ordre, paix et sécurité.

Comment accorder la multitude et sortir de l’état de « guerre de tous contre tous » ? Par quels moyens des individus aux profils et aux désirs variés – pour ne pas dire rivaux – peuvent-ils vivre ensemble et vivre bien ? Au lendemain d’une guerre civile qui a déchiré l’Angleterre, le Léviathan (1651) offre une réponse novatrice et déroutante pour ses contemporains : il revient aux particuliers de conclure un pacte fondateur, qui confère au souverain l’autorité de les représenter absolument et de faire la loi en leur nom. Par la puissance et la cohérence de son raisonnement, le Léviathan a redéfini les droits et les devoirs des souverains et des citoyens. Revenir à lui aujourd’hui, c’est éclairer nos propres conditions de pensée et de pratique politique. Cette édition regroupe les chapitres X à XVI (De l’homme), consacrés à la problématique morale, ainsi que les chapitres XVII, XVIII et XXI (De la République), dédiés au pouvoir politique et à la liberté des sujets. Dossier : Petit précis de philosophie politique : Aristote, Locke, Rousseau, Hannah Arendt, Pierre Clastres, Pierre Manent. Source : librairie Gallimard.
Dans les Deux Traités du gouvernement civil (1689), John Locke, en contraste avec Hobbes, propose une vision plus optimiste : l’état de nature est un état de liberté et d’égalité, où les droits à la vie, à la liberté et à la propriété sont préexistants et doivent être préservés par le gouvernement. Le contrat social, selon lui, est un accord pour former un gouvernement qui protège ces droits.
Dans une Angleterre du XVIIe siècle, marquée par les conflits politiques et les remises en question de l’autorité monarchique, il argue donc que le gouvernement doit être fondé sur le consentement des gouvernés et protéger les droits naturels à la vie, à la liberté et à la propriété, avec la possibilité pour le peuple de le renverser si ces principes ne sont pas respectés, introduisant ainsi la notion de gouvernement avec le consentement des gouvernés et la séparation des pouvoirs.

« Locke explique que les hommes naissent et doivent rester foncièrement égaux et libres ; il attaque l’esclavage comme un état contre nature ; il enferme le pouvoir paternel dans les strictes limites imposées au père par le devoir qu’il a de faire de son fils un homme, et un homme libre ; il démontre l’erreur de ceux qui confondent avec le pouvoir paternel, qui dérive d’un devoir naturel, le pouvoir civil, qui dérive d’un contrat volontaire ; il oppose à la situation que leur minorité fait aux enfants vis-à-vis des parents, la situation que leur commune majorité fait aux gouvernés vis-à-vis des gouvernants ; il établit enfin que, puisque les citoyens doivent être traités par les dépositaires du pouvoir non comme des mineurs mais comme des égaux, l’absolutisme monarchique est essentiellement illégitime. » Source : éditions Flammarion.
Dans Du contrat social (1762), Jean-Jacques Rousseau explore les fondements de la légitimité politique et de l’organisation sociale idéale. Il y défend l’idée selon laquelle une société juste découle d’un contrat social basé sur le consentement mutuel des individus, les conduisant à s’unir sous une volonté générale qui exprime l’intérêt commun.
Pour lui, la souveraineté réside dans le peuple, et tout gouvernement doit refléter la volonté générale pour être légitime. Son contrat social idéal permet non seulement d’assurer la liberté et l’égalité des citoyens, mais sert également de fondement à l’ordre civil, en remplaçant l’état de nature par une société organisée, où les droits et devoirs sont équilibrés pour le bien commun.

Paru en 1762, le Contrat social, en affirmant le principe de souveraineté du peuple, a constitué un tournant décisif pour la modernité et s’est imposé comme un des textes majeurs de la philosophie politique. Il a aussi acquis le statut de monument, plus célèbre que connu, plus révéré – ou honni –qu’interrogé. Retrouver, dans les formules fameuses et les pages d’anthologie, le mouvement de la réflexion et les questions vives qui nourrissent une œuvre beaucoup plus problématique qu’affirmative, c’est découvrir une pensée qui se tient au plus près des préoccupations d’aujourd’hui : comment intégrer les intérêts de tous dans la détermination de l’intérêt commun ? Comment lutter contre la pente de tout gouvernement à déposséder les citoyens de la souveraineté ? Comment former en chacun ce sentiment d’obligation sans lequel le lien social se défait ? Source : éditions Flammarion.
Au XVIIIe et XIXe siècles, le mouvement romantique et l’émergence du nationalisme ont joué un rôle important dans la formation des nations.
Les idées de Johann Gottfried Herder (1744-1803), notamment, ont influencé la manière dont les peuples ont commencé à se percevoir comme des nations distinctes, unies par la langue, la culture et l’histoire commune.
Herder argue que chaque peuple – volk – possède un caractère unique – volksgeist – exprimé à travers sa langue et sa culture, forgeant une identité nationale distincte. Il valorise la diversité culturelle et linguistique, voyant dans chaque culture une expression irremplaçable de l’humanité.
Contrairement aux visions plus exclusives du nationalisme qui émergeraient plus tard, Herder croyait en une coexistence pacifique des nations, chacune contribuant à la richesse globale de la civilisation humaine.
Son travail a jeté les bases théoriques du nationalisme romantique en Europe, qui a influencé la montée des mouvements nationalistes et la formation des états-nations au XIXe siècle. Herder a mis en avant l’importance de préserver les langues et cultures locales face à l’homogénéisation, soulignant le rôle de la langue en tant que liant essentiel de la communauté nationale.
Ernest Renan, dans « Qu’est-ce qu’une nation ? » (1882), propose une définition de la nation qui se distingue par son approche volontariste et subjective. Selon lui, une nation n’est pas définie par des critères objectifs tels que la race, la langue, ou la religion, mais plutôt par le désir des peuples de vivre ensemble et par le partage d’une mémoire commune et d’un projet pour l’avenir.
Renan met en avant l’idée que les nations sont des entités dynamiques, dont les frontières et les compositions peuvent changer au fil du temps, reflétant la fluidité et la complexité des identités collectives. Sa vision a marqué une rupture importante avec les définitions plus essentialistes de la nation, ouvrant la voie à des interprétations plus inclusives et flexibles de l’identité nationale.

« Qu’est-ce qu’une nation ? » Dans cette conférence, prononcée à la Sorbonne, le 11 mars 1882, Ernest Renan prend parti dans le débat académique sur la nation. Il s’exprime dans un climat plus serein que celui qui avait conduit Fustel de Coulanges à prendre la plume en octobre 1870, mais le conflit franco-allemand ne saurait être oublié. Renan exprime ici de manière particulièrement claire, dans un texte devenu classique, la conception française de la nation, volontariste, avec la fameuse formule : « un plébiscite de tous les jours ». Et il rejette avec vigueur les arguments, raciaux notamment, favorables à la conception objectiviste allemande. Source : Digithèque MJP.
Benedict Anderson, dans L’imaginaire national (1983), avance que les nations sont des communautés imaginées, formées par les personnes qui se perçoivent dans une même communauté malgré l’absence de rencontre directe. Ce sentiment d’appartenance est encouragé par le déclin du latin au profit des langues vernaculaires, l’invention de l’imprimerie qui a diffusé ces langues et cultures, le capitalisme d’imprimerie favorisant la standardisation linguistique, et les mouvements d’indépendance. Anderson souligne le rôle crucial des médias et de la littérature dans la création de cette communauté imaginée, permettant aux individus de se sentir liés par une histoire, une langue, et des symboles communs.

Qu’est-ce qu’une nation, et qu’est-ce que le sentiment national qui fait que des individus s’identifient corps et âme à d’autres individus qu’ils ne connaissent pas et ne connaîtront jamais ? Dans cet ouvrage désormais classique, Benedict Anderson montre que l’adhésion à l’idée de souveraineté nationale n’a rien de naturel. Il analyse ainsi les facteurs historiques dont la conjonction – comme celle de l’émergence du capitalisme marchand et de l’invention de l’imprimerie – a permis la naissance de ces singulières » communautés imaginées » que sont les nations.
Convoquant une riche gamme d’exemples, du Brésil à la Thaïlande en passant par l’Europe centrale et l’Amérique latine, l’auteur étudie l’interaction complexe entre la logique populiste et démocratique du nationalisme et les stratégies des régimes impériaux et dynastiques à la fin du XIXe siècle. Écrit dans un style élégant teinté d’une ironie typiquement britannique, l’ouvrage d’Anderson – traduit dans toutes les grandes langues européennes – offre à la fois le plaisir d’un certain raffinement intellectuel et l’utilité d’une introduction originale à un thème trop souvent traité de façon superficielle. Source : Éditions de la Découverte.
Dans Nations et nationalisme (1989), le sociologue anglais Ernest Gellner avance que la nation est un mythe, un produit historique de la société industrielle. Un mythe cependant efficace, vecteur d’intégration et de cohésion, qui rend possible le développement économique qui, à son tour permet une plus grande mobilité et une plus grande polyvalence des individus. L’homogénéisation culturelle qui en résulte renforce alors la conscience nationale, sans que les tensions ethniques ne disparaissent pour autant. La mobilité de la population pouvant susciter des réactions de défense des cultures préexistantes : c’est alors l’apparition du nationalisme, principe exigeant que « l’unité politique et l’unité nationale se recouvrent ».

Le nationalisme n’est pas un effet de l’existence des nations mais ce sont les nations qui sont le produit du nationalisme. Affirmation paradoxale aux yeux de l’homme moderne, l’homme de la société industrielle pour qui la coïncidence entre souveraineté politique et communauté de culture semble aller de soi et qui se représente souvent les nations comme des entités transhistoriques. Mais l’État-nation est né de conditions particulières : l’organisation du travail industriel exige la possession d’une même langue et l’alphabétisation généralisée. Ainsi les sociétés modernes ne peuvent fonctionner sans un système scolaire diffusant une culture homogène, normalisée, et contrôlée par un État qui s’identifie avec cette culture. Le nationalisme – le principe un État, une culture – ne s’explique ni par l’idéologie ni par la psychologie, et il ne renvoie pas à quelque archaïsme de l’âme des peuples ou des individus. la démonstration d’Ernest Gellner s’appuie sur une vision comparatiste (nourrie notamment de sa connaissance du monde arabo-musulman et des sociétés de l’Europe de l’est) et sur une mise en perspective des grandes étapes du développement historique. Il apporte ainsi une compréhension neuve d’un des plus puissants phénomènes sociaux contemporains. Source : Librairie L’Alinéa.
Dans La Création des identités nationales : Europe XVIIIe-XXe siècle (1999), Anne-Marie Thiesse reprend une « check-list » identitaire, ciblant une série d’éléments qui ont été systématiquement développés ou inventés pour construire les identités nationales en Europe entre le XVIIIe et le XXe siècle.
Une langue nationale standardisée
La standardisation et la promotion de langues nationales uniques à partir de dialectes divers ont facilité la communication, l’administration et ont renforcé l’unité interne. La création d’une langue commune, standardisée et promue à travers l’éducation et les institutions, est cruciale pour unifier la population et différencier la nation des autres groupes.
Une histoire nationale officielle
Des récits historiques spécifiques ont été élaborés pour souligner un passé commun, glorifier certaines périodes et minimiser ou ignorer d’autres, contribuant ainsi à une mémoire collective partagée. L’élaboration d’une histoire commune, avec ses héros, ses événements marquants et ses mythes fondateurs, est indispensable pour forger une mémoire collective et justifier l’existence de la nation.
Une culture folklorique et traditionnelle spécifique
La (re)création de costumes traditionnels – « dress code ! », de musiques, de danses et de contes folkloriques a permis de définir des caractéristiques culturelles distinctives pour chaque nation. Le folklor sert à illustrer la singularité culturelle de la nation et à renforcer un sentiment d’appartenance.
Des symboles nationaux
Drapeaux, hymnes, et emblèmes ont été conçus pour représenter visuellement et émotionnellement la nation, servant de points de focalisation pour l’identité collective.
Des héros nationaux
La célébration de figures historiques ou mythiques a servi à incarner les valeurs et les aspirations de la nation, offrant des modèles de vertu et de sacrifice pour la collectivité.
Des paysages emblématiques
Des sites naturels ou construits ont été promus comme représentatifs de la beauté et de l’esprit de la nation, renforçant ainsi l’attachement au territoire national.
Un territoire clairement défini
La délimitation d’un espace géographique propre à la nation est nécessaire pour matérialiser l’existence de la communauté nationale.
Une littérature nationale
Les œuvres littéraires et artistiques ont contribué à la diffusion de la langue nationale, à l’expression des thèmes et des valeurs nationaux, et à la construction d’une culture commune. Les œuvres littéraires promouvant, notamment, la langue, les valeurs, l’histoire et les idéaux de la nation contribuent à la diffusion de l’identité nationale.
Des monuments et des musées
Ces lieux de mémoire célèbrent l’histoire, la culture et les réalisations de la nation, incarnant physiquement l’identité nationale dans l’espace public.
Des institutions culturelles
Les systèmes éducatifs nationaux et les institutions ont joué un rôle clé dans la transmission des connaissances et des valeurs nationales aux générations futures.
Ces éléments, souvent créés ou réinterprétés de manière délibérée, ont servi de matériaux de base pour la construction des identités nationales. Thiesse met en évidence que, loin d’être des héritages naturels ou immuables, les identités nationales sont le résultat de processus actifs de sélection, d’invention et de diffusion culturelle.

Les identités nationales ne sont pas des faits de nature, mais des constructions. La liste des éléments de base d’une identité nationale est aujourd’hui bien connue : des ancêtres fondateurs, une histoire, des héros, une langue, des monuments, des paysages et un folklore. Sa mise au point fut la grande oeuvre commune menée en Europe durant les deux derniers siècles. Le militantisme patriotique et les échanges transnationaux d’idées et de savoir-faire ont créé des identités toutes spécifiques, mais similaires dans leur différence.
Forme d’organisation politique étroitement liée au développement du capitalisme industriel, la nation a fondé sa légitimité sur le culte de la tradition et la fidélité à un héritage collectif. L’exaltation de l’archaïsme a accompagné l’entrée dans la modernité.
De l’invention des épopées barbares à la conception des musées d’ethnographie, de l’élaboration des langues nationales à celle des paysages emblématiques ou des costumes typiques, cet ouvrage retrace la fabrication culturelle des nations européennes. Leurs identités sont issues d’un travail collectif et volontariste qui s’est appuyé sur les nouveaux médias de communication. Leçon de l’histoire à retenir, sans doute, pour l’Union européenne. Source : Éditions du Seuil
« Le résultat de la fabrication collective des identités nationales n’est pas un moule unique, mais bien plutôt, selon l’expression provocatrice du sociologue Orvar Löfgren, une sorte de kit en « do-it-yourself » : une série de déclinaisons de l’« âme nationale » et un ensemble de procédures nécessaires à leur élaboration. On sait bien aujourd’hui établir la liste des éléments symboliques et matériels que doit présenter une nation digne de ce nom : une histoire établissant la continuité avec les grands ancêtres, une série de hérosparangons des vertus nationales, une langue, des monuments culturels, un folklore, des hauts lieux et un paysage typique, une mentalité particulière, des représentations officielles – hymne et drapeau – et des identifications pittoresques – costume, spécialités culinaires ou animal emblématique. Les nations qui ont accédé récemment à la reconnaissance politique, et surtout celles qui en sont encore à la revendiquer, témoignent bien, par les signes qu’elles prodiguent pour attester leur existence, du caractère prescriptif de cette « check-list » identitaire. Le « système IKEA » de construction des identités nationales, qui permet des montages tous différents à partir des mêmes catégories élémentaires, appartient maintenant au domaine public mondial : l’Europe l’a exporté en même temps qu’elle imposait à ses anciennes colonies son mode d’organisation politique. Le recours à la liste identitaire est le moyen le plus banal, parce que le plus immédiatement compréhensible, de représenter une nation : que ce soit pour une cérémonie d’ouverture aux Jeux olympiques, les festivités accompagnant la visite d’un chef d’État étranger, l’iconographie postale et monétaire, ou la publicité touristique. La nation naît d’un postulat et d’une invention. Mais elle ne vit que par l’adhésion collective à cette fiction. Les tentatives avortées sont légion. Les succès sont les fruits d’un prosélytisme soutenu qui enseigne aux individus ce qu’ils sont, leur fait devoir de s’y conformer et les incite à propager à leur tour ce savoir collectif. Le sentiment national n’est spontané que lorsqu’il a été parfaitement intériorisé ; il faut préalablement l’avoir enseigné. »
Dans La Construction sociale de la réalité (1966), Peter Berger et Thomas Luckmann postulent déjà, eux aussi, que la réalité est socialement construite à travers les interactions humaines, les échanges linguistiques et les systèmes de croyances partagés.
Les individus apprennent et internalisent l’identité nationale via l’éducation, les médias, et les rituels culturels, développant ainsi un sentiment d’appartenance. Les symboles nationaux, la langue, et les figures héroïques incarnent et renforçent cette identité collective. Les institutions sociales contribuent à perpétuer les normes et valeurs nationales, tandis que les traditions et rituels célèbrent et réaffirment l’appartenance commune.
Cette approche démontre que les identités nationales résultent de processus sociaux dynamiques, façonnant la perception qu’ont les individus de leur appartenance à une nation, et met en exergue l’importance cruciale des interactions sociales, des institutions, et des symboles dans la construction des communautés imaginées.

Qu’est-ce que le réel ? Comment le connaître ? Comment se produit, sans cesse, l’articulation entre les faits objectifs et les significations subjectives ? Par quels processus un ensemble de typifications devient-il une réalité socialement établie ? Comment finissons-nous par vivre, au milieu de sociétés plurielles, dans un monde commun ? Par quelles socialisations ?
Livre majeur du constructivisme, La Construction sociale de la réalité est devenu au fil des ans une source de compréhension des modalités de (re)construction de la réalité, spécifique aux sociologues. Son importance et son succès durable tiennent à la place unique qu’il occupe dans l’histoire de la théorie sociale. Un grand nombre de traditions intellectuelles y font confluence, sans que violence soit faite à aucune d’entre elles. C’est ce tour de force qui rend cet ouvrage toujours aussi novateur. Source : Cairn info.
Dans L’invention de la tradition (1983), Éric Hobsbawm et Terence Ranger, examinent comment de nombreuses traditions perçues comme anciennes sont en fait des constructions modernes, créées à des fins spécifiques telles que la légitimation du pouvoir, la construction de l’identité nationale ou la cohésion sociale. À travers divers exemples, tels que les rituels de la monarchie britannique ou le port du kilt en Écosse, l’ouvrage révèle comment ces « traditions inventées » cherchent à établir un lien avec un passé souvent idéalisé, afin de répondre aux besoins contemporains.

Depuis sa parution en anglais, L’Invention de la tradition n’a pas cessé d’être cité et commenté, en Grande-Bretagne comme ailleurs. Le concept de « tradition inventée » fait aujourd’hui partie du patrimoine des sciences sociales et de l’histoire. Les différentes études réunies dans ce recueil décrivent comment les États-nations modernes en gestation, mais aussi les mouvements antisystémiques qui se développèrent en leur sein et les sociétés dites « traditionnelles », ont délibérément cherché, souvent avec succès, à réinterpréter radicalement ou à inventer, parfois de toutes pièces, des traditions et des « contre-traditions » pour se légitimer, s’inscrire dans la longue durée, assurer la cohésion de la communauté ou encore garantir le contrôle des métropoles impériales sur les sujets coloniaux. Source : éditions Amsterdam.
Par exemple, les frites sont bien belges, mais le hamburger n’est pas américain, à l’origine : le nom provient de la ville de Hambourg, en Allemagne, où un plat similaire, le « Hamburg steak » était populaire. Ce plat a été apporté aux États-Unis par des immigrants allemands au XIXe siècle.

Ainsi, « La cuisine italienne traditionnelle n’existe pas » non plus : la pizza n’est pas italienne et dans les années 70, elle était aussi exotique sur le territoire qu’auraient pu l’être les sushis ; idem pour la mozzarella.
Ainsi, toujours selon Éric Hobsbawm, dans Nations et nationalisme depuis 1780 : Programme, mythe, réalité (1992), « les États créent les nations, pas l’inverse« . Suggérant que l’apogée du nationalisme tel que nous l’avons connu pourrait être révolu, il ouvre la discussion sur plusieurs évolutions possibles :
La mondialisation économique, culturelle et politique pourrait mener à une interdépendance accrue entre les nations, rendant les frontières nationales moins pertinentes. Cela pourrait entraîner une diminution de l’importance du nationalisme traditionnel et une augmentation des identités supranationales ou transnationales.
À mesure que les enjeux mondiaux comme le changement climatique, la cybersécurité et les pandémies deviennent plus pressants, il est selon lui possible que de nouvelles formes de solidarité et d’identité collectives émergent, transcendant les frontières nationales et les sentiments nationalistes traditionnels.
Les sociétés de plus en plus diversifiées pourraient remettre en question les conceptions traditionnelles de l’identité nationale basée sur l’homogénéité culturelle, linguistique ou ethnique. Le nationalisme pourrait évoluer ou être remis en question face à la nécessité d’intégrer des identités multiples et de naviguer dans des contextes multiculturels.
Parallèlement à la globalisation, on pourrait observer un renforcement du régionalisme et du localisme, où les gens cherchent à préserver ou à promouvoir des identités spécifiques à des régions ou des communautés locales, parfois en opposition ou en complément au nationalisme étatique.
L’évolution technologique et l’essor des réseaux sociaux modifient la manière dont les individus et les groupes s’organisent, communiquent et expriment leur identité. Cela pourrait mener à de nouvelles formes d’engagement politique et d’identité collective, influençant la dynamique du nationalisme.
Les réponses aux crises mondiales pourraient nécessiter une coopération internationale renforcée, poussant vers des formes de gouvernance supranationale et des identités collectives qui transcendent le cadre national.
Hobsbawm souligne donc, déjà en 1992, la complexité et la fluidité des identités nationales et du nationalisme, anticipant que les transformations sociales, économiques et technologiques continueront d’influencer leur évolution. Bien que les contours précis de cette évolution restent ouverts à l’interprétation et à la spéculation, il est clair que le nationalisme et les identités nationales seront soumis à des pressions et à des changements significatifs dans le contexte du XXIe siècle.

À l’heure de la remontée brutale de toutes les formes de « nationalités », où les nouveaux États partent à la recherche de leur « sentiment national » et où les vieux États nations connaissent des flambées de nationalisme, on ne peut être que reconnaissant à Éric Hobsbawm de nous faire comprendre cette fin de siècle à la lumière de celle du siècle dernier.
L’historien s’attache avant tout à cerner d’un regard neuf les tribulations du concept, étant entendu qu’elles ne relèvent pas du ciel des idées mais s’enracinent dans une multitude de « nationalismes » historiques, sociaux, locaux, où la part du mythe se noue inextricablement à celle des réalités, dans une histoire pleine de bruit, de fureur et de sang, mais dont l’apogée – c’est une des originalités du livre que de le soutenir – est peut-être déjà dépassée.
Et parce que c’est chez moi, je vous proposerai prochainement une réflexion actualisée sur les écritures et narrations identitaire du terrain insulaire corse, qui représente une boîte de Petri de choix pour observer la construction des mythes et des imaginaires collectifs.

La Corse d’aujourd’hui s’est construite, au cours des deux cent cinquante dernières années, autour de multiples symboles et figures. Prise entre des tropismes divergents qui la conduisirent d’un géant culturel à un autre, de l’italianité à la francité, une part de ses élites s’est attachée à affirmer, couche après couche, une identité tout à fait originale. Dans ce mouvement, on a pu discerner la « naissance » d’une langue écrite et revendiquée (fin du XIXe), mais aussi celle d’une littérature (tri, voire quadrilingue !) et d’une histoire, non exemptes de mythes et de caractères imaginaires qui, de nos jours encore, « collent à la peau » des Corses. Ce que l’on appela, au XXe siècle, « l’âme corse » fit ainsi prospérer un certain nombre d’images toutes faites, dont des personnages « typiques » (rebelle, bandit, femme, berger, etc.) et des « mœurs » corses « spécifiques » (violence, hospitalité, honneur, etc.). Il était tentant d’en retrouver les processus de formation : revues historiques ou savantes, manuels scolaires, œuvres littéraires, articles de presse, reportages illustrés, statuaire… un certain nombre d’indices permettant en effet de déceler ce qui a produit ce que l’on peut nommer aujourd’hui « l’imaginaire national corse« . Étroitement liée aux vicissitudes sociales et politiques des époques successives, la façon de se raconter s’est modelée au fil du temps. Ainsi des images engendrent-elles d’autres images, jusqu’à former un ensemble congruent, un imaginaire partagé entre l’ici et l’au-delà de la mer. Ce que l’on pourrait appeler la « corsité » ou la « corsitude« . Car l’imaginaire national est porté par des figures historiques, des héros, des emblèmes, des événements, des « valeurs », et chaque période en tire parti à sa façon, forgeant tel ou tel aspect de « l’identité du Corse« . L’auteur, dans un travail minutieux de retour aux sources, retrace l’origine, la formation et les métamorphoses de ces « mythes fondateurs » jusqu’aux années 1930.
Ainsi, observer les dynamiques qui sous-tendent les narrations identitaires européennes révèle leur complexité et leur nature construite (même si ce n’est pas ex nihilo) : elles ne sont pas un fait naturel et immuable, qui existerait depuis la nuit des temps, comme on tendrait à le croire.
En effet, ces identités européennes d’hier et d’aujourd’hui ne sont pas statiques et sont le résultat de longs processus de construction historiques et culturels, souvent renforcés par des mythes et des symboles : des « communautés imaginées » façonnées par les interactions humaines et les dynamiques de pouvoir.
Ce qui revêt toute son importance, dans le contexte actuel et dans celui des élections européennes à venir, notamment, où ces représentations d’une identité européenne ont une influence prépondérante sur la façon dont l’Europe et ses citoyen.ne.s se perçoivent et se positionnent sur la scène mondiale.
Aussi, à titre d’exemple significatif, nous reviendrons bientôt sur l’affiche Renew, présentée par les Jeunes avec Macron, en février 2024, qui détourne le logo et le slogan Apple, en mode « start-up nation« . L’occasion rêvée de faire la transition avec le roman national des marques qui sera le sujet d’un prochain article.




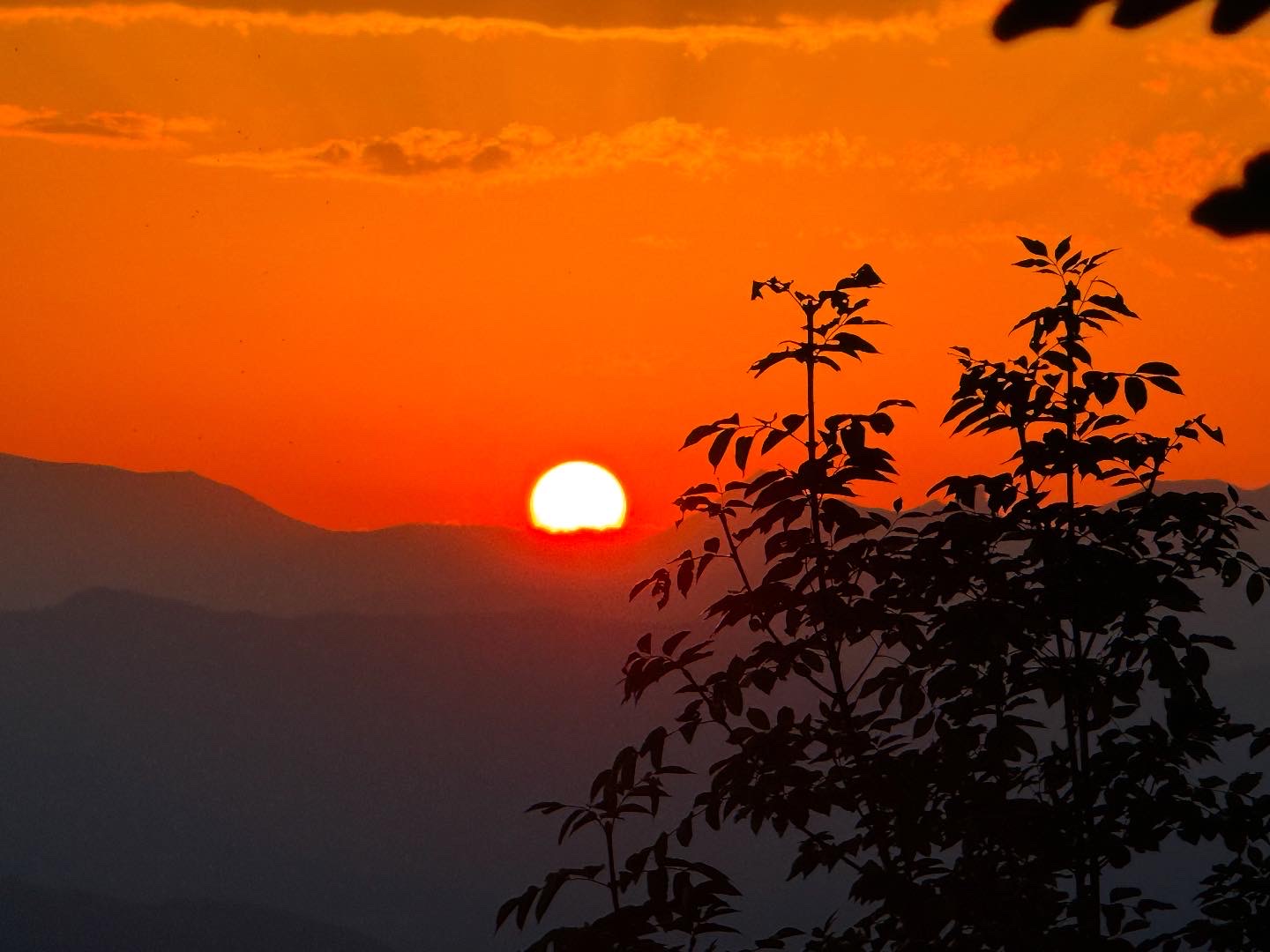




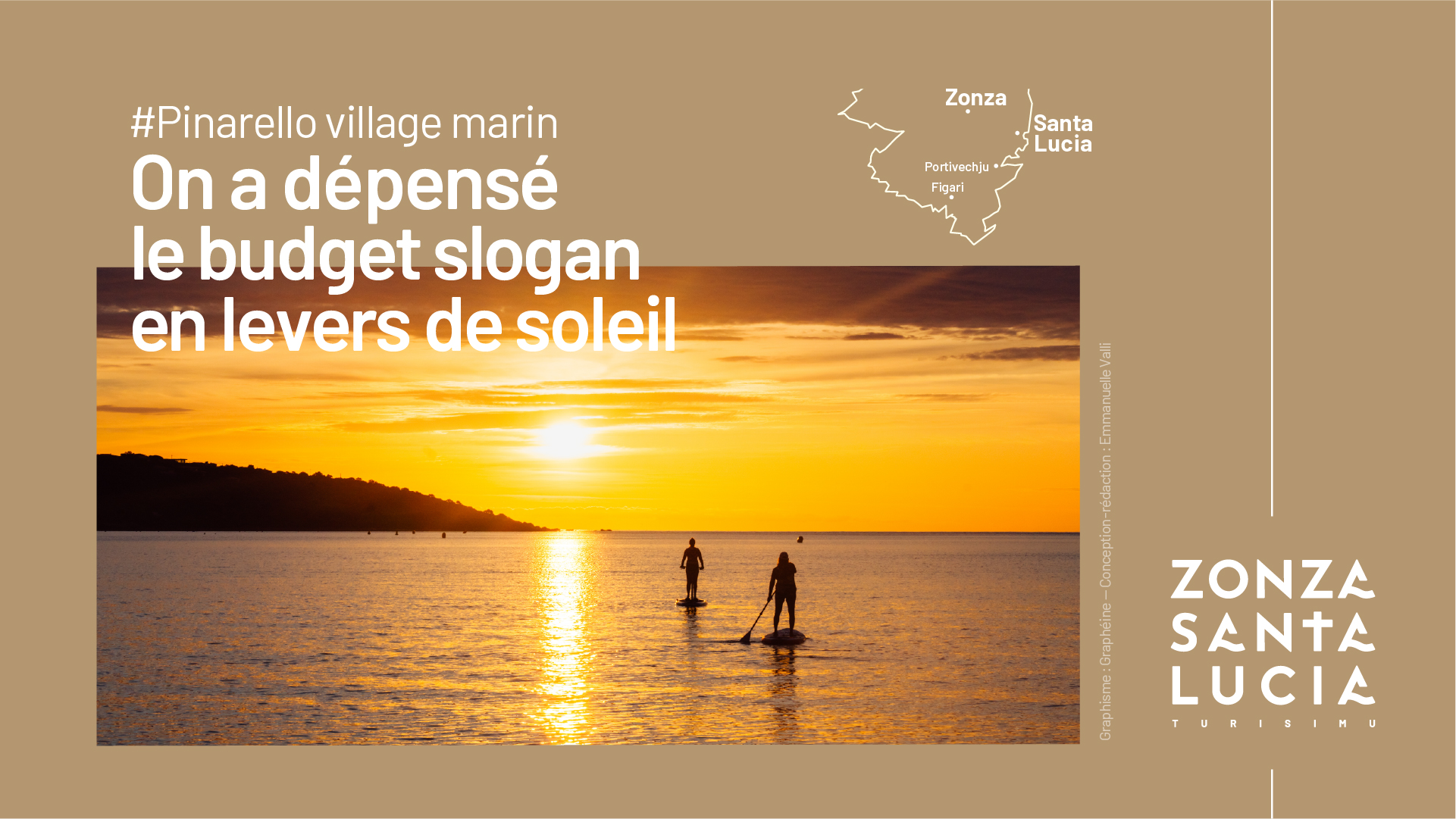
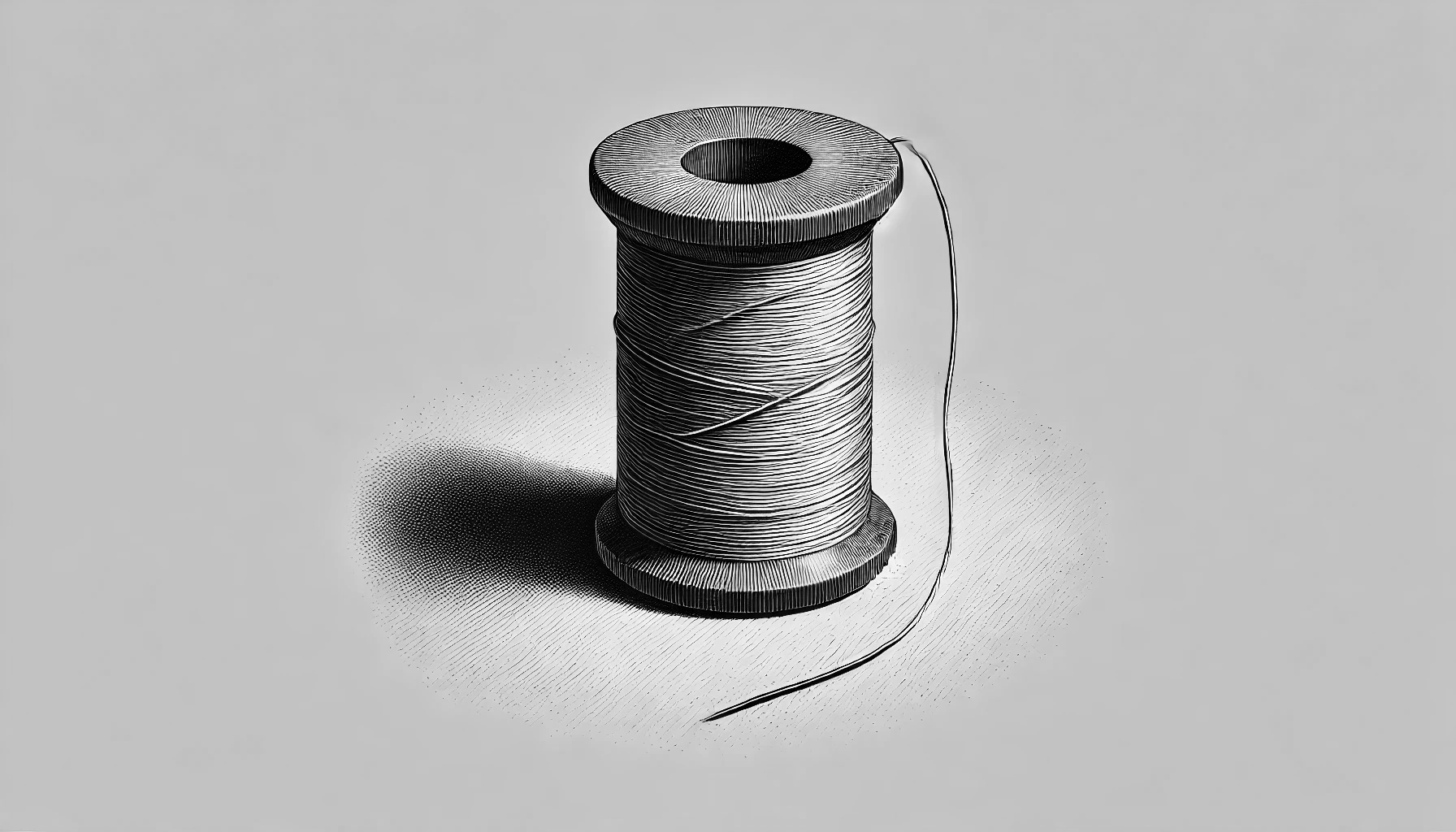
Laisser un commentaire