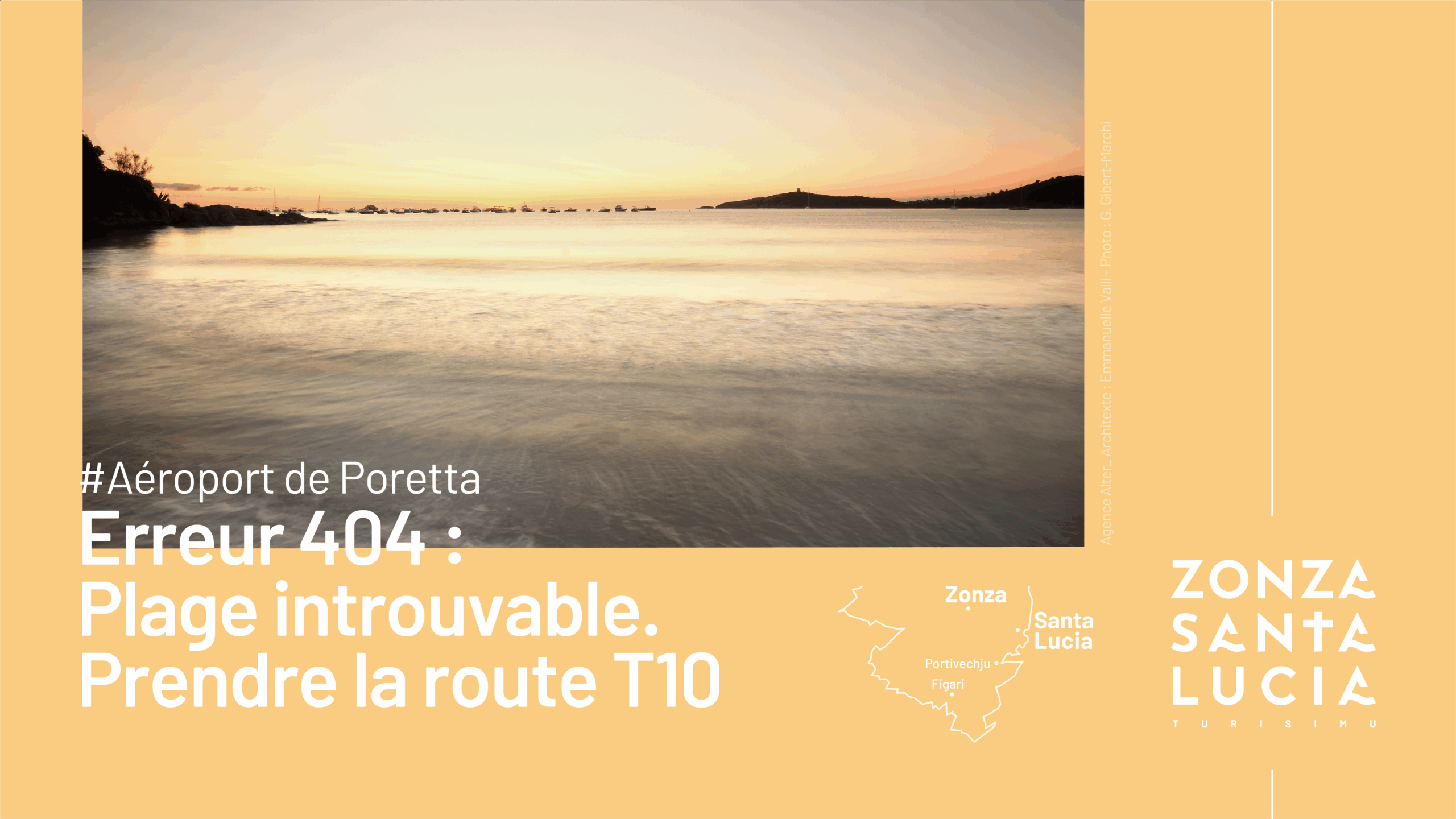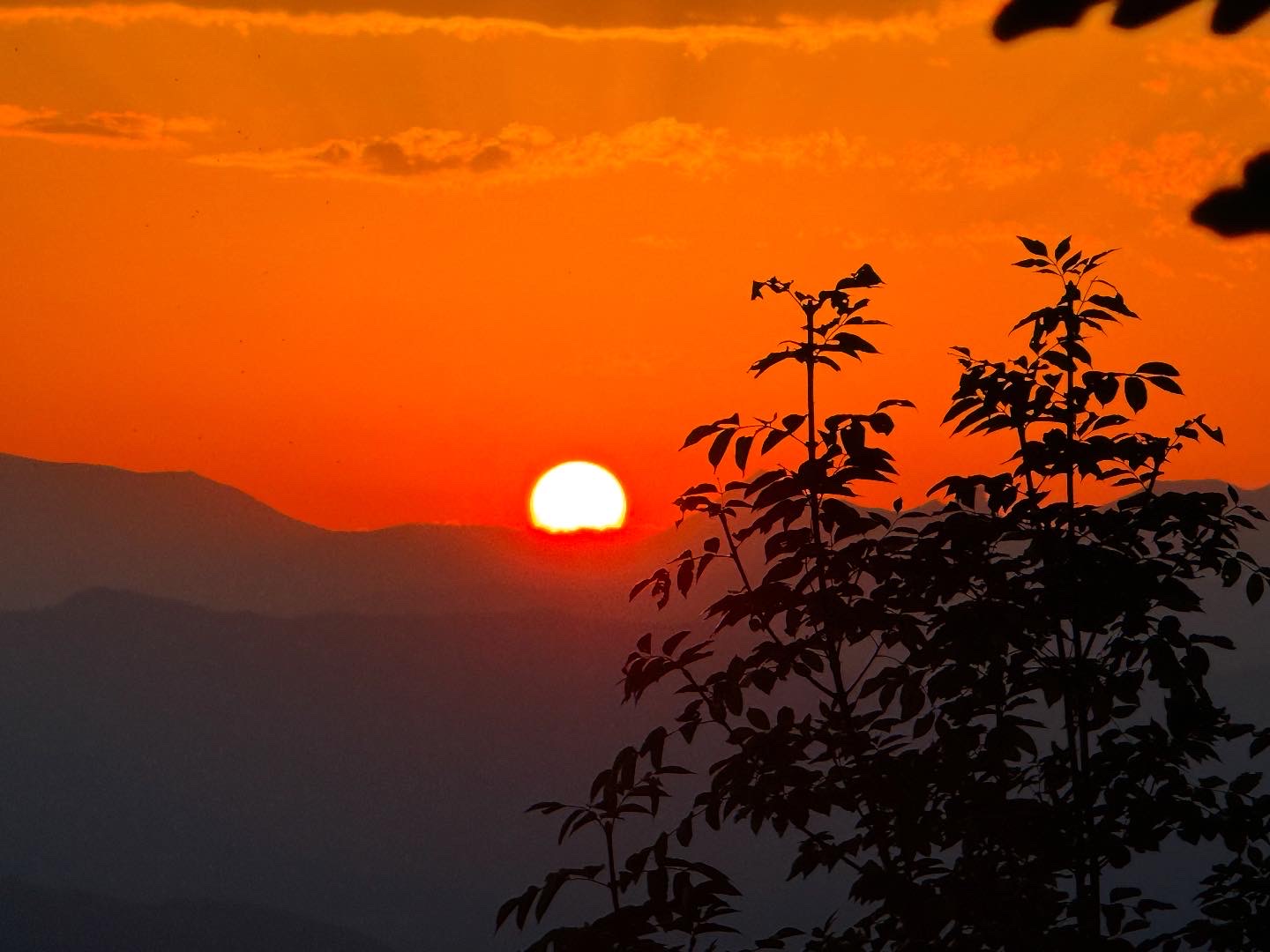Les Jeux Olympiques qui naissent en 776 av. J.-C. dans la Grèce antique – à Olympie – avaient pour but de célébrer les compétences athlétiques et d’honorer les dieux, notamment Zeus. Ces jeux pentétériques représentaient également un instrument de paix entre les cités-états, grâce à la trêve olympique – personnifiée en Écéchiria – qui permettait aux athlètes et aux spectateurs de voyager en sécurité afin d’y assister.

Les premières olympiades étaient centrées autour d’une seule épreuve : la course à pied.
Et cette épreuve n’était accessible qu’aux hommes, libres, qui parlaient grec.
Les participants couraient nus, ce qui ne manquait pas de souligner l’importance de la forme physique, qui était considérée comme un hommage aux dieux.
Dans cette célébration de la virilité promue par un baron moustachu – pour qui, vraisemblablement, la place des femmes se situait plutôt entre les layettes et la cuisine – les femmes ne seront admises qu’au début des années 1900, aux épreuves considérées comme étant compatibles avec leur féminité et leur fragilité. Elles demeurent, cependant, exclues des épreuves reines de l’athlétisme.
« La femme est avant tout la compagne de l’homme, la future mère de famille, et doit être élevée en vue de cet avenir immuable », écrit Coubertin, en 1901. Il remet le couvert en 1912 – si l’on peut dire – lorsqu’il avance que les JO représentent « l’exaltation solennelle et périodique de l’athlétisme mâle avec […] l’applaudissement féminin pour récompense« .

Dans l’Antiquité, les femmes participaient aux Héraia : une compétition athlétique quadriennale, qui leur était réservée, à Olympie, en l’honneur de la déesse Héra. Les jeux héréens comportaient des courses où les sportives, divisées en trois groupes d’âge, concouraient vêtues d’une tunique laissant un sein dénudé – potentiellement un rite de passage prénuptial. La victoire était récompensée par une couronne d’olivier sauvage et une part de la vache sacrifiée.
Au fil du temps, les JO se féminiseront peu à peu mais le déséquilibre – y compris au CIO – dominera tout le XXe siècle. Depuis 2007, la charte olympique rend obligatoire la présence des femmes dans tous les sports. En 2014, la Commission européenne défend l’égalité dans le sport et le CIO inscrit la parité à l’agenda olympique 2020.
Ainsi, l’idée de réintroduire les Jeux Olympiques, principalement orchestrée par le baron Pierre de Coubertin – pédagogue, historien, « particulé » et particulièrement misogyne, français -, est officiellement proposée et adoptée lors du congrès international de 1894, à Paris. Ce congrès aboutit à la création du Comité International Olympique (CIO) et à la planification des premiers Jeux de l’ère moderne, à Athènes, en 1896, où 14 nations et 241 athlètes concourent dans 43 épreuves.

« Le symbole olympique exprime l’activité du Mouvement olympique et représente l’union des cinq continents et la rencontre des athlètes du monde entier aux Jeux Olympiques. » Source : Charte olympique, Règle 8.
Si, en 1986, les anneaux ont pu être représentés visuellement avec des espaces interstitiels, en 2010, le CIO revient à la version initiale des anneaux entrelacés, sans interstice aux intersections. Symboliquement, on comprend aisément pourquoi.
Notons que le principe est identique pour le sigle de la marque Audi, dont les quatre anneaux imbriqués symbolisent le « mariage« , l’alliance… la fusion de 1932, entre les quatre constructeurs automobiles, auparavant indépendants : Audi, DKW, Horch et Wanderer.
À la fin du XIXe siècle, l’Europe et une grande partie du monde sont les témoins d’une montée des nationalismes, de tensions internationales et d’une industrialisation qui va à toute vitesse. Les Jeux sont alors envisagés comme un moyen de promouvoir la paix, le dialogue, la compréhension et l’entente mutuelle entre les peuples.
Toutefois, cette vision trouve ses limites face aux réalités politiques des deux guerres mondiales, qui ont interrompu les Jeux à trois reprises – en 1916, 1940 et 1944. En 1936, à Berlin, les JO font führer et Adolf Hitler tente de les utiliser à des fins de propagande – pour faire croire à la supériorité de la race aryenne – mais ces Jeux resteront gravés dans l’histoire, notamment, grâce aux performances de l’athlète afro-américain Jesse Owens, qui a remporté quatre médailles d’or, démontrant l’inanité de la théorie nazie. Après chaque conflit, les Jeux ont pu aussi servir de symbole de réconciliation et d’espoir, en renforçant l’idéal d’une communauté internationale unie par le sport, à l’exemple de ceux que l’on a surnommé les « Jeux de la résurrection », à Londres, en 1948.
Malgré les idéaux des Jeux Olympiques, ces derniers doivent faire face à des critiques et des défis, notamment en termes de dépassement de coûts, d’impact environnemental, de politisation et aussi, parfois, de corruption. Ces enjeux impliquent de s’adapter et de réformer des pratiques au long cours, afin de tendre vers des Jeux plus durables, plus inclusifs et mieux alignés sur les valeurs olympiques qu’ils véhiculent. Ce n’est pas gagné, mais ce qui est intéressant c’est que chaque édition des JO est estampillée par le reflet de son époque.
Ainsi, faisons à présent un focus sur la marque Paris 2024, dont l’objectif principal semble être de se distinguer plus que de coutume.
En effet, Paris – enfin, la France – marque son territoire, sans lever la patte mais en cassant les codes. Elle joue avec une profusion d’images, où dialoguent modernité et figures patrimoniales ripolinées pour l’occasion. Visant à offrir une représentation fraternelle, inclusive, festive et positive du sport, cela concorde parfaitement avec les valeurs et les missions traditionnellement véhiculées par les JO.
Toutefois, si la marque semble être alignée avec ces valeurs, elle opère une réappropriation assez nette, à travers le prisme de la culture et de l’identité françaises, autour de quelques composantes essentielles, que nous tenterons d’observer : l’emblème, la charte graphique, les mascottes, les médailles, les pictogrammes et les affiches.

Un logo fusionnant médaille, flamme et Marianne (?), afin de symboliser les Jeux humains et fraternels. Pour la première fois, les Jeux Olympiques et Paralympiques partagent le même logo, symbolisant une vision et une ambition communes. Son accueil mitigé reflète les défis inhérents à la création d’un symbole, visant à encapsuler une multitude de valeurs, d’identités et d’attentes dans un contexte international.

Une palette colorielle riche, dont la principale inclut le noir, le blanc et l’or, en référence à l’emblème, ainsi que sept couleurs primaires emblématiques de la France, traduisant l’énergie et l’enthousiasme de l’événement. Si le noir, le blanc et l’or confèrent élégance et sophistication au design, reflétant le prestige et l’excellence associés aux Jeux Olympiques et Paralympiques. L’or n’est pas sans évoquer la quête de la médaille dorée, objectif ultime des athlètes.

Une typographie au style néo-Art Déco qui reflète l’élégance française et l’énergie du sport. Cette typographie « variable » a été spécialement conçue pour varier de manière fluide sur tous les nouveaux supports. Le choix d’un style rétro, modernisé pour le numérique, crée un pont entre le patrimoine culturel de la France et sa volonté d’innovation, soulignant l’ambition de célébrer l’héritage, le regard tourné vers l’avenir.

Une iconographie célébrant le mouvement, la singularité des gestes, la puissance des attitudes et la dynamique du quotidien, rapprochant ces éléments d’architectures et d’environnements inattendus. Aujourd’hui, tout doit être animé, sous peine d’être ennuyeux alors, là, c’était l’occasion toute désignée pour coller à la sémantique des JO.

Une arche inspirée de l’Arc de triomphe, ouverte à tous les possibles, qui se veut le symbole du geste architectural, de l’ouverture au monde, de l’accueil et de l’inclusivité – avec un clin d’œil au style Art Déco de la typographie. Comme son nom l’indique, cet Arc offre également une certaine représentation du triomphe : celle qui glorifie l’armée française pour la victoire de Napoléon Bonaparte, à Austerlitz, en 1805. Certes, la guerre, c’est sportif, mais le monument tout entier renvoie à la mémoire, au patriotisme français et la gloire militaire. Le message est peut-être « faites du sport, pas la guerre« , corroboré par l’Arc recustomisé « girly« par Gattoni, sur l’affiche officielle.

Les mascottes officielles, les Phryges, symbolisent la révolution par le sport et l’inclusion. Si le bonnet phrygien coiffe Marianne dans les mairies ou sur les timbres français, avant sa réapparition comme icône de la Révolution française, il est avant tout un symbole ancien de liberté, d’émancipation et d’indépendance. Ses origines remontent à l’Antiquité, en Phrygie – royaume prospère de l’Anatolie centrale. Il est également un symbole de l’affranchissement des esclaves, dans la Rome antique. On peut dire qu’on a mis le paquet pour exprimer que le sport libère. Même si nombreux sont ceux qui ont pu confondre ces bonnets P avec des clitoris olympiques.

Les médailles sont assorties d’un morceau de fer d’origine de la tour Eiffel. Un design qui s’éloigne de tout ce qui avait été fait auparavant. Le fer est taillé en hexagone, forme géométrique de la France, qui rappelle la mobilisation de tout le pays, au-delà de sa capitale. Les rayons évoquent à la fois le rayonnement de la France dans le monde et celui de la performance des athlètes aux Jeux. Sans connaître le (sur)coût dans leur fabrication, n’y-a-t-il pas une légère surcharge symbolique, qui rend ces médailles un peu lourdes à porter ? Cela ne risque-t-il pas de diluer la clarté du message, auprès d’un public international, qui pourrait préférer des symboles plus universels de l’olympisme ?

Les pictogrammes, eux-aussi, assez différents de ceux que l’on a l’habitude de voir, traditionnellement, ont fait pas mal parler d’eux. C’était peut-être le but. Ceux-ci auraient vocation à être « plus que de simples éléments signalétiques à visée universelle« . Et leur « blason unique, [rendrait] honneur à la complexité de chacun des sports et aux éléments qui en font l’originalité« . Si l’on ne peut que louer l’initiative créative et la volonté d’innovation, on peut également questionner l’efficience, dans fonction signalétique qu’ils sont sensés remplir, en termes de lisibilité, d’accessibilité et de navigation dans les différents sites olympiques.
Avec les affiches, le comité des JO de Paris 2024 continue de s’inscrire dans une esthétique et une symbolique qui revendiquent une « impertinence » assumée.
Joachim Roncin, directeur artistique de Paris 2024, voulait « une image totale qui raconte une histoire », à rebours des affiches officielles très institutionnelles des jeux précédents. Doit-on entendre que les précédentes affiches ne racontaient rien ?
« Nous voulions nous éloigner des affiches très institutionnelles (…) Notre désir était d’apporter de la légèreté, de l’humour, un dessin grâce auquel tout le monde, y compris les plus jeunes, pourrait comprendre au premier regard l’identité de Paris 2024. Dès le 5 mars, elles seront placardées partout dans Paris, à la vue de tous. Il nous fallait imaginer deux affiches fun, mais aussi exceptionnelles ». Bon, on comprend bien, au premier regard, que le but est d’afficher une rupture avec tout ce qui a été proposé jusque-là.
Souvenons-nous, à ce propos, que les affiches ont été le moyen de promotion essentiel des JO, avant l’ère de la radio (JO de Paris, 1924) et de la télévision (JO de Berlin, 1936) : la première affiche officielle est créée pour Stockholm, en 1912, les suivantes seront respectivement introduites en 1928, à Amsterdam et en 1936, à Berlin.

Révélé lundi 4 mars, au Musée d’Orsay, ce diptyque, symbolisant l’union de l’olympisme et du paralympisme, dépeint un Paris utopique, métamorphosé en un immense théâtre sportif où se mêlent architecture emblématique, symboles olympiques et une diversité de disciplines sportives, illustrant la vision inclusive des Jeux. Avec environ 40 000 personnages et plus de 2 000 heures de travail, Ugo Gattoni offre une affiche riche en détails et en histoires, destinée à capturer l’imagination et à rester pertinente pour les générations futures, symbolisant l’esprit intemporel et universel de ces compétitions internationales.
En somme, l’identité de la marque Paris 2024, prétend se démarquer du reste du monde et des exercices de style des époques qui ont précédé.
Pour Joachim Roncin, cette affiche « fera [carrément et humblement] jurisprudence« , comme le logo des JO de Mexico, en 1968. Rien que ça. Affaire à suivre, en 2028, donc. En tout cas, notons que ce désir de ne rien faire comme les autres et de marquer les esprits se prolonge jusque dans le format.
Aussi, perçoit-on clairement la volonté de réaffirmer l’identité culturelle française, dans une démarche qui semble prendre particulièrement au pied de la lettre la traditionnelle célébration de la spécificité de la « hôte culture« .
La marque Paris 2024 se veut « humaniste, frondeuse, élégante, passionnée, amoureuse, utopique, insolente et cartésienne », mais qu’en est-il de la France ? Celle des provinces, des banlieues, du RSA, des agriculteurs, des chômeurs, la France dont on réduit le budget de l’Éducation et de la Recherche, où les JO peuvent faire sauter les verrous de l’expérimentation de la vidéosurveillance automatisée ; cette France-là, a-t-elle encore le loisir de se reconnaître dans ces valeurs ? Et – bonus – bénéficiera-t-elle des retombées économiques générées pas ces Jeux sur son territoire ?
La synecdoque (cf. métonymie) est une figure de rhétorique qui consiste à prendre la partie pour le tout (ex. : la voile pour désigner le voilier ou la navigation) et le singulier pour le pluriel (ex. : l’ennemi pour désigner les ennemis). Dans cette logique et regorgeant de « symbolisme national pour les nuls« , la marque Paris 2024, c’est la France. Mais Paris, est-ce vraiment la France ?

Oui, « Emily in Paris » est peut-être l‘image symptomatique et clichée de la France aux yeux des touristes. Il faudrait vérifier. Mais aux yeux des Français ?
L’illustrateur français Ugo Gattoni est contacté par le directeur du design de Paris 2024, sur Instagram. Ils échangent sur le sujet avant de passer un après-midi à partager leurs idées et leur vision de l’identité de ces Jeux. Gattoni revendique « la liberté totale. Un luxe auquel il tient pour créer à sa manière, loin des sirènes hurlantes de la mode« . Pourtant, on imagine bien les motifs de ces affiches orner les indémodables et emblématiques carrés de la marque Hermès, qui est l’un de ses clients.
« Il faut [que l’affiche] ait encore du sens dans 100 ans », espère Ugo Gattoni. Mais a-t-on vraiment envie d’espérer que nos valeurs et notre identité restent figées dans le marbre d’une tablette graphique ? Ne devrions-nous pas plutôt souhaiter que les générations à venir s’amusent, elles-aussi, avec impertinence, des images nationales poussiéreuses ? Au moins pour qu’on puisse encore confronter des points de vue divergents ?
En outre, si casser les codes peut avoir ses vertus, pourquoi souhaiter se différencier à ce point ? Quel est le but recherché ? C’est ce que nous tentons d’interroger. Pourquoi vouloir se démarquer à tout prix, dans un événement qui a vocation à mettre en valeur le commun ? À montrer que l’entente internationale est possible et souhaitable.
« La critique est aisée et l’art est difficile », puis « les Français.e.s ne sont jamais satisfait.e.s », mais il est heureux que des discussions puissent être générées autour de la façon dont se construisent les images qui représentent notre culture dans le monde.
Dans ce joyeux bazar, la richesse des détails et la profondeur de la composition invitent à une exploration visuelle poussée, offrant une « double lecture » sensée enrichir l’expérience du spectateur : parmi les 1001 références cachées, on pourra notamment tenter de débusquer la torche olympique éteinte – non, ce n’est pas une bouteille de Perrier -, 8 Phryges, puis, côté bestiaire, on pourra même partir à la recherche de la colombe blanche – symbole de paix et de concorde – en continuant de se demander Où est Charlie ? et où est passée la paix dans le monde, par exemple.
La « norme » tacite pour les affiches olympiques, qui privilégie la simplicité et la clarté, afin d’assurer une compréhension immédiate par tous, est donc ici délaissée, au profit d’une œuvre extrêmement détaillée qui lui préfère une lecture plus complexe. Les choix esthétiques de Gattoni ne pourront pas plaire à tout le monde – notamment à ceux qui aime les approches plus minimalistes – mais le peut-on vraiment ?
Notons, que si les affiches olympiques traditionnelles retracent visuellement l’histoire et l’atmosphère de chaque édition des JO, elles sont aussi le témoin des styles et des valeurs du moment, ainsi que du contexte social et politique de leur époque.
On peut dire que cette année encore, c’est mission accomplie : l’art de la profusion onirique et surréaliste de Gattoni, qui propose une immersion dans son Pari(s) olympique, s’inscrit à merveille dans la tendance submersive qui nous noie perpétuellement sous les messages et symboles, entravant la lisibilité et la mémorisation des informations dans nos quotidiens saturés.

On peut lire un peu partout que les affiches de Gattoni rappelle le style de Miyazaki, Claude Ponti, Moebius, Jérôme Bosch ou encore Martin Handford (Où est Charlie ?) mais personne – sauf erreur – n’avait encore fait mention des posters de Lego City. Pourtant, de mon côté, j’y vois bien une certaine démultiplication de Lego.
Dans un post Instagram l’artiste écrit « a picture’s worth a thousand words » – « 1 image vaut 1000 mots », propos attribué à Confucius – mais que raconte cette surabondance de motifs – au-delà de l’allégorie de la surconsommation et de l’inanité capitalistique – tant dans l’identité de marque Paris 2024 que dans son affiche ?
Ces choix créatifs audacieux divisent l’opinion publique, mais si l’on tente de rester objectifs, on sait qu’il pourrait difficilement en être autrement.
Néanmoins, une question demeure en suspens : est-ce que dépeindre ce phénomène de saturation symptomatique de notre époque était réellement le but poursuivi par Gattoni pour son diptyque ? Si tel est le cas, c’est très réussi : Gattoni remporte la médaille d’or des athlètes du détail graphique microscopique en format macro’.
C’est ludique et ça donne envie d’aller fouiller comme des enfants dans le pays merveilleux de ces affiches, à la recherche de trésors cachés et chacun pourra se raconter une histoire différente sur les 40 000 personnages avant de s’endormir, un peu comme avec Barbie ou les Playmobil.
Enfin, si j’ai aimé la profusion baroque dans le dernier film de Yórgos Lánthimos, « Poor things« , je ne peux m’empêcher de m’interroger quant au message qu’envoie Paris au reste monde : est-ce que c’est l’image que la France souhaite projeter d’elle ? N’a-t-on pas d’autre message plus engageant pour créer du commun, pour vivre-ensemble que celui de l’exception française, qui semble afficher pour valeur sa dissemblance ?
Selon Émile Durkheim, dans De la Division du travail Social (1893), l’amour suppose une certaine harmonie de pensées et de sentiments, mais « il n’est pas moins vrai que ce qui donne à ce penchant son caractère spécifique et ce qui produit sa particulière énergie, ce n’est pas la ressemblance, mais la dissemblance des natures qu’il unit. » Ce serait donc parce que nous différons les uns des autres que nous cherchons à nous unir, à défaut de toujours nous comprendre ?
Finalement, le message – quel qu’il soit – offre une grande liberté d’interprétation.

Spéciale dédicace et pensée, tout de même, pour ceux et celles à qui les JO et les blanches colombes ne permettront pas d’adoucir les problèmes. Tenez bon, c’est déjà du sport !
Dans les prochains articles, je tenterai de creuser cette vaste et passionnante question des écritures et narrations identitaires nationales et territoriales. À suivre…