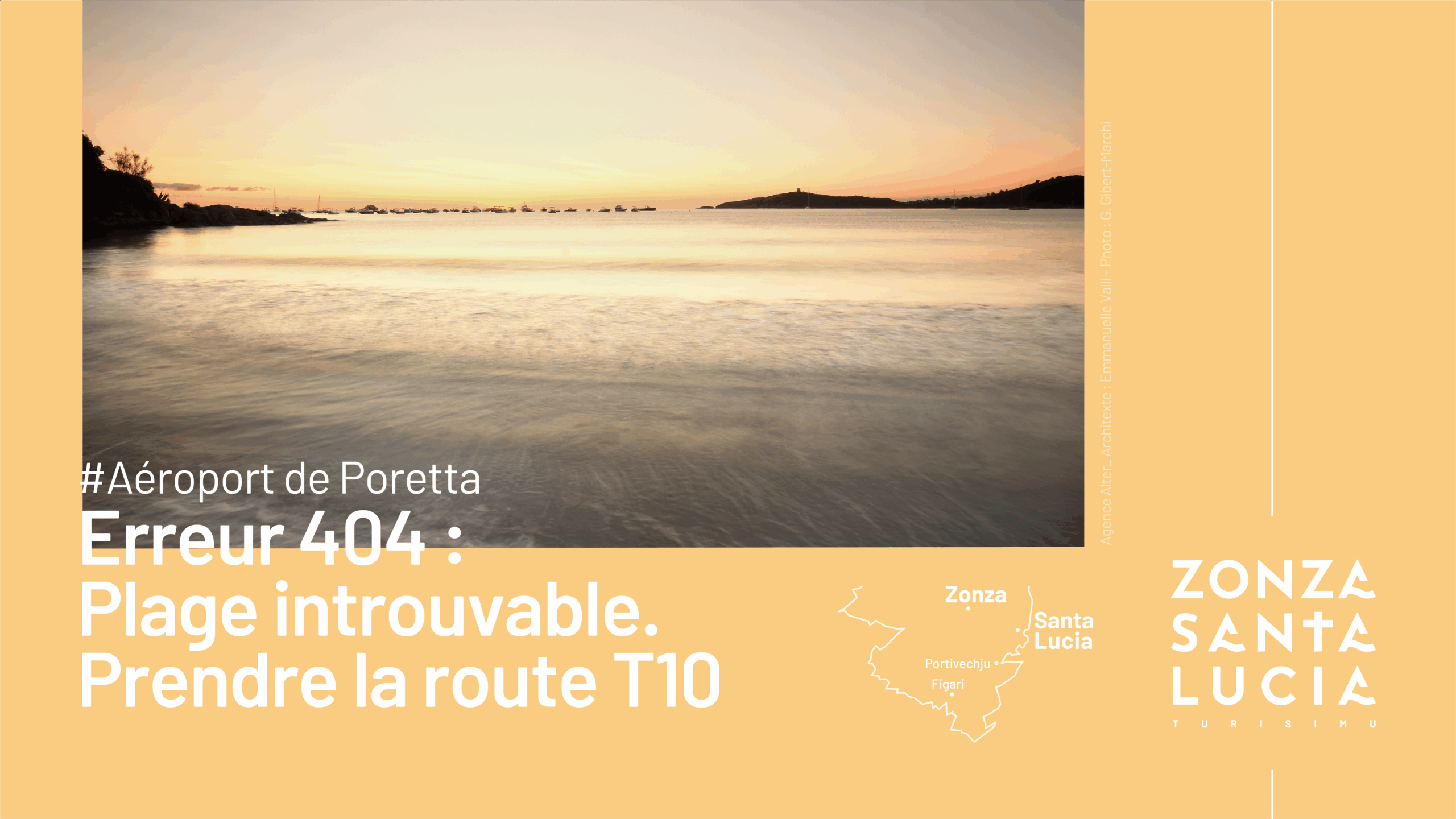Manifeste naïf et utopique, pour que « storytelling éthique » et « communication responsable » deviennent des pléonasmes, non des oxymores.
Dans un paysage médiatique en perpétuelle évolution, à l’heure où les récits peuvent être façonnés et diffusés avec une rapidité sans précédent, arrêtons-nous quelques instants, afin d’interroger la manière – souvent acritique – dont nous intégrons les différents objets de communication et les récits dans notre quotidien.
Le storytelling, ou l’art de raconter des histoires, est depuis toujours un moyen puissant de captiver, d’enseigner et de partager des valeurs. Cette pratique millénaire, qui trouve ses origines dans les traditions orales des premières civilisations, a évolué jusqu’à devenir un jalon – tantôt loué, tantôt décrié – des stratégies de communication contemporaines. Pourquoi ?
Dans Storytelling : la machine à fabriquer des histoires et à formater les esprits (2008), Christian Salmon fait une critique incisive de l’utilisation du storytelling en politique, dans le marketing et les médias. Il y dépeint comment cette méthode, initialement destinée à raconter des histoires, s’est transformée en un outil puissant de persuasion insidieuse et de manipulation, utilisé par les entreprises, les politiciens et les institutions, dans le but de façonner l’opinion publique et d’influencer le comportement des individus. Il en souligne les implications éthiques, l’impact sur le débat démocratique et appelle à la vigilance critique face aux récits manipulés.

L’humanité a toujours su cultiver l’art de raconter des histoires, un art au coeur du lien social. Mais depuis les années 1990, aux États-Unis puis en Europe, il a été investi par les logiques de la communication et du capitalisme triomphant, sous l’appellation anodine de » storytelling « . Derrière les campagnes publicitaires, dans l’ombre des campagnes électorales victorieuses, se cachent les techniciens sophistiqués du storytelling management ou du digital storytelling, pour mieux formater les esprits des consommateurs et des citoyens.
C’est cet incroyable hold-up sur l’imagination que révèle Christian Salmon, au terme d’une longue enquête consacrée aux applications toujours plus nombreuses du storytelling : le marketing s’appuie plus sur l’histoire des marques que sur leur image, les managers racontent des histoires pour motiver les salariés, les militaires en Irak s’entraînent sur des jeux vidéo conçus à Hollywood et les spin doctors construisent la vie politique comme un récit… Dans Christian Salmon dévoile ici les rouages d’une « machine à raconter » qui remplace le raisonnement rationnel, bien plus efficace que toutes les imageries orwelliennes de la société totalitaire. Source : éditions La Découverte.
Il existe donc un paradoxe qui réside dans la narration à dessein entre, d’un côté, la construction d’imaginaires qui fédèrent et font sens et, de l’autre, son pendant qui parfois atomise l’éthique derrière le récit de l’authentique, au bénéfice du profit. Cependant, chaque communicant n’est-il pas toujours en capacité de choisir son camp ? L’objectif de cet article n’est certainement pas de moraliser ou de culpabiliser ceux qui font des choix différents, pour les raisons qui leurs sont propres, mais seulement de questionner et de tenter d’éclairer les rouages de la production de sens à travers le storytelling, aujourd’hui.
Par ailleurs, dans L’ère du clash (2019), Salmon explore le passage à une nouvelle ère, caractérisée par l’imprévisibilité, la rupture et le choc, où la conquête de l’attention et du pouvoir passe par l’affrontement, où « l’inflation des stories a érodé la confiance dans les récits« . Il avance que « dans le brouhaha des réseaux et la brutalisation des échanges, la story n’est plus la clé pour se distinguer ».
Pour autant, l’avènement de cette « ère du clash » signe-t-il véritablement la fin du storytelling ? Il est permis d’en douter et aussi d’espérer que les histoires ont encore une place et un rôle à jouer dans la mise en récit des transitions à venir.

« La vie politique, sociale ne s’ordonne plus en séquences ou feuilletons. Elle n’est plus rythmée par l’intrigue mais par l’imprévisibilité, l’irruption, la surprise, une logique de la rupture qui relève davantage d’une sismographie politique que du storytelling. On est passés de la story au clash, de l’intrigue à la transgression sérielle, du suspense à la panique, de l’argument au fake, de la séquence à une suite intemporelle de chocs. Fini le storytelling ? Bienvenu dans l’ère du clash ! ». Source : éditions Fayard.
La théorie du nœud borroméen de Jacques Lacan nous éclaire, notamment, sur l’importance de la dimension symbolique dans le champ du langage et souligne son rôle central dans la façon dont nous donnons du sens à notre réalité, entre notre expérience subjective et collective.
Dans Mythologiques (1964-1971), Claude Lévi-Strauss, à travers son approche structuraliste, révèle comment les récits mythologiques constituent des expressions symboliques complexes qui reflètent les structures sous-jacentes de la pensée humaine.
Les avancées en neurosciences attesteraient de l’efficience des histoires sur le cerveau : une information symbolisée, racontée dans une histoire, serait bien mieux retenue que celle qui le serait dans un cadre de transmission purement informationnel. Sans développer sur le sujet, qui comporte lui-aussi ses controverses, il est assez aisé de comprendre quel est notre fonctionnement basique : qui peut dire qu’il n’aime pas les histoires ? Comment les humains pourraient-ils ne plus avoir besoin de se réfugier dans de nouveaux mythes, dans de nouvelles histoires ou de réécrire la leur ?
Des réussites aussi emblématique que celles d’Apple – « Think different » – ou de Nike – « Just do it » – illustrent parfaitement comment le storytelling est capable de transformer une simple annonce en une expérience narrative « inspirante », incitant non seulement à consommer mais, également, à adhérer à un style de vie ou à un ensemble de valeurs. Notons, d’ailleurs, que l’enjeu semble moins relever de la visibilité que de l’engagement et de l’adhésion. Adhérer au mythe de la marque, c’est partager ses valeurs, les représentations auxquelles elle renvoie, c’est lui être fidèle, et cela semble relever du besoin de sens et d’appartenance, qui sont peut-être les deux rêves que consomment le plus massivement les humains.
Si la mise en scène narratologique apparaît quelque peu vulgaire, lorsqu’elle est destinée à vendre et à faire consommer ou à manipuler, en utilisant les émotions, elle est cependant affaire courante dans la vie de tout un chacun.
Le triangle rhétorique d’Aristote est un modèle composé de trois éléments essentiels à la persuasion : l’éthos (crédibilité du locuteur), le logos (logique de l’argumentation) et le pathos (appel aux émotions du public). Le pathos y joue un rôle crucial et Aristote reconnaissait que toucher les émotions pouvait être tout aussi important que la logique ou la crédibilité, afin de convaincre un auditoire. En stimulant la pitié, la peur, l’indignation ou la joie, le locuteur parvient à créer un lien puissant avec son public, le rendant plus réceptif à l’argument présenté. Manipulation ? Les deux autres angles du triangle – ethos et logos – sont garants, en principe, de l’équilibre. Quoiqu’il en soit, quel émetteur saurait être indifférent à la réception dont bénéficiera son message ?

Le triangle rhétorique est introduit par Aristote dans son œuvre Rhétorique (écrite aux alentours de 350 avant J.-C.). Ce modèle repose sur trois piliers :
Éthos : la crédibilité ou l’éthique du locuteur, qui repose sur la perception de sa compétence, de son autorité et de son caractère légitime par l’auditoire.
Logos : la logique ou la raison derrière l’argumentation, incluant l’utilisation de preuves et de raisonnements pour soutenir une thèse.
Pathos : l’appel aux émotions, qui cherche à susciter une réaction émotionnelle chez l’auditoire, dans le but de convaincre, persuader.
En somme, le storytelling et le discours découlent tous deux d’un même objectif visant à transmettre un message de manière efficace : le premier, via une connexion émotionnelle et des récits captivants et le second, via une argumentation logique et structurée pour informer, persuader ou motiver. Le clivage supposé entre le storytelling et d’autres formes communicationnelles ne semble donc pas relever de l’évidence, mais reflète la complémentarité des différents biais dans l’art de la persuasion, qui peut prendre différentes apparences. Comment arbitrer our dire quelle apparence est la plus acceptable ou légitime ?
À présent, tentons encore d’appréhender les contraintes et les enjeux du storytelling, à partir d’un autre exemple qui, même s’il est loin d’être des plus banals est, au moins, l’un des plus absolus et des plus poétiques.
Fernando Pessoa, n’est pas seulement écrivain, il est une multitude d’écrivains à lui seul, parce que pour lui « n’être qu’un est une prison ». Il invente ses hétéronymes, des pseudonymes utilisés pour incarner des auteurs fictifs. Il ne se contente pas simplement de voix désincarnées, mais leur fabrique des vies, à travers lesquelles il cherche à découvrir la multitude de sensations qu’offre le monde.
Ce qui est intrigant, c’est que c’est peut-être à cause de – ou grâce à son nom – Pessoa. En français, « pessoa » signifie « (une) personne », qui vient du latin « persona », qui désignait le « masque de l’acteur », puis le « rôle », au théâtre. D’une façon très générale, la persona est le masque que tout individu porte pour répondre aux exigences de la vie en société, le masque derrière lequel chacun d’entre nous parle.
C’est également la ruse qu’emploie Ulysse, afin d’échapper au cyclope, à qui il fait croire que son nom est Personne. Ainsi, lorsqu’on demande à Polyphème le nom de celui qui avait crevé son œil, ce dernier répond : « Personne ».

« En ces heures où le paysage est une auréole de vie, j’ai élevé, mon amour, dans le silence de mon intranquillité, ce livre étrange… » qui alterne chronique du quotidien et méditation transcendante.
Le livre de l’intranquillité est le journal que Pessoa a tenu pendant presque toute sa vie, en l’attribuant à un modeste employé de bureau de Lisbonne, Bernardo Soares. Sans ambition terrestre, mais affamé de grandeur spirituelle, réunissant esprit critique et imagination déréglée, attentif aux formes et aux couleurs du monde extérieur mais aussi observateur de « l’infiniment petit de l’espace du dedans », Bernardo Soares, assume son « intranquillité » pour mieux la dépasser et, grâce à l’art, aller à l’extrémité de lui-même, à cette frontière de notre condition ou les mystiques atteignent la plénitude » parce qu’ils sont vidés de tout le vide du monde« . Il se construit un univers personnel vertigineusement irréel, et pourtant plus vrai en un sens que le monde réel.
Le livre de l’intranquillité est considéré comme le chef-d’oeuvre de Fernando Pessoa. Source : librairie Gallimard.
Ce n’est sans doute pas un hasard si, en communication et en marketing, un persona est une représentation fictive de la cible idéale, qui peut endosser tous les rôles, tour à tour.
Afin, d’illustrer encore cette Mise en scène de la vie quotidienne (1974), Erving Goffman postule que notre vie sociale est semblable à un théâtre où chaque individu endosse divers rôles, selon le contexte et l’audience, dans une série incessante de performances. Et ces « performances » sont méticuleusement mises en scène pour projeter une image de soi désirée, influençant ainsi la manière dont nous sommes perçus par les autres et donner du sens à nos expériences sociales.

Rencontres fortuites, échanges de paroles, de regards, de coups, de mimiques, de mots, actions et réactions, stratégies furtives et rapides, combats ignorés de ceux-là mêmes qui se les livrent avec l’acharnement le plus vif, telle est la matière première qui constitue l’objet, inhabituel, de La Présentation de soi. Pour ordonner ces miettes de vie sociale – résiduelles pour la sociologie canonique qui les néglige – sur lesquelles il concentre l’attention la plus minutieuse, Goffman prend le parti de soumettre à l’épreuve de l’explicitation méthodique une intuition du sens commun : Le monde est un théâtre. Le vocabulaire dramaturgique lui fournit les mots à partir desquels il construit le système des concepts propre à abstraire de la substance des interactions quotidiennes, extérieurement dissemblables, les formes constantes qui leur confèrent stabilité, régularité et sens. Ce faisant, Goffman élabore dès La Présentation de soi, son premier livre, les instruments conceptuels et techniques à partir desquels s’engendre une des œuvres les plus fécondes de la sociologie contemporaine et qui sont peut-être aussi au principe de la constitution des catégories fondamentales d’une nouvelle école de pensée : en rompant avec le positivisme de la sociologie quantitative en sa forme routinisée et en s’accordant pour tâche de réaliser une ethnographie de la vie quotidienne dans nos sociétés, La Présentation de soi peut être tenu pour un des ouvrages qui sont au fondement du courant interactionniste et, plus généralement, de la nouvelle sociologie américaine. Source : éditions de Minuit.
Alors, au risque de poursuivre dans le truisme ou la lapalissade, actons une fois pour toutes cette prédisposition humaine pour les histoires qu’on (se) raconte, que nous structurons et qui nous façonnent en retour. À moins que ce ne soit l’inverse. Puis, qu’importe, tant que nous avons conscience des mécanismes à l’oeuvre. Car c’est bien de cela dont il s’agit : de ne pas devenir les pantins désoeuvrés et manipulés par les histoires qu’on nous raconte.
Dans Penser la trivialité : La vie triviale des êtres culturels (2008), Yves Jeanneret s’intéresse justement à la manière dont les objets culturels sont consommés, utilisés et intégrés dans nos pratiques quotidiennes. Son concept, la trivialité, dans ce contexte, désigne la transformation d’un objet culturel ou technologique en un élément banal et routinier de notre environnement. Ce processus de trivialisation fait que l’objet perd son caractère exceptionnel pour devenir une partie intégrante de la vie quotidienne, sans que l’on ne s’interroge plus sur sa signification profonde ou sur les implications de son usage. Il en va de même pour les narrations. Just do it ! Think different !

Les idées circulent dans la société. Ce phénomène, auquel nous ne prenons pas garde tant il paraît naturel, est en réalité d’une grande complexité. En traversant les espaces sociaux, nos savoirs et nos oeuvres se transforment et se chargent de valeur. Cet ouvrage analyse les fondements de la trivialité et étudie méthodiquement les modèles de la circulation des objets culturels, les disciplines de la transmission ou les phénomènes d’appropriation. Une telle analyse débouche aussi sur une conception renouvelée des processus d’information-communication et sur un réexamen de notions essentielles pour l’analyse des sociétés. Aussi, La vie triviale des êtres culturels est-il, plus largement, un plaidoyer pour le fait de donner, dans les sciences anthroposociales, une priorité à l’élaboration intellectuelle des objets dans un monde qui privilégie les considérations utilitaires et tacticiennes. Source : éditions Lavoisier.
Fort à propos, afin de nous procurer une illustration de choix, les Jeunes avec Macron (JAM) ont présenté, pas plus tard que ce week-end, leur affiche de campagne pour les européennes. Que penser de cette affiche toute fraîche, qui reprend le logo et le slogan d’Apple remis au goût du jour : « Think different, renew Europe » ?

Nouvelle affiche de Renew Europe, qui a vocation à être diffusée dans l’Europe entière.
Prenons un autre exemple, avec la figure du clandestin nationaliste corse en armes, qui se retrouve innocemment sur des tatouages vendus aux touristes et aux enfants. En terme d’attractivité territoriale, que raconte désormais cette figure banalisée du clandestin – devenue marchandise – qui auparavant incarnait la violence des actions inscrites dans la représentation du territoire ? « Ici, on défend nos particularismes » ? Cela ne manque pas d’interroger.

« J’ai fait ça comme ça. Je trouvais ça drôle. C’est pour les enfants. Les touristes adorent. » La responsable de la boutique du Musée de la Corse (2022).
Jeanneret nous encourage donc à porter un regard critique sur notre environnement culturel et technologique, rappelant que ce qui nous semble évident et banal est en fait le résultat d’un processus complexe d’adoption et d’adaptation.
De plus, si l’on éprouve quelque peu, parfois, le sentiment d’être pris pour des idiots, n’est-ce pas bon signe – de vigilance ?
Dans L’invention du quotidien (1980), Michel de Certeau soutient que les individus ne sont pas simplement passifs face à leur environnement, mais qu’ils développent des tactiques pour s’approprier l’espace et le temps de manière créative, contournant ainsi les normes imposées par la société. Ces tactiques sont ancrées dans les pratiques culturelles, la consommation, la marche et la manière dont les individus négocient leur identité ou leur pouvoir, au sein de structures sociales plus larges. Son ouvrage met en avant la créativité et la résistance silencieuse des individus dans leur vie quotidienne. Plutôt rassurant.
Aussi, on pourrait imaginer que le storytelling n’est pas seulement à sens unique et que les individus utilisent leurs « arts de faire » pour résister et réécrire les récits imposés, révélant ainsi le potentiel de subversion et de réinvention des imaginaires.

La Raison technicienne croit savoir comment organiser au mieux les choses et les gens, assignant à chacun une place, un rôle, des produits à consommer. Mais l’homme ordinaire se soustrait en silence à cette conformation. Il invente le quotidien grâce aux arts de faire, ruses subtiles, tactiques de résistance par lesquelles il détourne les objets et les codes, se réapproprie l’espace et l’usage à sa façon. Tours et traverses, manières de faire des coups, astuces de chasseurs, mobilités, mises en récit et trouvailles de mots, mille pratiques inventives prouvent, à qui sait les voir, que la foule sans qualité n’est pas obéissante et passive, mais pratique l’écart dans l’usage des produits imposés, dans une liberté buissonnière par laquelle chacun tâche de vivre au mieux l’ordre social et la violence des choses.
Michel de Certeau, le premier, restitua les ruses anonymes des arts de faire, cet art de vivre la société de consommation. Vite devenues classiques, ses analyses pionnières ont inspiré historiens, philosophes et sociologues. Source : éditions Gallimard.
Partir du constat que chaque récit est, de fait, une (re)construction – donc une fiction ? – du Réel devrait permettre d’être plus « compréhensifs », face au fait que l’authenticité puisse être mise service de la mobilisation et de l’engagement des publics et que les émotions convoquées puissent parfois orienter les individus inattentifs ou non-avertis.
Toutefois, serait-ce vraiment naïf de penser que les récits pourraient également être utilisés à bon escient, dans une approche respectueuse et dans l’intérêt général ? Servir à informer, enseigner, donner à réfléchir, questionner ?
Il serait sans doute encore plus utopique de penser que ce contexte – qui se prête toujours à plus de vigilance face à la désinformation, la mésinformation, la malinformation, et autres maux conjoncturels, mais également à l’information – sera peut-être l’occasion d’un revival de l’esprit critique et de la zététique – oui, avec un « z », comme dans Zorro.
Questionner les processus de médiation, de trivialisation et apprendre à reconnaître comment ils influencent notre compréhension du monde, ainsi que nos interactions au sein de celui-ci – comme le suggérait Jeanneret dans sa Critique de la trivialité (2014) – serait sûrement une bonne gymnastique pour chacun d’entre nous.
Les communicants ont la responsabilité de forger des récits qui respectent et valorisent l’intelligence de leur audience et, à défaut, de transmettre et d’élever, d’emmener plus loin, en contribuant à construire des imaginaires qui font sens dans notre société.
Dans ce dialogue entre pouvoir narratif et responsabilité éthique, se dessine un appel à la conscience de chaque (ra)conteur. C’est pourquoi, raconter des histoires et non des salades, devient l’impératif de tout communicant et de tout producteur de signe, soucieux de contribuer utilement à la narration du monde dans lequel il s’inscrit. Car la mise en récit n’est pas qu’un simple cliché photographique reproduisant servilement une réalité : elle participe également à la construction de cette dernière.