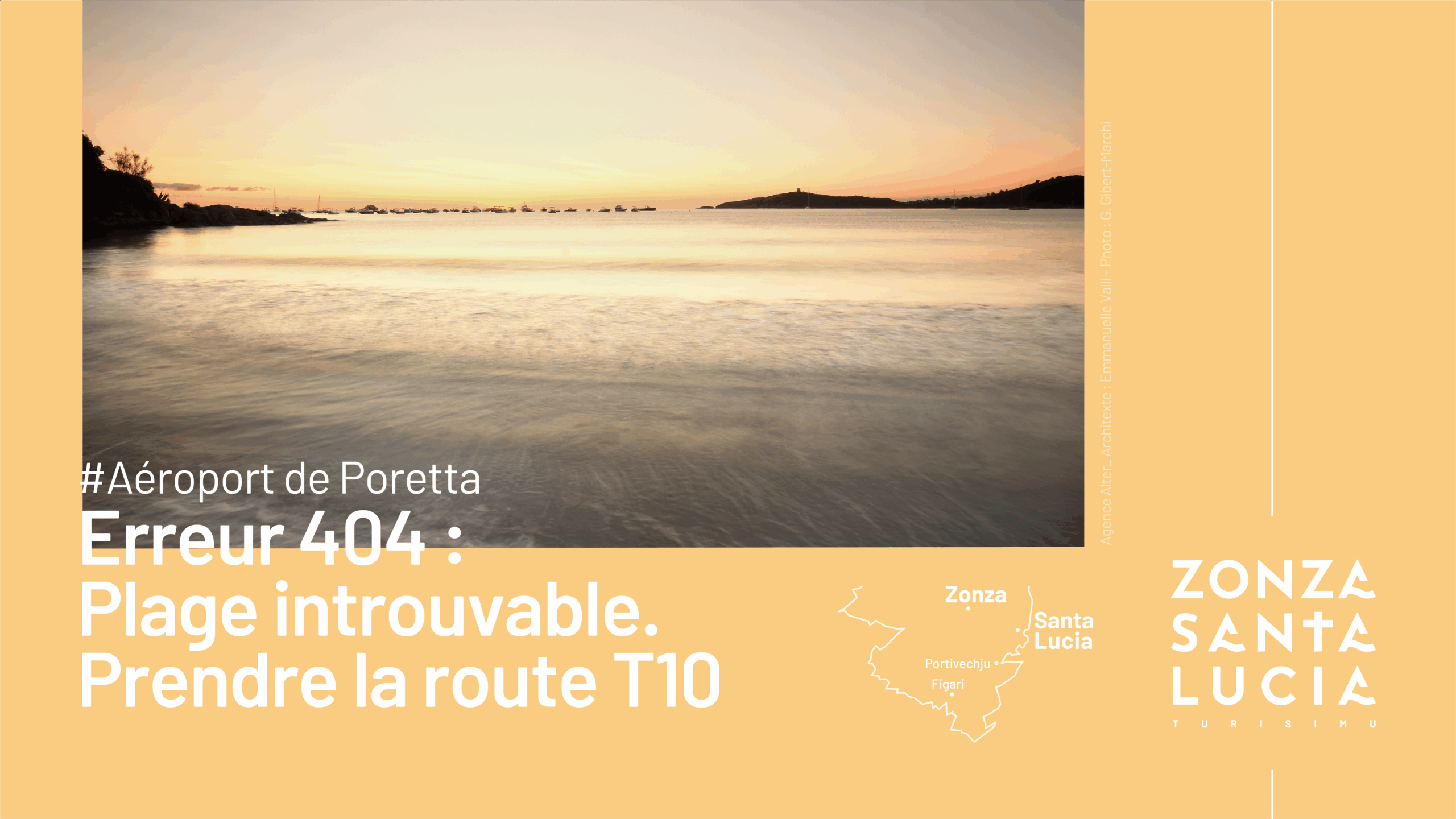Cette année encore, la Saint-Valentin fait son retour dans les campagnes de communication et c’est souvent une punition, pour les journalistes et les communicants.
En effet, trouver quelque chose à ajouter, qui n’aurait pas déjà été dit sur le sujet, relève du défi, tant les clichés sont abondants, entre ceux qui alimentent la norme sociale et ceux qui cassent les codes de la mignonnerie. C’est à ne plus savoir à quel saint se vouer, sinon à ce Valentin.
Par ailleurs, on trouve diverses explications, quant aux origines de cette fête : il serait question de traditions païennes dans la Rome antique – Lupercales -, de fertilité, de l’arrivée du printemps, de Saint Valentin, un prêtre martyrisé, au IIIe siècle, de jour spécifique où les oiseaux s’apparient, etc. La célébration des couples, qui prendrait naissance seulement à la fin des années 1950, constituerait une spécificité européenne car, deux mille ans durant, la Saint Valentin aurait été la fête des célibataires et de la rencontre.

Ces inséparables (Agapornis sp.) qui se bécotent sont, comme leur nom l’indique, connus pour vivre en couple pour la vie et pour être d’une fidélité à toute épreuve envers leur partenaire. Séparé de son double, un inséparable restera prostré dans sa cage et finira par se laisser mourir ou développer des troubles du comportement.
Difficile de démêler le vrai de l’extrapolation, dans la masse d’informations confuses, mais là n’est pas l’objectif de cet article.
D’un point de vue sémiotique, la Saint-Valentin est riche en symboles : Cupidon – l’idée de l’amour frappant de manière inattendue -, le coeur – signe universel de l’amour -, les fleurs, notamment les roses rouges, dont la couleur domine, et les chandelles – éclairage des dîners romantiques qui fait scintiller l’amour dans les regards. Il ne manque rien. Ou sans doute une playlist dans le [t’aime].
En terme de représentations, la fête illustre également l’évolution des normes sociales dans les relations amoureuses : initialement centrée sur l’expression discrète de l’amour, elle semble – dans certains pays – plus ouverte et inclusive, reconnaissant désormais divers types de relations et d’expressions des sentiments.

Cupidon est souvent représenté comme un jeune enfant ailé ou un adolescent. Il est la personnification de l’amour dans la mythologie romaine, équivalent à Éros dans la mythologie grecque. Fils de Venus – la déesse de l’amour et de la beauté – et de Mars – le dieu de la guerre. Armé de son arc et de ses flèches, Cupidon frappe les cœurs des dieux et des mortels, provoquant des désirs amoureux. Mais ses flèches possèdent deux effets opposés : les flèches dorées incitent l’amour, tandis que les flèches de plomb provoquent l’aversion. Il cependant davantage invoqué pour symboliser l’amour romantique et la Saint-Valentin.
Cependant, si d’aucuns sont sensibles aux démonstrations d’amour, à travers les clichés romantiques – surannés ? -, la Saint Valentin possède aussi son lot de détracteurs, qui voient en elle un pur produit de la société de consommation. De fait, économiquement, elle génère une activité commerciale conséquente, qui stimule encore les ventes dans de nombreux secteurs : fleuristes, bijouteries, restaurants et hôtellerie, notamment.
Les décors associés, saturés de rose « Barbie girl », de roses rouge passion en plastique, de nounours qui accompagnent les bouquets de fleurs ou la boîte de chocolats en coeur – ad nauseam – en deviennent souvent écœurants de kitsch et de mièvrerie. Tout autant que l’injonction sociale tacite de fêter l’amour à date fixe, en même temps que nos congénères. Il est donc légitime que ces dimensions soulèvent des interrogations quant à la sincérité de l’expression de l’amour et sur la pression sociale à participer à cette célébration collective de la surconsommation.

La fabrique des Mèmes peut offrir un support ludique de railleries valentinesques.
Certaines marques tirent encore leur épingle du jeu, en jouant la carte de l’humour ou l’autodérision, pour briser les traditionnels clichés associés à la Saint Valentin, d’autres ciblent des niches spécifiques, comme les célibataires ou les personnes en relations non conventionnelles. Si l’on peut louer la créativité de certaines d’entre elles, il n’en reste pas moins qu’elles participent, elles aussi, à cette incitation consumériste qui utilise l’amour comme prétexte.
L’honnêteté m’oblige à dévoiler l’opportunisme de ma démarche également, puisque j’écris sur le sujet aujourd’hui. Même si c’est dans le but d’en éclairer les mécanismes, il est tout de même un peu question de visibilité.

Y’a d’l’amour dans l’air ? L’air est normalement composé de différents gaz comme l’azote, l’oxygène, le dioxyde de carbone et l’argon. Il peut aussi contenir des substances nocives telles que les particules fines, les oxydes d’azote et le dioxyde de soufre. Mais l’amour n’en fait effectivement pas partie, au sens propre.
Jouer sur les [maux], au sens figuré, pour introduire un décalage pragmatico-humoristique, s’avère toujours assez efficace.
Aussi, la Saint Valentin semble être la fête qu’on aime détester mais – tout comme Halloween, la fête des Grands-Mères ou le Black Friday – elle demeure un sujet d’étude fascinant, par de multiples aspects : miroir des valeurs et des désirs, ses changements témoignent de l’évolution de nos sociétés. Elle révèle comment les traditions peuvent s’adapter, se réinventer, comment les symboles de l’amour sont réinterprétés à travers le prisme des normes sociales actuelles et comment le marketing peut à la fois influencer, autant que refléter et raconter ces dynamiques.
Le fantasme du dîner aux chandelles, pour la Saint-Valentin, n’est-ce pas finalement comme l’image d’Épinal de la famille idéale réunie autour du repas de Noël ? Ce qui est à vendre, n’est-ce pas l’idée du bonheur que voudrait incarner la « normalité » ?

La courbe de Gauss, également connue sous le nom de « courbe en cloche », correspond à la loi normale ou à la loi normale standard. Elle illustre la distribution dans laquelle la majorité des valeurs se regroupe autour de la moyenne (la norme), tandis que les écarts par rapport à cette moyenne, connus sous le nom d' »écarts types« , peuvent indiquer une performance supérieure à la norme ou une déviance.
Par ailleurs, d’après le sociologue Jean-Claude Kaufman, la Saint-Valentin serait interdite dans une trentaine de pays et, parfois même, menacée par des groupes violents. Le moindre petit cœur ou les couples se tenant par la main seraient traqués et les ours en peluche interdits en public, au Moyen-Orient, ce jour-là. 1001 stratagèmes sont alors ingénieusement imaginés par la jeunesse qui s’insurge, en cette occasion, pour contourner la censure, au nom d’une expression des sentiments et de la sexualité plus libres.
Au-delà de son interdiction, dans les pays où elle n’est pas réprimée, pourquoi et comment cette fête est-elle parvenue à s’inscrire dans le temps, jusqu’à dépasser sa marchandisation ? On pourrait entrevoir quelques pistes de compréhension – qui la relie à Noël ou à d’autres fêtes « marchandisées » – dans l’échange de cadeaux.
Si l’on peut parfaitement entendre la critique de la commercialisation de la Saint-Valentin, qui aurait transformé les symboles de l’amour en marchandises – créant chaque fois de nouveaux besoins Made in China, qui participent de l’expansion du 7ème continent – la question du cadeau est intéressante.
En effet, l’acte d’offrir n’a-t-il pas toujours été un langage en soi, pour exprimer son « attachement » ? Sans parler de la symbolique des bijoux comme les chaînes… pardon, les colliers – « passer la corde au cou » ? -, les bagues – baguer un pigeon ? – ou encore les bracelets – électroniques des prisonniers !
Plus sérieusement, la Cité des Présents (voir mon portfolio naming), à Château-Chinon, est une belle illustration de l’importance des présents dans les relations diplomatiques et, par extension, dans les relations humaines. Offrir un présent, ce n’est ni plus ni moins qu’être présent à l’autre et symboliser cette relation.

Le projet de Cité Muséale de Château-Chinon s’est dotée, il y a peu, d’un nouveau nom : la Cité des Présents. Le terme « présents » fait référence à la fois aux cadeaux diplomatiques et au temps, dont la mode et les cadeaux diplomatiques sont le reflet et l’allégorie. Ce nom invite les futurs visiteurs à appréhender les enjeux de société contemporains et à comprendre les temps actuels en voyageant aussi bien à travers les différentes époques qu’à travers les différents continents grâce aux deux collections : Arts et Diplomatie (anciennement Musée du Septennat) et Mode et Costumes (anciennement Musée du Costume).
C’est ce qu’illustre également Marcel Mauss, dans Essai sur le don (1924), où il avance que le don et le contre-don sont des mécanismes fondamentaux de cohésion sociale, dans les sociétés archaïques, mettant en lumière un système d’obligations réciproques – donner, recevoir, rendre – qui dépasse la simple transaction économique, afin d’entretenir des liens sociaux et affirmer les statuts. Ce cadre d’échange révèle comment les pratiques économiques sont intrinsèquement liées aux valeurs sociales et morales, influençant profondément les relations et la structure communautaire.
Ses conclusions peuvent, selon ses propres termes, « s’étendre à nos sociétés. Une partie considérable de notre morale et de notre vie elle-même stationne toujours dans cette même atmosphère du don, de l’obligation et de la liberté mêlés… Les choses ont encore une valeur de sentiment en plus de leur valeur vénale… Nous n’avons pas qu’une morale de marchands. »

Qu’est-ce qui nous pousse à donner, à recevoir ? Et surtout, qu’est-ce qui nous oblige à rendre en retour ? Pourquoi certains objets reçus nous paraissent-ils sacrés ? D’où vient la gêne souvent éprouvée lorsqu’on se fait offrir quelque chose ? Dans cet essai que Claude Lévi-Strauss jugeait « révolutionnaire », Marcel Mauss, le premier, dresse un portrait du « fait social total » qu’est le don, éclairant toutes les dimensions (religieuses, juridiques, économiques, morales etc.) de cet échange qui nous lie les uns aux autres. Grand livre de l’altruisme et de la coopération, l’Essai sur le don nous permet de penser ce que peut être une société de la réciprocité. Source : éditions Payot.
Plus tard, dans L’énigme du don (1996), Maurice Godelier dépasse l’analyse de Mauss, sur le don et le contre-don, en examinant leur rôle complexe dans les sociétés et ceux des biens inaliénables qui structurent les rapports sociaux sans être échangés. Il observe comment le don s’entrelace avec les dynamiques de pouvoir, de dette, et de sacrifice, offrant une perspective approfondie sur les fondements sociaux et économiques qui sous-tendent les échanges humains.

Pourquoi doit-on donner, pourquoi doit-on accepter ce que l’on vous donne, et, quand on a accepté, pourquoi faut-il rendre ? Cet ouvrage évalue le rôle et l’importance du don dans le fonctionnement des sociétés et dans la constitution du lien social. Le terrain, bien entendu, n’était pas vierge : Marcel Mauss, le premier, l’avait défriché allant jusqu’à avancer l’idée que si les choses données sont rendues c’est qu’il y a dans la chose donnée un esprit qui la pousse à revenir entre les mains de son donateur originaire. L’hypothèse valut à Mauss la critique sévère de Claude Lévi-Strauss, qui lui reprocha d’avoir pris une théorie indigène pour une théorie scientifique et d’avoir manqué de reconnaître pleinement le fait que la société humaine entière est échange et que pour en comprendre le sens il faut partir du symbolique et de sa primauté sur l’imaginaire et le réel.
La perspective générale adoptée par Maurice Godelier renouvelle profondément notre compréhension du don. Il analyse en effet les choses qu’on donne ou celles qu’on vend à partir des choses qu’on ne donne pas ou ne vend pas, des choses qu’on garde et que l’on doit garder, au premier rang desquelles les objets sacrés. Réanalysant les pratiques du potlatch et du kula sur lesquelles Mauss s’était appuyé, il montre que les énigmes auxquelles Mauss a été confronté se dissipent lorsque l’on comprend qu’il est tout à la fois possible de donner un objet et de le garder. Ce qui est donné, c’est le droit d’en user pour d’autres dons, ce qui est gardé c’est la propriété, inaliénable. Mais il faut encore expliquer pourquoi cette règle de droit s’applique aux objets précieux qu’on donne et non aux objets sacrés qu’on garde. La chose s’éclaire lorsqu’on fait apparaître ce qui est enfoui dans l’objet, l’imaginaire associé au pouvoir.
Il apparaît donc que toute société renferme deux ensembles de réalités : les unes, soustraites à l’échange, aux dons, au marché, constituent autant de point fixes nécessaires pour que les autres circulent. Et c’est précisément la redéfinition des ancrages fondamentaux du fait social qui constitue la tâche majeure de la pensée politique aujourd’hui. Source : éditions Fayard.
Alors, puisqu’il est question des « offrandes » de la Saint Valentin, quel est le lien entre l’amour et le don ? Qu’il s’agisse de don de soi ou d’échange de cadeaux.
Dans Encore, le livre XX de son séminaire, Jacques Lacan résume sa vision de l’amour, intimement lié à la notion de manque et au désir de l’Autre : « Aimer, c’est donner ce qu’on n’a pas à quelqu’un qui n’en veut pas ». Cette phrase encapsule l’idée que l’amour implique une quête de complétude à travers l’Autre, qui, de son côté, est lui-même marqué par un manque. L’amour, dans cette perspective, est donc une tentative de combler ce manque, non seulement en soi mais également dans l’Autre, bien que cet effort soit, par nature, voué à l’échec puisque, selon Lacan, le manque est constitutif du sujet humain.
En concentrant son approche sur ce manque, Lacan offre une perspective qui pourrait éclairer les dynamiques amoureuses et l’illusion consumériste, qui vend le rêve que l’on pourra être comblé – rempli – de bonheur par l’accumulation de marchandises.

Dans son observation des mécanismes de l’amour, Lacan souligne que l’amour implique souvent une idéalisation de l’Autre, où l’objet aimé est perçu à travers le prisme des propres désirs et besoins du sujet. Idéalisation qui conduit nécessairement à une certaine forme de méconnaissance, car l’amour en cherchant dans l’Autre ce qui manque en soi, attribue à l’Autre des qualités qui comblent ce vide intérieur.
Dans le cadre de sa théorie du stade du miroir et de la constitution du Moi, il postule que le désir est toujours le désir de l’Autre. Dans cette optique, l’amour et le désir sont profondément interconnectés, car tous deux naviguent autour de ce manque fondamental qui caractérise le sujet humain.
Par ailleurs, dans sa théorie du désir mimétique, René Girard suggère que les individus sont influencés, dans leurs désirs et leurs comportements, par ceux des autres. Selon lui, nous ne désirons pas seulement des objets en eux-mêmes, mais nous les désirons également parce que d’autres les désirent. Le désir mimétique résulterait donc d’une rivalité mimétique, où les individus imitent les désirs des autres et entrent en compétition pour les mêmes objets ; ce qui peut souvent mener à des conflits ou des crises.
Plus précisément, le « triangle mimétique » repose sur trois éléments fondamentaux : le sujet désirant, le modèle ou médiateur du désir, et l’objet désiré. Le sujet désirant est l’individu qui ressent le désir, influencé par le modèle ou le médiateur du désir, qui peut être une personne, un objet ou une idée. L’objet désiré est ce vers quoi le désir est dirigé.
Si ce triangle illustre comment les désirs sont façonnés et influencés par les interactions sociales ou les modèles de référence, on mesure aisément les conséquences et – une nouvelle fois – la responsabilité des communicants, jusque dans les campagne de promotion de la Saint Valentin et des représentations qu’elle exp(l)ose.

La « théorie mimétique », cœur de la pensée de René Girard, a connu ses derniers développements avec l’ouvrage de 2007, Achever Clausewitz. Elle englobe maintenant l’ensemble du champ anthropologique, de « l’apprentissage » par imitation à la menace de « l’apocalypse » nucléaire, en passant par les variations infinies du « désir mimétique ». Elle entre de ce fait en rivalité avec d’autres grandes hypothèses anthropologiques. Rédigé par les meilleurs spécialistes, le présent recueil engage pour la première fois cette confrontation globale de la « théorie mimétique » avec ses concurrentes : théories de la reconnaissance et de l’empathie (Honneth, Spinoza, Smith), existentialisme phénoménologique (Sartre), doctrine théologico-politique (Juan Donoso Cortés), théologie paulinienne de la foi, et catastrophisme contemporain (Günther Anders). Une contribution majeure à l’épistémologie des sciences humaines. Source : éditions PUF.
Achevons ce tour du manège de la Saint Valentin, avec La société de consommation : ses mythes, ses structures (1970), où Jean Baudrillard explore la manière dont la consommation est devenue centrale dans les sociétés modernes, non seulement comme un acte d’achat mais comme un moyen de communication et d’identification sociale.
Si l’on devait extrapoler ses idées à la Saint-Valentin, il serait aisé d’avancer que cette fête fonctionne comme un « simulacre« , où la signification originelle de l’amour et de l’intimité est remplacée par sa représentation, à travers des biens de consommation et des rituels commerciaux. Telle une sorte de manifestation de l’hyper-réalité, où l’image idéalisée de l’amour, promue par les médias et la publicité, devient plus réelle et désirable que l’expérience vécue de l’amour lui-même. D’autant que, d’après Philippe Breton – L’utopie de la communication1 (1992) -, nous serions des individus désormais plus communicants que « rencontrants« .
Aussi, la critique de Baudrillard sur la consommation comme système de signes où les objets sont investis de significations, au-delà de leur utilité pratique, peut également s’appliquer à la façon dont les cadeaux de la Saint-Valentin deviennent des symboles chargés de communiquer l’amour et l’affection, où cette valeur symbolique et sociale surpasse souvent la valeur matérielle de l’objet lui-même.

La consommation est devenue la morale de notre monde. Elle est en train de détruire les bases de l’être humain, c’est-à-dire l’équilibre que la pensée européenne, depuis les Grecs, a maintenu entre les racines mythologiques et le monde du logos.
L’auteur précise : « Comme la société du Moyen Âge s’équilibre sur la consommation et sur le diable, ainsi la nôtre s’équilibre sur la consommation et sur sa dénonciation. » Source : librairie Gallimard.
Ainsi, il semble important de rester vigilants devant la constante médiatisation et reconstruction des codes. L’exemple de la Saint Valentin, le démontre. D’autant plus à l’ère des réseaux sociaux, on constate qu’elle est loin d’être la fête anodine que l’on croit, car elle porte toujours en elle les germes des représentations autours desquelles se construisent les normes et également, par opposition, les subjectivités libératrices, qui font tintinnabuler la courbe en cloche (voir plus haut).
Alors, ne soyons pas fainéants et continuons de nous donner les moyens d’avoir des arguments dans nos (sens) critiques.
Et vous, vous êtes plutôt sans ou saint Valentin ? Plutôt érotomane ou eurotomane ?
De mon côté, une question me taraude : le « réarmement démographique » trouvera-t-il une place audacieuse ou prévisible, dans les campagnes de cette année ?
En bonus, vous trouverez ci-après un petit florilège. Et si vous ne savez pas quoi faire pour la Saint Valentin, vous trouverez aussi d’autres articles sur le blog désaltérant.





































- Article à venir. Un jour. ↩︎