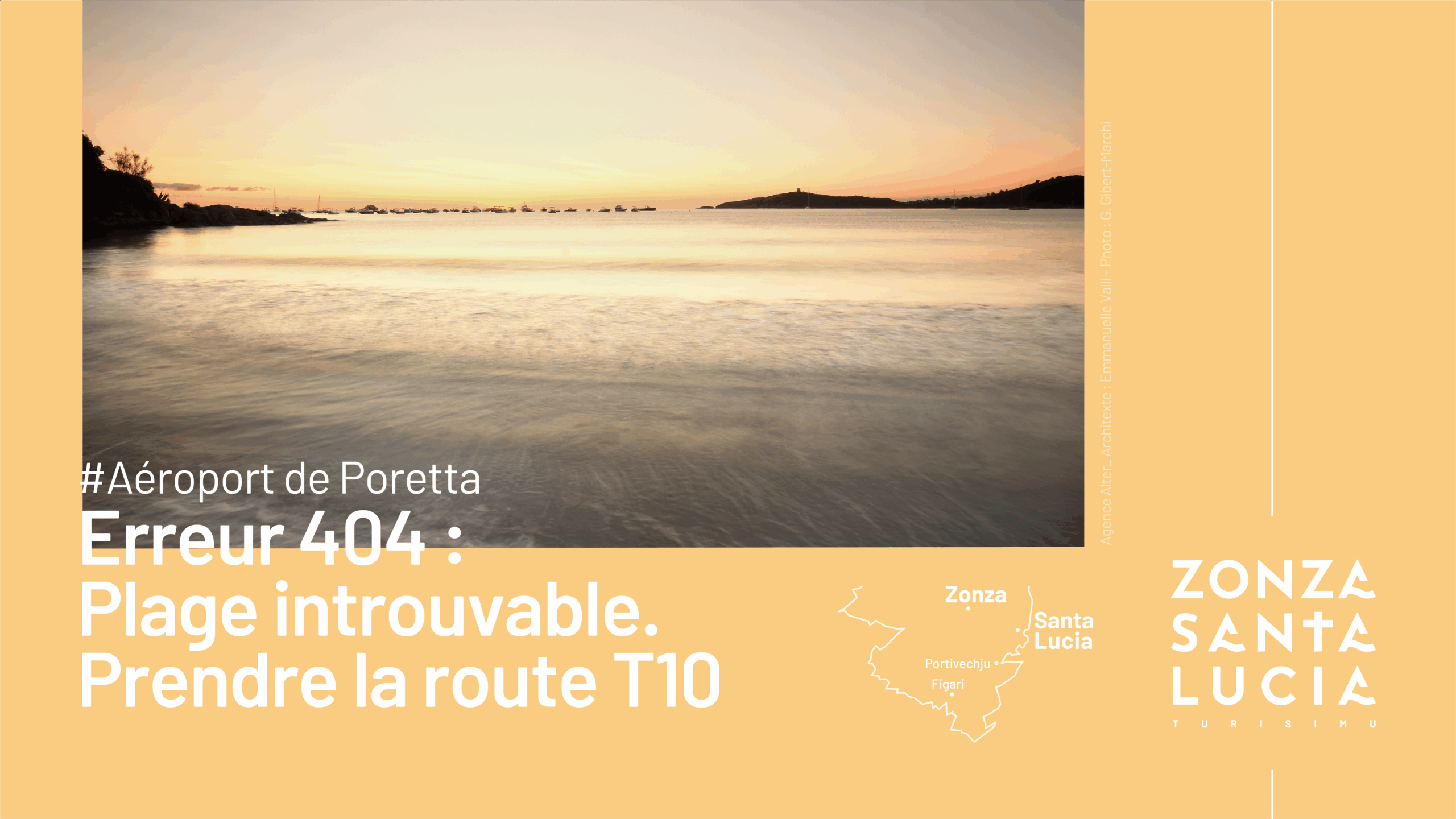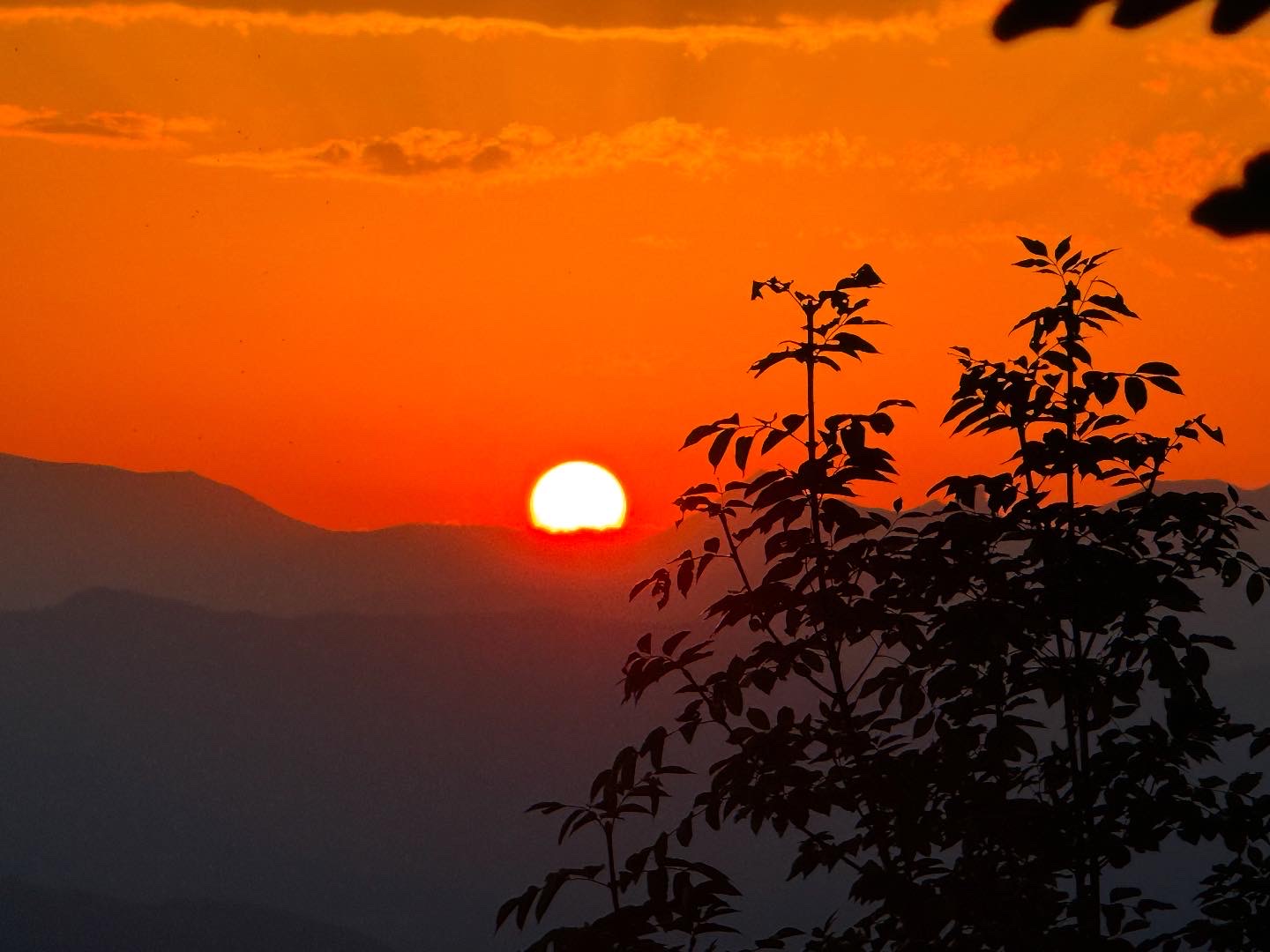Je viens d’un tout petit village, dans le rural. Je suis Corse – oui, la Corse est une île, mais cela n’exclut pas le rural. Je suis Française. Européenne. Citoyenne du monde.
Je parle corse, français, espagnol, italien, anglais – avec un accent déplorable. Je lis toutes les littératures du monde qui me sont accessibles par la traduction. J’ai coutume de dire que je n’aime pas les gens, par provocation. Je n’aime pas la masse grégaire qui se range confortablement derrière le raisonnement le plus simpliste, parce que c’est plus facile à vivre que l’intranquillité d’une question qui ne possède pas forcément de réponse immédiate pour permettre de mieux dormir.
Depuis que j’ai sorti la tête hors de l’utérus maternel – dans un milieu social modeste qui m’a cependant permis d’avoir très tôt accès à la lecture – je suis amoureuse de l’Autre, des différences et du fait que tout le monde ne me ressemble pas.
Enfant, j’ai pu rencontrer des gens qui portaient des boucles de ceinture en croix gammées, membres de l’OAS condamnés par contumace, électeurs du FN – puis du RN sans que l’air y soit moins vicié -, des gens qui disaient « sale arabe », des gens violents, des gens empêchés, des gens dont le vide de la pensée avait permis à l’étroitesse intellectuelle de s’installer.

[Toute ressemblance de l’enfant insolente de cette photo avec une personne que vous (re)connaissez n’est pas fortuite]
Je suis Corse. Je suis Française. Européenne. Citoyenne du monde.
Et tellement d’autres choses que j’ignore encore, qui restent à découvrir.
Je tente chaque jour d’être moi, avec des hauts et des bas. De gauche, adroite, tant que faire se peut avec les déterminismes qui m’ont forgée et avec ceux que j’ai tenté de déconstruire, avec des livres et des rencontres.
Je suis dépositaire de l’éthique et des valeurs humaines de respect, de générosité et de partage transmises par mes grands-parents. Corses mais avant tout – et plus que tout autre classification identitaire – « humains ». Je suis dépositaire de ces valeurs, parce que je les choisis, en tant que Sujet responsable, pour constituer mon « identité narrative ».
« On s’en tape », me direz-vous ? « Les réseaux sociaux ne sont pas faits pour partager sa “petite affaire privée” ». Peu vous chaut que je sois tout ça ou autre chose, que je préfère la glace à la vanille à celle au chocolat ? Merci d’exister. C’est très rassurant. Pour autant, cela va plus loin que ma petite histoire, c’est pourquoi je fais le choix de poursuivre.
Un article du Corse-Matin de Ghjilormu Padovani, en date du 27 février 2025, intitulé « Ajaccio : un chauffeur de bus menacé de mort, le réseau fortement perturbé » a suscité de nombreux commentaires sous la publication Facebook du quotidien.
Ainsi, l’article évoque que « pour avoir refusé de faire monter un homme hors arrêt de bus, un chauffeur a été agressé verbalement et menacé de mort. L’agresseur serait issu d’une famille bien connue de la justice résidant aux Terrasses du parc à l’Atrium ».
Cédric Faure, représentant STC de la Muvitarra – réseau de transports – dénonce « des comportements dignes du 9-3 : Nous constatons tous les jours que la population et les comportements ont changé, les agressions se multiplient. En Corse, les chauffeurs sont comme ailleurs, on n’est plus en sécurité. Au-delà de ce cas, tous les jours, nous avons des problèmes avec des marginaux et des nouveaux arrivants. »
Si l’on sait que les réseaux sociaux n’expriment pas l’intégralité des points de vue, toutefois, ces points de vue-là interpellent – lorsqu’on les met en perspective avec les résultats des dernières législatives – et se diffusent, transportant avec eux leurs déjections de haine de l’Autre et balayant tout sur le passage de l’amalgame et des généralités.
Et voilà que je me trouve face à un florilège « abjectivement » vomitif de l’échec de la raison. Certes, je n’étais pas forcée de lire, cependant ces commentaires renseignent sur certaines tendances et leurs auteurs s’expriment également par les urnes. Il en ressort une forte inquiétude identitaire et sécuritaire, teintée de xénophobie – « petit à petit on est dilués » – et de nostalgie pour un passé idéalisé de la Corse. Un sentiment de déclin et de menace culturelle domine, où la Corse est présentée comme une société assiégée en pleine déchéance, menacée par des « nouveaux arrivants » assimilés indistinctement aux immigrés, aux Français du Continent et aux « jeunes wesh-wesh ». Cette rhétorique repose sur des généralisations abusives, des amalgames et une vision caricaturale des mutations sociales, réduites à un schéma binaire opposant un passé idéalisé à un présent chaotique. L’étranger y est systématiquement désignée comme la cause principale de la montée de l’insécurité, tandis que les élus locaux sont accusés de complicité avec un « système » laxiste et corrompu. On observe également une tentation autoritaire, voire mafieuse, dans plusieurs commentaires appelant au retour de la violence extrajudiciaire, au rétablissement de l’ordre par la force et au rejet pur et simple des nouveaux arrivants. Ce fantasme d’une Corse « pure », réclamant un retour à un ordre moral strict, rappelle des logiques identitaires excluantes, où la criminalité et la perte de valeurs ne seraient pas des phénomènes sociaux complexes, mais uniquement le fruit d’une influence extérieure néfaste. Si certains intervenants appellent à la nuance en rappelant que la violence existait avant et que la situation n’est pas aussi simpliste, ces voix restent minoritaires face à une vague de déclinisme radical, où l’on semble se complaire dans un récit victimaire, plutôt que d’interroger avec lucidité les dynamiques socio-économiques et politiques réelles qui façonnent la Corse d’aujourd’hui.
En somme, si cette frange de la population – qui est, hélas, la plus logorrhéique – veut se distinguer du Continent, cela semble raté car elle s’inscrit bien, au vu de la majorité des commentaires, dans la tendance générale bleue Marine de la haine de l’Autre qui considère que le problème de la violence est exogène. C’est évidemment – comme nous le verrons plus loin – une manière simple de résoudre les problèmes. Exemple : Trump désigne un bouc émissaire – les migrants – et hop ! tout est réglé en les expédiant ailleurs. Du moins, se plait-il à le faire croire, car il s’agit bien de croyances et non de pensée rationnelle appuyée par des arguments concrets et des chiffres avérés.

Afin de contrebalancer ces stratégies de destruction massive de la raison, je conseille vivement la lecture de cet ouvrage fondamental – pour ne pas dire vital – dans les contextes d’austérité intellectuelle : « On ne peut pas accueillir toute la misère du monde » : En finir avec une sentence de mort (Éditions Anamosa, 2021), de Pierre Tevanian et Jean-Charles Stevens.
« On ne peut pas accueillir toute la misère du monde » : qui n’a jamais entendu cette phrase au statut presque proverbial, énoncée toujours pour justifier le repli, la restriction, la fin de non-recevoir et la répression ? Dix mots qui tombent comme un couperet, et qui sont devenus l’horizon indépassable de tout débat « raisonnable » sur les migrations. Comment y répondre ? C’est toute la question de cet essai incisif, qui propose une lecture critique, mot à mot, de cette sentence, afin de pointer et réfuter les sophismes et les contre-vérités qui la sous-tendent. Arguments, chiffres et références à l’appui, il s’agit en somme de déconstruire et de défaire une « xénophobie autorisée », mais aussi de réaffirmer la nécessité de l’hospitalité.
J’ai découvert ce texte, lors d’un Samedi des Idées – 16 novembre 2024 –, à la Villa Gillet, à travers une lecture passionnante de morceaux choisis par Sébastien Valignat – Compagnie Cassandre – et Inès Guiollot. Depuis lors, je l’offre comme on offre des fleurs en espérant propager un peu d’oxygène et éviter l’asphyxie. Voici, en substance les passages les plus saillants. J’espère que les auteurs ne me tiendront pas rigueur d’avoir dévoilé une si importante partie de leur texte, sans leur consentement (que je vais tacher d’obtenir rapidement !).

UNE SENTENCE DE MORT
Proférés pour clore toute discussion, ces dix mots semblent constituer l’horizon indépassable de tout débat sur les migrations. […] ils tombent comme un couperet pour justifier toujours le « contrôle » et la « maîtrise » des « flux migratoires » – c’est-à-dire […] : le refus, la restriction, la fin de non-recevoir et la répression. En ce sens, ils constituent bien ce qu’on appelle une sentence, dans les deux sens du mot : une simple phrase tout d’abord, exprimant une pensée de manière concise et dogmatique, sans développement argumentatif, mais aussi un verdict, une condamnation, prononcée par une autorité à l’encontre d’un ou d’une accusé.e.
[…] Nous soutenons pour notre part que cette phrase est profondément xénophobe et, à ce titre, moralement et politiquement problématique. Nous soutenons également qu’elle repose sur de nombreux sophismes, que nous entendons déconstruire ici.
[…] Ce que nous combattons n’est pas une raison pure mais une rationalité particulière, mêlée – pour ne pas dire asservie – à un ensemble d’affects, à commencer par la soif de pouvoir et la peur de « l’étranger ». Et ce que nous y opposons, en positif, est tout simplement une autre rationalité, nourrie de travaux scientifiques, soucieuse de véracité quant aux faits invoqués, et de cohérence logique dans les conclusions que nous en tirons, mais une rationalité qui n’en est pas moins, elle aussi, guidée par des affects. La différence et le différend résident simplement dans la nature des affects investis. S’il faut nommer ces ressorts intimes et affectifs qui guident notre entreprise, motivent notre réflexion et nous imposent la rigueur dans le raisonnement, disons qu’il s’agit d’une sympathie pour des frères et sœurs humains, d’une colère contre une oppression, mais aussi d’un certain besoin d’estime de soi, lui-même corrélé à une certaine idée de la citoyenneté, de l’hospitalité, de la solidarité, de l’égalité et de la justice.
ON
Le tout premier mot pose déjà problème: qui est ce « on », faussement indéfini ? Ou ce « nous », dans certaines variantes de la même phrase ? C’est bien évidemment la personne qui prononce ou écrit la phrase. Mais le « on » va justement plus loin qu’un « je », il renvoie bien à un « nous »: une ou plusieurs personnes, sans qu’il soit possible de savoir qui exactement. Nous voici donc face à une première entourloupe, très classique en politique : plutôt que de dire « je », et d’assumer seule, avec l’unique force des arguments rationnels, un choix politique éminemment critiquable, celui en l’occurrence de la fermeture des frontières, du maintien de la forteresse Europe et de la chasse aux sans-papiers, ruineuse économiquement et criminelle moralement, le « nous » permet d’une part de diluer la responsabilité, d’autre part de « faire masse », d’intimider l’in-terlocteur trice et enfin de l’amadouer.
Le « nous » désigne en effet, grammaticalement, un ensemble formé par un « vous » et un « moi ». Le sujet qui prononce le « nous » embarque donc son destinataire avec lui, immédiatement et directement.
Il s’adresse à des personnes avec lesquelles il s’identifie et crée de ce fait une communauté, de manière immédiate, implicite, performative – et, il faut bien l’avouer : expéditive.
Ce « nous gouvernemental » est en fait abusif à deux égards. Il est abusivement inclusif, en ce sens qu’il postule un consensus, une communauté de situation, d’intérêt et donc de destin qui n’existe pas, en enrôlant de force toute la nation derrière un choix politique qui est tout ce qu’il y a de plus singulier et litigieux, et qui est le fait d’une toute petite caste (comme le font également les fameux « Nous traversons une période difficile » et « Nous allons devoir faire des sacrifices », énoncés par des dirigeants qui ne souffrent en rien des crises économiques, et moins encore des politiques d’« austérité » qu’ils imposent en réponse auxdites crises).
Ce « nous » est aussi abusivement exclusif, dans la mesure où la communauté qu’il postule, aussi vaste soit elle, est malgré tout définie par un contour qui indique un dehors, une altérité exclue du « nous ».
« Nous » signifie en effet « je et tu », ou « je et vous », en tout cas « moi et des autres », mais pas – ou très rarement – moi et tous les autres. Le « nous » se distingue du « je », mais il s’oppose aussi, presque toujours, à un « eux ». Le contenu de ce « eux» peut être plus ou moins explicite ou implicite, mais le « nous » construit toujours un dispositif à trois termes : moi ; les autres que j’associe à moi, et qui sont donc, sous des modalités variables, pour une raison ou pour une autre, « les miens » ; et enfin les autres autres, les autres qui ne sont pas « les miens », que « je » n’inclus donc pas dans le « nous », mais plutôt dans un « eux ».
Ces autres autres dont « je » parle – ou dont « nous » parlons – à la troisième personne ne sont ni des sujets parlants (« je » ou « nous »), ni des destinataires de notre parole (« tu » ou « vous »), mais de purs objets parlés (« eux »). Ce sont en outre des objets parlés en leur absence, donc sans possibilité matérielle de répondre et d’être entendus – ce qui ouvre bien entendu sur une violence possible.
Tout cela est en fait de bonne guerre politique, chaque « camp » créant son « nous » en opposition à un « eux » à combattre. Nous les bons contre eux les mauvais, nous les vrais contre eux les faux, ou plus précisément, dans la pensée de gauche : nous les travailleurs exploités contre eux les bourgeois exploiteurs. Ou, dans les pensées nationalistes et racistes : nous les Français ou nous les Belges contre eux les étrangers, nous les bons Français ou les bons Belges contre eux les mauvais, nous les « autochtones » contre eux les « allochtones », nous les « Français de souche » contre eux les « Français de papier ».
Le « nous », « première personne du pluriel », porte donc bien son nom : il permet de trancher à vif dans la pluralité humaine pour y introduire du classement, de la hiérarchie, de la préférence : du « premier » dans le « pluriel ». « Nous », c’est autre chose qu’un « moi et toi et lui et elle » qui se déclinerait à l’infini, et désignerait l’humanité ordinaire, l’ensemble de toutes les singularités quelconques, différentes et égales. « Nous » signifie plutôt: « moi, et toi, et lui, et elle, et pas lui, et pas elle ».
Or, à l’évidence, le « nous » de « nous ne pouvons pas accueillir toute la misère du monde » renvoie à une collectivité qui est nationale. Il désigne l’ensemble des « nationaux » : les Français.es, les Belges, ou tout autre citoyen.ne d’un pays d’immigration prononçant la fameuse phrase – et le « eux » auquel il renvoie désigne donc les personnes étrangères. Ce « nous » national est en somme, qu’on l’assume ou non, une expression de la « préférence nationale » chère à tous les xénophobes – dans la mesure où il exprime une vision du monde social très particulière, avec un parti pris très particulier dans la désignation de l’ennemi et de l’ami ou de l’allié : plutôt que l’union de « nous les opprimées », toutes nationalités confondues, contre « eux les oppresseurs », toutes nationalités confondues, plutôt que « nous les antiracistes » contre « eux les racistes », c’est une union sacrée de tous les nationaux (riches et pauvres, dominantes et dominé.es, démocrates et antidémocrates) qui est invoquée, contre une masse d’étrangers.
NE PEUT PAS
Le verbe « pouvoir » renvoie à deux notions : la possibilité et l’autorisation. « Ne pas pouvoir », c’est faire face à une impossibilité ou à un interdit. Ce qui renvoie à un choix restreint, voire « forcé » (l’interdit renvoyant à une sanction en cas de « mauvais choix »), ou à une absence de choix (une option impossible ne pouvant par définition pas être choisie, ou du moins pas réalisée jusqu’à son terme).
Il y a là, bien évidemment, un nouveau coup de force rhétorique, là encore dans le sens d’une déresponsabilisation. La responsabilité de la fermeture des frontières, du quasi-démantèlement de l’asile et des milliers de morts que ces politiques engendrent, n’est pas seulement diluée dans un « nous » indéfini, elle est purement et simplement niée, dans la mesure où le choix politique n’est pas assumé comme tel, mais présenté au contraire comme la simple reconnaissance et le simple accompagnement d’une stricte nécessité. Nul n’étant tenu à l’impossible, il apparaît dès lors illégitime de demander le moindre compte et la moindre remise en question.
Ladite impossibilité est présentée comme un état de fait, une donnée incontestable face à laquelle il n’y a rien qui puisse s’opposer, et sur laquelle il n’y a pas de maîtrise possible. Il n’y a plus une question politique, sur laquelle plusieurs réponses peuvent être apportées, et sur laquelle un débat citoyen peut avoir lieu : il s’agit plutôt de clore toute discussion, en prétendant affirmer une vérité incontestée et incontestable. « Nous ne pouvons pas » vient, en somme, en lieu et place de « Je ne veux pas », et permet de sauver les apparences de la volonté bonne, de l’intention pure, du petit cœur humaniste – chrétien, de gauche, ou les deux – qui bat sous l’armure bleu marine du ministre ou du président « réaliste ». Cet artifice rhétorique, consistant à simuler l’impuissance, l’incapacité (« on aimerait bien, mais on ne peut pas »), est d’autant plus odieux qu’il est utilisé par des dirigeants qui sont en général arrivés au pouvoir en faisant campagne sur le refus de « l’immobilisme » et du « fatalisme », et en nous expliquant qu’avec « de la volonté politique », « tout est possible ».
[…] les faits nous montrent ceci : ledit « accueil » de ladite « misère du monde » est de l’ordre du possible, il est même réalisé de facto, et pour sa plus grande part il l’est par des pays dont la puissance économique n’est absolument pas supérieure à la « nôtre ».
Pour le dire plus crûment, il est tout de même problématique – et, si l’on peut se permettre, indécent – d’invoquer l’impuissance économique lorsque, comme la France de 2022, on est – selon le classement du FMI – la deuxième puissance économique européenne et la sixième puissance économique mondiale. […]
ACCUEILLIR
Venons-en maintenant au verbe « accueillir », employé jusqu’ici par commodité, mais lui-même piégé, dans la mesure où il peut renvoyer à des réalités tout à fait diverses, et permet donc à nos orateurs quelques glissades rhétoriques tout à fait spécieuses. En effet, ce verbe est utilisé couramment dans les institutions internationales pour désigner la simple présence d’immigrants sur un territoire donné (« accueillir » est alors à entendre au sens de « compter sur son territoire »). Il possède aussi un sens plus « actif », en désignant une politique publique, consistant à accorder à ces immigrants un statut et des droits afférents. Il est enfin utilisé dans la langue courante, avec une charge affective plus forte et une connotation plus positive, pour exprimer une conception bien plus exigeante et engageante de l’hospitalité : recevoir « comme il faut », souhaiter la bienvenue, prendre soin, voire héberger chez soi.
[…] En choisissant de tels mots (« accueillir », « héberger »), on laisse la métaphore domestique s’inviter dans les esprits, en écho au « nous » très « impliquant » qui ouvre la phrase (« nous » accueillons des étrangers « chez nous »), avec tous les glissements politiques funestes que cela peut entraîner – du sinistre « On est chez nous ! », cri de ralliement de toutes les meutes fascistes (des meetings lepénistes et zemmouristes aux crimes de sang à caractère raciste comme le meurtre du rugbyman Federico Martín Aramburú), aux édifiantes sorties de nos ministres de l’Intérieur, dont la plus illustre est sans doute celle de Jean-Louis Debré en 1997 : « Est-ce que vous acceptez que des étrangers viennent chez vous, s’installent chez vous et se servent dans votre frigidaire ? Non, bien évidemment ! Eh bien c’est pareil pour la France ».
Plus largement, si le pays est conçu comme une maison, les « nationaux » deviennent, en filant la métaphore, les uniques propriétaires ou locataires légitimes, et les résidents étrangers, fussent-ils installés, et titulaires d’un bail ou d’un titre de propriété, se retrouvent relégués au rang d’« invités », tenus de respecter de très dissymétriques « lois de l’hospitalité » – et donc soustraits au régime de l’égalité devant la loi commune.
Le refrain est connu, tous les leaders de l’extrême droite, mais aussi ceux de la droite de gouvernement, l’ont un jour entonné : que les belles âmes qui s’indignent et défendent les immigrés « les prennent chez eux » !
[…] Même si l’on ne joue pas cette sempiternelle rengaine xénophobe, le terme « accueillir » a ceci de spécieux qu’il travestit l’enjeu du débat en lançant une injonction effectivement ambitieuse (accueillir au sens fort, donc héberger et prendre soin, de personnes qui plus est présentées comme foncièrement « miséreuses », nous allons y venir) à un ensemble tellement flou (ce fameux « nous ») que chacun.e, notamment parmi les plus pauvres, peut se sentir effectivement dépassé.e, impuissant.e et donc tentée de « décliner l’offre » – le seul problème étant qu’il n’a jamais été question d’individuellement héberger et prendre en charge chaque « arrivant.e» mais de mener une politique publique, avec les moyens d’un État, celui d’un pays qui, répétons-le, se situe au sixième rang mondial en termes de richesse.
[…] À tous les Sarkozy, Hollande, Valls, Macron, Philippe, Castex, Castaner, Darmanin, Di Rupo, Michels, Wilmès, De Croo, Jambon, De Block, Francken ou Mahdi, et à toutes celles et ceux qui les soutiennent, à toutes celles et ceux qui ne font strictement rien pour aider ladite « misère du monde » et qui cachent leur abyssal égoïsme de nantis derrière un chimérique « principe de réalité », on serait tenté de répondre ceci : ne nous dites pas à « nous », peuples de France ou de Belgique, ce que nous « pouvons » ou ne « pouvons pas » faire, contentez-vous d’assumer vos incapacités. Dites que vous ne pouvez pas accueillir, ou mieux : que vous ne voulez pas – et si vous n’aimez pas la liberté de circulation, l’égalité des droits et la fraternité humaine, n’en dégoûtez pas les autres.
TOUTE
L’usage du mot « toute » renvoie à une totalité – et pas n’importe laquelle : le « monde », excusez du peu.
La ficelle rhétorique est grosse, là encore : il s’agit une fois de plus d’intimider, d’impressionner, de terrifier, d’attiser les phobies en produisant un sentiment de « submersion », d’« invasion », de « grand remplacement », au prix bien entendu d’un brouillage des enjeux et d’une caricature du point de vue adverse – puisqu’il est évident, dès qu’on prend le temps d’y réfléchir, que la question est proprement absurde et hors de propos, personne n’ayant jamais demandé ni à la France ni à la Belgique d’accorder asile et titres de séjours à la totalité des 281 millions de migrant.es de la planète. Pas même, pour commencer, lesdit.es migrant.es ! Il est bon en effet de le rappeler : vivre en France ou en Belgique n’est pas le rêve absolu de tou.te.s les personnes déplacées. La plupart cherchent et trouvent d’abord refuge en Afrique et au Moyen-Orient, dans des pays voisins des leurs, voire dans leur propre pays.
[…] Ce qui est demandé à des pays riches comme la France, la Belgique et l’ensemble des pays européens est simplement d’assurer à cette « totalité » un droit reconnu par des traités internationaux : le droit d’asile, et plus largement le droit de quitter son pays, et donc d’élire domicile et refaire sa vie dans un autre.
[…] Ce qui est certain, en revanche, c’est qu’un mensonge répété prend souvent des allures de vérité, et qu’un leitmotiv comme « toute la misère du monde » finit par produire des représentations, des fantasmes et des phobies. Une enquête réalisée en 2015 dans 33 pays a notamment montré que la proportion de migrants vivant sur les territoires nationaux concernés était systématiquement surévaluée par les sondés[…]. Avec les effets que l’on sait en termes de xénophobie décomplexée, pudiquement rebaptisée « inquiétude » ou « insécurité culturelle ».
Enfin, l’allusion à une « totalité » indésirable – ou, sous une forme euphémisée, « inassumable », « ingérable » – pose un autre problème. En « fermant la porte » à ladite totalité, on l’ouvre grand, en revanche, à l’une des pires dérives intellectuelles, éthiques et politiques : le tri, la sélection, les « quotas », l’« immigration choisie », « assimilable », et le règne de l’arbitraire ou des critères les plus douteux – comme la « qualité », le niveau « intellectuel » et le « profit » qu’on peut en tirer (approche utilitariste), ou encore la « loi de la proximité », le « voisinage », la « ressemblance » et l’affinité « culturelle » (approche culturaliste, identitaire, raciste). Pour le dire plus crûment, le « Pas toute » se décline soit en un « Pas la piétaille », soit en un « Pas la racaille », soit les deux.
[…] De ces savantes classifications, qui ne font que reformuler, sous une forme sublimée, une bonne grosse discrimination raciale bien sordide, le refus du « tout » est aussi comptable. Le mot « misère » est un substantif abstrait qui désigne un état, une condition dans laquelle se trouvent une ou plusieurs personnes, marquée par la privation, la précarité et/ou le malheur. Il n’est donc nullement fait mention de personnes, d’individus ou de groupes.
[…] La grande majorité des études scientifiques, des plus anciennes aux plus récentes, concernant l’impact de l’immigration sur l’activité et la croissance économique, sur l’emploi et les salaires des autochtones, sur l’équilibre des finances publiques, bref : sur la vie économique au sens large, ont montré que l’immigration est davantage une aubaine qu’une charge, et qu’on pourrait donc aussi bien parler de « la jeunesse du monde » ou de « la puissance du monde » que de sa « misère ». Pour commencer, l’ensemble des études chiffrées depuis des décennies a établi que ce n’est justement pas « la misère » qui émigre : au niveau mondial, les pays les plus pauvres constituent une faible part de l’émigration, et la proportion d’émigrant.es est beaucoup plus forte dans les pays à PIB intermédiaire. Au sein même de ces pays, ce ne sont pas non plus les franges de la population les plus « misérables » qui émigrent, mais plutôt les « couches moyennes ». Les migrant.es se situent rarement au plus bas de l’échelle sociale dans leurs pays d’origine, ils et elles sont même souvent au-dessus de la moyenne, tant en termes de capital économique qu’en termes de « capital culturel ». Ces personnes constituent en somme, par rapport aux autres habitant.es de la société d’origine, une population sélectionnée : plus jeune, en meilleure santé, plus diplômée, plus « entreprenante », dotée d’un minimum de ressources, ne serait-ce que pour payer le voyage et les frais d’installation.
[…] Ces études concluent toutes à un faible impact de l’immigration sur le marché du travail, qu’il s’agisse de l’emploi ou des salaires des autochtones.
[…] Il arrive d’ailleurs que des travaux parlementaires reconnaissent ce consensus scientifique, et déboulonnent eux aussi les idées reçues condescendantes ou phobiques sur le « poids » de « la misère du monde ».
C’est le cas par exemple d’un Rapport parlementaire rendu public le 22 janvier 2020 par deux députés français, Pierre-Henri Dumont (Les Républicains) et Stéphanie Do (La République en Marche).
[…] Notre fameuse sentence apparaît en somme, une fois de plus, comme un énoncé performatif, produisant les « réalités » dont il parle, dont il prétend simplement « prendre acte » et « tenir compte », et devant lesquelles il prétend simplement s’incliner : non seulement l’« impossibilité de l’accueil » (qui n’est en fait qu’une intolérance produite et entretenue), mais aussi cette « misère » elle-même.
Il faut se rendre à l’évidence : ce « On ne peut pas accueillir toute la misère du monde » permet de justifier et donc faciliter la mise en place de « politiques d’immigration » restrictives, en particulier dans l’attribution et le renouvellement des permis de séjour, dont l’effet premier est une radicale précarisation des arrivant.es – en d’autres termes : une production de la « misère » qu’on présente ensuite comme une « donnée » objective, naturelle et immuable.
[…] une société ne se fonde pas seulement sur des intérêts à défendre, mais aussi sur des principes à honorer – et il en va de même, du reste, de toute subjectivité individuelle. Le réalisme, si souvent invoqué par nos gouvernants, exige qu’on prenne en compte aussi cette réalité-là : nous ne vivons pas seulement de pain, d’eau et de profit matériel, mais aussi de valeurs que nous sommes fiers d’incarner et qui nous permettent de nous regarder dans une glace. Personne ne peut ignorer durablement ces exigences morales sans finir par le payer, sous une forme ou une autre, par une inexpugnable honte. Et s’il est précisément honteux, inacceptable moralement aux yeux de tous – ou du moins de beaucoup – de refuser des soins aux enfants, aux vieillards, aux malades ou aux handicapé.es en invoquant leur manque de « productivité » et de « rentabilité », il doit être tout aussi inacceptable de le faire quand lesdit.es enfants, vieillards, malades ou handicapé.es viennent d’ailleurs – sauf à sombrer dans la plus simple, brutale et abjecte xénophobie.
POUR L’HOSPITALITÉ
Nous estimons l’avoir démontré : la phrase « on ne peut pas accueillir toute la misère du monde » est xénophobe. Par xénophobie, il faut entendre la combinaison de deux éléments que sont la peur et l’étranger, reliés par un lien causal : c’est l’autre, en tant qu’autre, qui est l’objet de la peur. La xénophobie en tant que peur est donc une émotion ressentie face à un danger perçu comme imminent. Il s’agit d’une sensation physique qui a pour effet d’inhiber la pensée et d’induire une réponse immédiate, soit de l’ordre du combat soit de l’ordre de la fuite. Plus précisément, le mot phobie renvoie à des peurs irrationnelles, démesurées voire infondées, portant sur un danger minime ou inexistant – il en va ainsi, par exemple, de l’arachnophobie (peur des araignées) ou de l’agoraphobie (peur de la foule).
La phrase « on ne peut pas accueillir toute la misère du monde » est bel et bien xénophobe, on l’a vu, en ce qu’elle oppose un « nous » national à un « eux » qui désigne d’une manière grossière et générale les personnes étrangères. Elle l’est aussi parce quel’hyperbole « toute la misère du monde » suggère une entité gigantesque, donc potentiellement menaçante, « engloutissante », « envahissante », que toute personne sensée souhaiterait en toute logique éviter. Par sa formulation, cette phrase fait apparaître la présence d’étrangers sur le territoire national comme un « accueil » de « toute » la « misère » du « monde », ce qui entretient les fantasmes les plus aberrants et les plus toxiques sur le « grand remplacement ».
[…] pour faire bien apparaître la xénophobie polymorphe de cette fameuse sentence : « On ne peut pas accueillir toute la misère du monde ».
Ces mots entretiennent tout d’abord un stéréotype, puisqu’ils opèrent un amalgame entre un phénomène massif (la misère) et toute une fraction de la population (les immigré.es). La formule étant consacrée, rebattue, ressassée à l’infini comme une rengaine populaire, on peut aussi parler de mythe.
On peut parler également de préjugé, et même de stigmate, puisqu’il est clair que le mot misère, loin d’être connoté positivement, désigne un fléau social.
[…] La première attitude possible face à des gens qui prononcent cette phrase est donc de se désolidariser du « nous » et de les inviter à reformuler leur propos en jouant le jeu du « je ». Ensuite, et surtout, il convient de refuser catégoriquement d’entrer en discussion au sujet de personnes tant que celles-ci sont désignées par un substantif abstrait comme le mot « misère». Si c’est de personnes qu’il s’agit, il faut que soit explicité avec précision de qui exactement il est question, et de quelle manière il est acceptable d’en parler. Ces deux préalables posés, il importe ensuite savoir si l’assertion est discutable, si un débat est ouvert, ou si la personne entend énoncer un dogme, qu’elle n’accepte pas de questionner. Est-ce une impossibilité ou un interdit qui est énoncé quand on dit qu’on ne « peut » pas ? Et si c’est une impossibilité, est-ce une réelle impossibilité matérielle, objective, démontrée par des faits et des arguments, ou une simple « impossibilité personnelle », subjective, dont l’autre nom est l’intolérance ? Bref, encore une fois : s’agit-il de dire qu’on ne peut réellement pas laisser entrer des gens, et les laisser vivre ensuite sur le territoire national, ou bien de dire qu’on ne le veut pas – et qu’on choisit de les laisser mourir ?
Cette phrase doit être dénoncée, démontée, reformulée, en raison de son caractère profondément xénophobe. Penser et agir sur les « questions migratoires » ne peut se faire dans un contexte phobique, sur la base de « vérités premières » aussi catégoriques (« nous ne pouvons pas ») que biaisées (« accueillir ») et outrancières (« toute la misère du monde »), aussi péremptoires et aussi fragiles dans leurs fondements, n’ouvrant comme perspectives que la peur et la haine, la fuite ou la violence. Si l’arrivée d’étrangers-ères inquiète et pose problème à certaines, n’oublions pas que lesdit.es étrangers-ères, de leur côté, sont aussi confronté.es à des problèmes, souvent autrement plus radicaux, dramatiques, tragiques : ceux de leurs pays d’origine, ceux qui sont liés à l’exil et à la lente et pénible intégration dans un nouveau pays, ceux qui sont liés au dédale administratif, au contrôle policier, au racisme et à la xénophobie .
Refusons surtout que ces « problèmes d’immigration » remettent en cause l’humanité desdits immigrés, car les risques sont réels d’y apporter alors des solutions proprement « inhumaines ». L’avenir pourrait nous en donner la démonstration la plus effroyable, mais le présent et le passé récent suffisent à l’entrevoir : le pire n’est pas à venir, il a déjà commencé d’advenir.
Pour en revenir au point de départ de cet article, j’ai parfois le sentiment que ce qui se « dilue » ce sont les valeurs humaines face à la peur d’être altéré par l’Autre. En outre, on ne répètera jamais assez que c’est l’échange entre les cultures qui est fécond :
« [ Éribon : ] les cultures veulent s’opposer les unes aux autres.
Claude Lévi-Strauss : À la fin de Race et histoire, je soulignais un paradoxe. C’est la différence des cultures qui rend leur rencontre féconde. Or ce jeu en commun entraîne leur uniformisation progressive […] Que conclure de tout cela, sinon qu’il est souhaitable que les cultures se maintiennent diverses, ou qu’elles se renouvellent dans la diversité ? Seulement […] il faut consentir à en payer le prix : à savoir, que des cultures attachées chacune à un style de vie, à un système de valeurs, veillent sur leurs particularismes ; et que cette disposition est saine, nullement – comme on voudrait nous le faire croire – pathologique. Chaque culture se développe grâce à ses échanges avec d’autres cultures. Mais il faut que chacune y mette une certaine résistance, sinon, très vite, elle n’aurait plus rien qui lui appartienne en propre à échanger. L’absence et l’excès de communication ont l’un et l’autre leur danger. »
Claude Lévi-Strauss et Didier Éribon, De près, de loin (1988).
Enfin, force est de tristement constater que si les autrices et auteurs des commentaires mentionnés plus haut – qui rejettent massivement l’Autre – de même que Mossa Palatina et autres mouvances de repli sur les vertus exemplaires de la Corse, se disent aussi différents de la France, leur récit monolithique et excluant les en rapproche beaucoup plus qu’il ne les distingue : à travers l’ostracisme, le repli et la conviction d’être meilleur que les autres. Ainsi, si l’on ne peut douter qu’ils sont bien xénophobes, leur discours n’est pas non plus sans rappeler celui qui a conduit aux temps obscurs que l’Histoire aimerait bien oublier mais que le présent nous rappelle sans cesse, à travers la voix de ces petits caporaux bien-pensants de l’amer à boire.
Sans doute, faudrait-il relire Emmanuel Lévinas – Totalité et infini (1961) – qui avance que le visage de l’Autre est une révélation éthique qui engage à la responsabilité infinie, car il exprime une vulnérabilité qui interdit la violence et appelle à la reconnaissance de l’humanité.

Le langage totalitaire corporel et verbal des extrêmes
« Le langage politique est destiné à rendre vraisemblables les mensonges, respectables les meurtres, et à donner l’apparence de la solidité à ce qui n’est que du vent. L’orthodoxie, c’est de ne pas penser. »
Georges Orwel, 1984 (1949)
Au moment de conclure mon papier, la lecture d’un article du Monde, intitulé « La novlangue de Donald Trump, qui gouverne autant par les mots que par les décrets », me donne très envie de le poursuivre cette réflexion sur la stratégie du « nous contre eux » en comparant les « stratégies » de communication de Trump, Hitler, Le Pen (x2) ou Bardella.
S’il est vrai qu’il s’agit d’un exercice pour le moins « délicat » et même si les contextes ou les idéologies diffèrent, certains mécanismes linguistiques et discursifs présentent cependant des similitudes troublantes qui méritent notre attention. Aussi, si l’on prend soin de s’éloigner de l’extrapolation simpliste et opportuniste, il semble intéressant d’examiner comment ces figures politiques des extrêmes populistes instrumentalisent le langage pour asseoir leur pouvoir.
Ainsi, au regard des événements actuels et après les nombreux épisodes « à la Starsky et Hutch » (référence vintage), dont l’ex’ nouveau président américain nous a gratifiés depuis son investiture – voire même depuis sa campagne – il est tentant, pour ne pas dire irrésistible, de comparer sa « stratégie » de communication avec celle d’Adolf Hitler, des Le Pen, de Zemmour ou de Bardella, afin d’observer quelles sont les analogies dans leur simplification du langage, afin d’en révéler la mécanique. Oui, c’est « un peu » touchy, mais profitons-en tant qu’on est encore dans une démocratie (presque) en bonne santé.
En outre, il est important de souligner que cette observation demeure inévitablement parcellaire et lacunaire, compte-tenu du fait qu’elle est le fruit d’une réflexion personnelle – forcément subjective – qui n’est pas menée avec la rigueur – et le temps – qu’exigerait une production scientifique. Ce qui me donne également la liberté d’ajouter qu’une autre dimension fondamentale participe de l’incomplétude de mon propos : c’est l’absence d’une approche psychopathologique des figures politiques qui profèrent ces discours.
En effet, la psychologie clinique et la psychanalyse offrent des grilles de lecture précieuses pour comprendre les ressorts intimes qui sous-tendent le recours à certaines stratégies discursives et mises en scène du pouvoir. Des chercheurs comme Otto Kernberg (Severe Personality Disorders: Psychotherapeutic Strategies, 1984) et Heinz Kohut (The Analysis of the Self, 1971) ont étudié la manière dont certains dirigeants politiques, en quête de reconnaissance et de réparation narcissique, développent une rhétorique visant à asseoir une image idéalisée d’eux-mêmes, souvent au détriment de la réalité. Trump, dont le comportement a été maintes fois qualifié de narcissique par des spécialistes de la santé mentale (Lee, The Dangerous Case of Donald Trump, 2017), illustre parfaitement cette tendance à la construction d’un récit messianique autour de sa propre personne.
Le rapport de la CIA réalisé par le psychanalyste Walter Langer (1943) – A Psychological Analysis of Adolf Hitler: His Life and Legend – conclut qu’Hitler souffrait de traits paranoïaques, d’un trouble narcissique exacerbé et d’une fixation œdipienne mal résolue. Langer met en avant la notion de « parcours de réparation », où le dictateur aurait tenté de surmonter un sentiment d’infériorité et de rejet en construisant un récit mythique autour de lui-même. D’autres analyses, comme celles de Fritz Redlich (Hitler: Diagnosis of a Destructive Prophet, 1999), pointent également des éléments de volonté de toute-puissance, typiques des personnalités présentant des traits mégalomaniaques et antisociaux.
Cette approche permettrait ainsi de mieux comprendre comment ces figures politiques transforment leur propre insécurité en discours hégémonique et en mise en scène du pouvoir. En mettant en place une structure narrative où ils apparaissent comme des sauveurs ou des figures quasi-messianiques, ils parviennent à mobiliser des foules autour de récits simplificateurs, de manipulation discursive et de mythification politique extrêmement efficaces, qui relèvent également des dynamiques sociales, culturelles et institutionnelles. Pour autant, nous laisserons cette partie aux spécialistes à qui elle revient.
Trump, Hitler, l’extrême droite française et le langage de rupture
Rappelons tout d’abord quelques éléments de contexte. Tout le monde sait que les régimes politiques se distinguent par leur mode d’accession au pouvoir et l’exercice de l’autorité. Ainsi, il est bien connu que la dictature se caractérise par la concentration du pouvoir entre les mains d’un individu ou d’un groupe restreint, sans processus électoral démocratique ni respect des libertés fondamentales et que la démocratie libérale repose sur des élections libres, la séparation des pouvoirs et la garantie des droits individuels. Si l’on a bien conscience que la démocratie directe est un idéal vers lequel on tend mais qui n’existe nulle part – et dont on s’éloigne un peu plus à chaque fois qu’est brandit un 49.3 – Coluche appuie sur la nuance :
« La dictature c’est “ferme ta gueule” ; la démocratie c’est “cause toujours” »
Coluche
Cependant, il faut savoir mesure garder et si l’on peut encore écrire ça, il y a fort à penser que l’on se trouve quand même en démocratie.
Entre les deux extrêmes de régimes, on pourrait néanmoins citer la « démocratie illibérale », où des élections ont lieu, mais où l’État de droit et les libertés publiques sont progressivement érodés, menant à un autoritarisme majoritaire. Ce concept a été introduit par le politologue américain Fareed Zakaria, en 1997, pour décrire des régimes qui, tout en respectant le processus électoral, s’éloignent des principes fondamentaux du libéralisme politique, tels que la séparation des pouvoirs et la protection des droits individuels. Cette notion a été popularisée en Europe centrale et orientale, notamment en Hongrie et en Pologne, où des gouvernements ont été accusés de saper l’État de droit et de concentrer le pouvoir.
Dans son analyse « Pourquoi la démocratie illibérale triomphe partout », relayée par Courrier international le 16 janvier 2025, le philosophe britannique John Gray souligne que « l’effondrement mondial de la démocratie libérale est avant tout dû aux dérives des démocrates américains ». Il critique notamment l’élite progressiste pour avoir ignoré les préoccupations des classes ouvrières car c’est selon lui, le mépris des élites pour une partie de la population qui ouvrirait la voie à une montée des réactions populistes et à l’émergence de régimes illibéraux. Notons que « régimes illibéraux » semble plus juste que « démocraties illibérales », qui ressemble davantage à un oxymore.
Avant d’aller plus loin, il est essentiel de souligner quelques différences fondamentales entre les personnages de ce rapprochement analogique : Trump opère (encore) dans un cadre démocratique où ses discours, bien que polarisants, n’ont pas (encore) mené à une dictature totalitaire. De plus, il n’a pas (encore) théorisé de projet exterminateur comme celui du Troisième Reich. Pour autant, la similarité des techniques de manipulation du langage et de construction du pouvoir par le discours rappelle que le verbe, lorsqu’il est utilisé stratégiquement, peut constituer une arme redoutable pour façonner la réalité et mobiliser les masses.

Dans L’Ordre du discours (1971), Michel Foucault rappelle que « le discours n’est pas simplement ce qui traduit les luttes ou les systèmes de domination, mais ce pour quoi, ce par quoi on lutte, le pouvoir dont on cherche à s’emparer ».
En se questionnant sur la distribution de la parole, Spivak rejoint des questions que soulevait déjà Michel Foucault en 1971 avec L’ordre du discours, dans lequel il interroge les conditions d’accès à l’espace de la parole, mais aussi les dynamiques d’exclusion sur lesquelles le discours, en tant que système de pouvoir, repose. Il lance alors l’hypothèse que le discours est en fait une institution, une structure. Il existe, avance Foucault, plusieurs procédures de contrôle du discours. Si celui-ci est troué d’interdits, c’est qu’il joue un rôle vital dans la construction des dynamiques sociales : « le discours n’est pas simplement ce qui traduit les luttes ou les systèmes de domination, mais ce pour quoi, ce par quoi on lutte, le pouvoir dont on cherche à s’emparer » (Foucault 1971, 12). Ainsi, plus qu’un simple organe de représentation, le discours devient un outil du pouvoir; investir l’ordre du discours revient à poser un acte subjectif qui approche le sujet parlant du pouvoir. Les champs du discours ne sont pas tous « ouverts et pénétrables » (Foucault 1971, 39) de la même façon et, évidemment, les plus susceptibles de mener au pouvoir sont aussi les plus sélectifs. Les processus de contrôle sont mis en place pour préserver et limiter l’accès à ces régions différenciatrices du discours, provoquant non pas une réduction dans ses propos, mais une diminution du nombre de sujets parlants : « il s’agit de déterminer les conditions de l[a] mise en jeu [des discours], d’imposer aux individus qui les tiennent un certain nombre de règles et ainsi de ne pas permettre à tout le monde d’avoir accès à eux […]; nul n’entrera dans l’ordre du discours s’il ne satisfait à certaines exigences ou s’il n’est, d’entrée de jeu, qualifié pour le faire » (Foucault 1971, 38-39). C’est donc dire que, dans certains cas, le discours est un privilège que se partagent quelques individus favorisés et que prendre la parole devient dès lors un geste de résistance, de contestation. [Lafleur, Maude et Jean-François Lebel. 2018. « Paroles et silences : réflexions sur le pouvoir de dire ».
Postures, no. 28 (Automne) : Dossier « Paroles et silences : réflexions sur le pouvoir de dire ». http://revuepostures.com/fr/articles/avantpropos-28]
Hitler et Trump partagent cette compréhension du discours comme un instrument central du pouvoir.

Pierre Bourdieu, dans Ce que parler veut dire (1982) met en évidence la notion de « violence symbolique », c’est-à-dire la capacité du langage à imposer une vision du monde sans que les « trumpés » en aient nécessairement conscience. Hitler et Trump ont tous deux utilisé cette dynamique en construisant des boucs émissaires (cf. René Girard) qu’ils veulent envoyer paître dans le désert avec tous les péchés de la communauté sur le dos, pour maintenir la paix sociale : pour Hitler, il s’agissait des Juifs, des communistes et des élites cosmopolites ; pour Trump, des immigrés mexicains, des musulmans, de « l’État profond » et des médias. Ce procédé permet de canaliser la frustration populaire vers des figures ennemies bien identifiées, créant ainsi un climat de peur et de mobilisation autour du leader présenté comme le seul capable de défendre « le vrai peuple ».
Ainsi, Adolf Hitler et Donald Trump ont tous deux accédé au pouvoir par des voies légales. Hitler, après l’échec de son putsch, en 1923, a utilisé les mécanismes démocratiques de la République de Weimar (c’est étrange d’écrire ça) pour être nommé chancelier, en 1933, avant d’établir rapidement une dictature totalitaire. Trump, quant à lui, a été élu président une première fois, en 2016, dans le cadre d’une démocratie libérale. Après sa défaite en 2020, il est réélu en 2024, marquant un retour inédit dans l’histoire politique américaine.
Cette réélection suscite légitimement des inquiétudes quant à une possible dérive vers l’illibéralisme, notamment en raison de son mépris affiché pour certaines institutions démocratiques et de sa rhétorique incendiaire.

Viktor Klemperer, dans LTI, la langue du IIIᵉ Reich (1947), analyse comment la propagande nazie a transformé le langage en un outil de domination psychologique.
« Les mots peuvent être comme de minuscules doses d’arsenic : on les avale sans s’en apercevoir, ils semblent ne produire aucun effet, et voilà qu’au bout du temps l’effet toxique se fait sentir. »
Trump, à sa manière, utilise un procédé similaire en martelant des expressions comme fake news, deep state ou rigged election. Lorsqu’il affirme sans preuve que les élections ont été truquées, il ne cherche pas seulement à dénoncer un fait, mais à inscrire dans l’imaginaire collectif l’idée que son pouvoir a été injustement confisqué. Son usage de la répétition (« rigged election », « witch hunt ») participe de cette stratégie : en martelant sans relâche ces expressions, il ne laisse aucune place à une contestation rationnelle et enferme ses partisans dans un récit où il apparaît comme une victime d’un complot généralisé. Ce discours performatif produit ses effets en créant une réalité alternative qui s’impose par sa simple récurrence. Cette répétition incessante crée un effet de conditionnement, où certaines idées finissent par s’imposer comme des évidences, même en l’absence de preuves. Hitler, quant à lui, usait abondamment de termes comme Lügenpresse (la presse mensongère) pour délégitimer les médias qui le critiquaient et enfermer son public dans un cadre discursif où seul son discours était crédible. Par ailleurs, il ne s’agit de modifier le sens de mots existants afin d’orienter la pensée du public : en qualifiant systématiquement ses opposants de « socialistes », même lorsqu’ils ne le sont pas, il rejoue également un vieux réflexe rhétorique, où le simple étiquetage devient un outil de disqualification politique.
Le 20 janvier 2025, jour de la nouvelle investiture de Trump, Pierre Haski commençait sa chronique sur France Inter ainsi : « Nous changeons de monde aujourd’hui. Nous ne le réalisons pas encore vraiment, et on peut aisément prendre les premiers pas de Donald Trump comme ses habituelles excentricités, avant que la vie ne reprenne ses droits. Ce serait une erreur. Nous changeons VRAIMENT de monde ». En écrivant cela, il déclare s’être demandé plusieurs fois s’il ne se trompait pas et s’il ne cédait pas à l’hyperbole journalistique. Ce qui est hyperbolique, ce sont les images hallucinantesd’une grande violence symbolique, du 28 février 2025, du président ukrainien, Volodymyr Zelensky, « reçu » – c’est le cas de le dire – dans le Bureau ovale, par D. Trump et J.D. Vance qui martèlent, sans le laisser en placer une et en parlant plus fort que lui, que c’est un vilain garçon qui joue avec la Troisième Guerre mondiale. Une séquence qui visibilise assez clairement un nouveau point de bascule du monde.
Cette posture de cowboy est renforcée par l’usage des insultes et des surnoms dégradants pour ses adversaires – « Crooked Hillary », « Crazy Kamala », « Sleepy Joe » –, en plus de ridiculiser ses opposants, déstructure le langage politique traditionnel. Si ses « excentricités » font apparaître le personnage de Trump comme guignolesque – et donc inoffensif, car ridicule – il semble toutefois parvenir à imposer, à ceux qui ont envie/besoin de le « croire », un nouvel ordre linguistique où les normes du débat sont subverties en sa faveur, rendant difficile toute réponse sur le même terrain sans tomber dans le jeu qu’il dicte.
Communication non-verbale du spectacle politique : le corps comme outil… arme de domination
Si Erving Goffman, dans sa Mise en scène de la vie quotidienne (1956), développe l’idée que l’interaction sociale fonctionne comme une performance théâtrale où chaque individu, selon le contexte, adapte son comportement pour influencer la perception des autres, il n’est nul besoin de théorie pour voir clairement que Trump joue constamment un rôle, dans lequel il « calibre » son langage corporel et sa posture pour renforcer son image d’homme fort et de leader incontournable. Cependant, l’éclairage de Goffman permet de détailler davantage cette posture et d’en conscientiser les tenants.
En effet, l’auteur distingue la scène (front stage), où un individu se donne en spectacle devant un public, et les coulisses (back stage), où il se relâche et se détache de son rôle. Chez Trump, la distinction entre ces deux espaces semble particulièrement ténue : même dans des contextes censés être plus privés, il conserve une posture de domination, toujours soucieux du regard extérieur. Cela se traduit par son exubérance médiatique, sa gestuelle démonstrative et ses interactions marquées par une volonté constante d’asseoir son autorité.
Goffman explique que la performance sociale passe par un contrôle du corps et des expressions faciales et Trump excelle dans l’art de la grimace. Il adopte systématiquement une posture expansive (power posing), qui suggère force et assurance. Lors de ses discours, il exagère ses gestes pour renforcer ses propos : il pointe du doigt ses adversaires, utilise le pinching (le pouce et l’index formant un cercle) pour suggérer la maîtrise et emploie de grands mouvements de bras pour capter l’attention. Cette théâtralisation de son langage corporel participe à la construction d’un mythe du leader providentiel. En jouant avec les codes du pouvoir, en simplifiant son discours, en exagérant ses gestes et en incarnant une figure d’homme fort, accessible au peuple tout en étant au-dessus des normes politiques habituelles, il devient un personnage larger than life.

Dans « Le mythe, aujourd’hui » – le dernier chapitre de Mythologies –, Roland Barthes définit le mythe comme un processus où un événement, une personne ou un objet est vidé de sa complexité pour être transformé en signe porteur d’une idéologie.
« Le mythe ne cache rien : sa fonction est de déformer, non de faire disparaître ».
Cela signifie que les figures mythifiées ne sont pas inventées de toutes pièces, mais que leur complexité est déformée et réduite à une essence facilement reconnaissable. C’est exactement ce qui se passe avec Trump, dont l’image publique est taillée autour de la figure de l’outsider puissant, du chef de guerre contre l’« establishment », et du défenseur du « peuple oublié ». Il se réduit à un archétype, débarrassé de sa complexité pour mieux incarner un récit simplifié, simpliste, accessible et confortable, peu importe ses contradictions. De même que le général De Gaulle, dans la presse des années 50, se meut en un symbole dont l’image ne renvoie plus à sa complexité politique mais à une idée figée de l’homme providentiel – « le visage de l’homme politique est une carte de légitimation » [Mythologies, Roland Barthes] , du chef visionnaire qui dépasse les querelles partisanes, Trump se construit médiatiquement comme une figure héroïque et populiste, qui s’affranchit des nuances et aux contre-arguments.
Le sens possible d’un acte de langage est le résultat d’une co-construction qui dépend de l’image que chacun des participants à un échange langagier construit de l’autre. Roland Barthes précise que l’ethos ne correspond pas à l’état psychologique réel de l’orateur ou de l’auditoire, mais à « ce que le public croit que les autres ont dans la tête ». L’ethos est affaire de croisement de regards : regard de l’autre sur celui qui parle, regard de celui qui parle sur la façon dont il pense que l’autre le voit. Or, cet autre, pour construire l’image du sujet parlant, s’appuie à la fois sur des données préexistantes au discours et sur celles apportées par l’acte de langage lui-même.
Patrick Charaudeau, « Le charisme comme condition du leadership politique »
https://doi.org/10.4000/rfsic.1597]
Dans l’analyse qu’il fait du catch – « Le Monde où l’on catche » dans Mythologies –, Roland Barthes avance que le catch est un spectacle total, où les lutteurs incarnent des rôles simplifiés de héros et de méchants : « Ce que le public attend du catch, ce n’est pas qu’il fasse voir une action efficace mais qu’il soit intelligible ». Cette logique s’applique parfaitement à Trump, qui fonctionne comme un perpétuel acteur du spectacle politique, dans lequel il exagère ses gestes, ses expressions, ses insultes pour que tout soit immédiatement compréhensible par son public. Peu importe la vérité factuelle, c’est la clarté du récit qui prime : il est le leader anti-système qui protège son peuple contre des élites corrompues, comme le catcheur qui incarne le bien ou le mal sans nuance.
La sempiternelle mise en scène du pouvoir par Trump est ainsi très lisible dans ses interactions physiques avec autrui, notamment à l’occasion des poignées de main échangées… « administrées » aux chefs d’État, durant lesquelles Trump impose une prise ferme et prolongée afin de signifier sa dominance. Il n’aura échappé à personne que sa rencontre de 2017 avec Shinzo Abe – Premier ministre japonais assassiné en 2022 – illustre bien cette habitude : après une interminable et malaisante poignée de main de 19 secondes, durant laquelle Trump secoue énergiquement le bras du pauvre homme, ce dernier affiche un sourire crispé, trahissant l’inconfort et l’impuissance face à la situation ubuesque. Une autre illustration se trouve dans sa première rencontre avec Emmanuel Macron : le président français a consciemment résisté à sa poignée de main écrasante, donnant lieu à un moment de confrontation qui n’a pas échappé aux caméras.
Cette importance de l’occupation de l’espace dans la mise en scène de l’autorité est également soulignée par Erving Goffman. Cet usage de l’espace, dont Trump use et abuse, s’inscrit dans une stratégie où le corps devient un prolongement du discours politique. En 2016, lors de son débat contre Hillary Clinton, il adopte une posture physique menaçante en se tenant juste derrière elle lorsqu’elle parle, imposant sa présence et suggérant, de fait, une domination symbolique.
Le regard, toujours direct et appuyé, joue aussi un rôle central il fixe ses adversaires avec insistance, afin de les intimideret détourne parfois les yeux avec mépris pour signifier qu’ils ne sont pas dignes d’intérêt. Ce contrôle du regard est une manière d’établir une hiérarchie entre lui et les autres, renforçant ainsi la perception qu’il est le seul véritable maître du jeu.
Dans sa théorie de la performance sociale, Goffman explique que l’individu ajuste son rôle en fonction du publicauquel il s’adresse. Trump applique ce principe en modulant son langage corporel selon ses interlocuteurs. Face à ses électeurs, il adopte une posture plus décontractée, ponctuée de mimiques burlesques et d’une gestuelle exagérée, pour renforcer son image de leader accessible et proche du peuple. En revanche, lors de sommets internationaux, il se montre plus rigide et calculateur, en mobilisant une gestuelle conquérante où il cherche à dominer son environnement, pour inscrire son image dans l’imaginaire collectif comme celle d’un leader incontestable.
Afin de faire un rapide parallèle avec Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen ou Jordan Bardella, notons qu’ils utilisent, eux aussi, une stratégie discursive reposant sur une rupture avec les codes traditionnels du langage politique.
Vladimir Poutine, à la différence de Trump ou Hitler, instrumentalise le langage non pas tant pour séduire ou fanatiser que pour intimider, désorienter et imposer un récit unique qui sert son pouvoir. Il manie la novlangue comme une arme stratégique, en transformant les termes et en imposant une grille de lecture à la réalité : l’invasion de l’Ukraine devient une « opération militaire spéciale », la Russie ne fait que « se défendre » contre un Occident « décadent et hostile », et la répression interne est justifiée par la lutte contre des « agents étrangers ». Ce procédé rappelle encore une fois l’analyse de Klemperer où il décrit comment la propagande nazie vide les mots de leur sens pour anesthésier la pensée critique. À cela s’ajoute une manipulation du passé, telle que décrite dans 1984 d’Orwell :
« Celui qui a le contrôle du passé a le contrôle du futur. Celui qui a le contrôle du présent a le contrôle du passé«
Ainsi, Poutine réécrit l’histoire pour légitimer ses actions, affirmant que l’Ukraine n’a jamais été une nation indépendante ou que l’effondrement de l’URSS fut la plus grande catastrophe du XXᵉ siècle. Il n’a pas besoin de discours enflammés ou d’attaques verbales directes comme Trump, car il privilégie l’ambiguïté stratégique : il ne menace jamais frontalement mais laisse planer le doute, notamment sur l’usage de l’arme nucléaire, entretenant un climat de peur et d’incertitude. Ce langage de la menace et du sous-entendu est renforcé par une mise en scène du pouvoir où l’espace joue un rôle clé : ses célèbres immenses tables blanches, où il place ses interlocuteurs à distance, traduisent physiquement son inaccessibilité et sa domination symbolique. Contrairement à Trump, qui envahit l’espace par sa gestuelle expansive, Poutine impose son autorité par un contrôle froid et calculé, son ton posé et monocorde accentuant cette impression d’un leader insaisissable, inébranlable. Il s’inscrit ainsi dans une tradition où le langage ne sert pas à convaincre mais à créer une réalité parallèle, où la guerre est une mission de paix, où l’agresseur devient la victime, et où le pouvoir s’exerce par la peur autant que par la parole.
Dans un autre style, Éric Zemmour, lui, instrumentalise le langage en s’appuyant sur une érudition apparente et une réécriture de l’histoire pour légitimer une vision nationaliste et identitaire. Contrairement à Trump, qui privilégie la simplicité et l’émotion, ou à Hitler, qui mobilise les masses par un récit mythifié, il utilise des références culturelles et historiques pour donner une légitimité intellectuelle à ses thèses. Il construit un cadre narratif où la France serait menacée et, toujours selon la logique du bouc émissaire décrite par Girard, il attribue ce déclin à l’immigration musulmane. À l’inverse de Marine Le Pen, qui cherche à adoucir son discours, Zemmour assume une radicalité proche de Jean-Marie Le Pen, mais sous un vernis intellectuel, ce qui lui assure une place dans les médias. Sa posture corporelle maîtrisée et son ton posé renforcent l’image d’un penseur stoïque, même lorsqu’il se montre verbalement agressif en débat. Il incarne ainsi un populisme où le langage sert à masquer la radicalité sous une apparente rationalité, tout en manipulant l’histoire pour imposer son idéologie réactionnaire.
Jean-Marie Le Pen, dans les années 1980-1990, usait déjà d’une rhétorique provocatrice et brutale, n’hésitant pas à recourir à des expressions volontairement choquantes comme « Durafour crématoire » ou « détail de l’histoire » pour parler de la Shoah, qui lui permettaient d’attirer l’attention médiatique tout en ancrant son discours dans une radicalité assumée. À l’instar de Trump, il jouait sur la transgression et le rejet des normes du politiquement correct.
Marine Le Pen, à partir des années 2010, a réorienté la stratégie du Front National en adoptant un langage plus institutionnel et en euphémisant certaines formules, tout en conservant des éléments de la rhétorique populiste. Son objectif a été de normaliser son discours pour le rendre acceptable auprès d’un électorat plus large, à l’image de Trump qui, malgré ses excès verbaux, a su séduire des électeurs traditionnellement réticents aux candidats populistes. Cette stratégie repose sur un travail lexical, dans le cadre duquel Marine Le Pen parle désormais de « grand remplacement» sans toujours employer le terme, mais en suggérant l’idée sous d’autres formes, à l’image de Trump qui évoque « l’invasion migratoire ».
Jordan Bardella, plus récemment, a repris cette stratégie en simplifiant encore davantage son langage pour s’adapter aux codes numériques et médiatiques. Il maîtrise parfaitement l’art de la phrase courte et impactante, conçue pour être relayée massivement sur les réseaux sociaux, tout comme Trump avec ses tweets. Sa rhétorique repose sur une opposition binaire entre « les Français » et « les élites corrompues ». Un procédé manichéen bien connu, opposant un « nous » vertueux à un « eux » menaçant, visant à renforcer la cohésion du groupe en désignant des ennemis communs. Maintes fois utilisé et – hélas – toujours aussi performant, pour mobiliser les masses et justifier des politiques agressives ou discriminatoires
Les nouvelles mythologies qui propagent les idéologies de Trump, Le Pen ou Bardella prennent racine dans des concepts tels que « l’Amérique en déclin », « l’immigration incontrôlée » ou « l’élite corrompue ». La théorie du bouc émissaire éclaire comment ces discours binaires du « nous contre eux » canalisent les frustrations et les violences d’une partie de la population en désignant des ennemis communs. Tous ces personnages politiques utilisent cette dynamique en pointant du doigt les immigrés, les médias ou l’establishment politique comme responsables des maux de la société, renforçant ainsi la cohésion de leur électorat autour de ces figures ennemies.
Aussi, la montée des démocraties illibérales et des populismes montre que cette stratégie est redoutablement efficace et qu’elle s’inscrit dans un mouvement global de défiance envers les institutions traditionnelles.
Dans ce contexte, le sommet de Londres, ce dimanche 02 mars, revêt une importance capitale : le Vieux Continent n’a pas droit à l’erreur. Complexe, pour ne pas dire que l’heure est historique. Oui, encore.
Là où le mythe moderne veut remplacer la complexité du réel par une narration réductrice, efficace et mobilisatrice parce que simpliste et confortable, soyons subversifs :
« Dans la règle, découvrez l’abus
Et partout où l’abus s’est montré,
Trouvez le remède. »
Bertolt Brecht, L’exception et la règle (1930)
Là où le pouvoir (ab)use du langage comme instrument de distorsion de la réalité et de polarisation du débat public, en s’armant de mots qu’il vide de leur substance, cela rappelle combien le contrôle des mots peut encore être un prélude au contrôle des esprits, outillons le raisonnement critique pour permettre à la démocratie d’entendre encore toutes ses voix.

(c) Crédits photos : Emmanuelle VALLI.