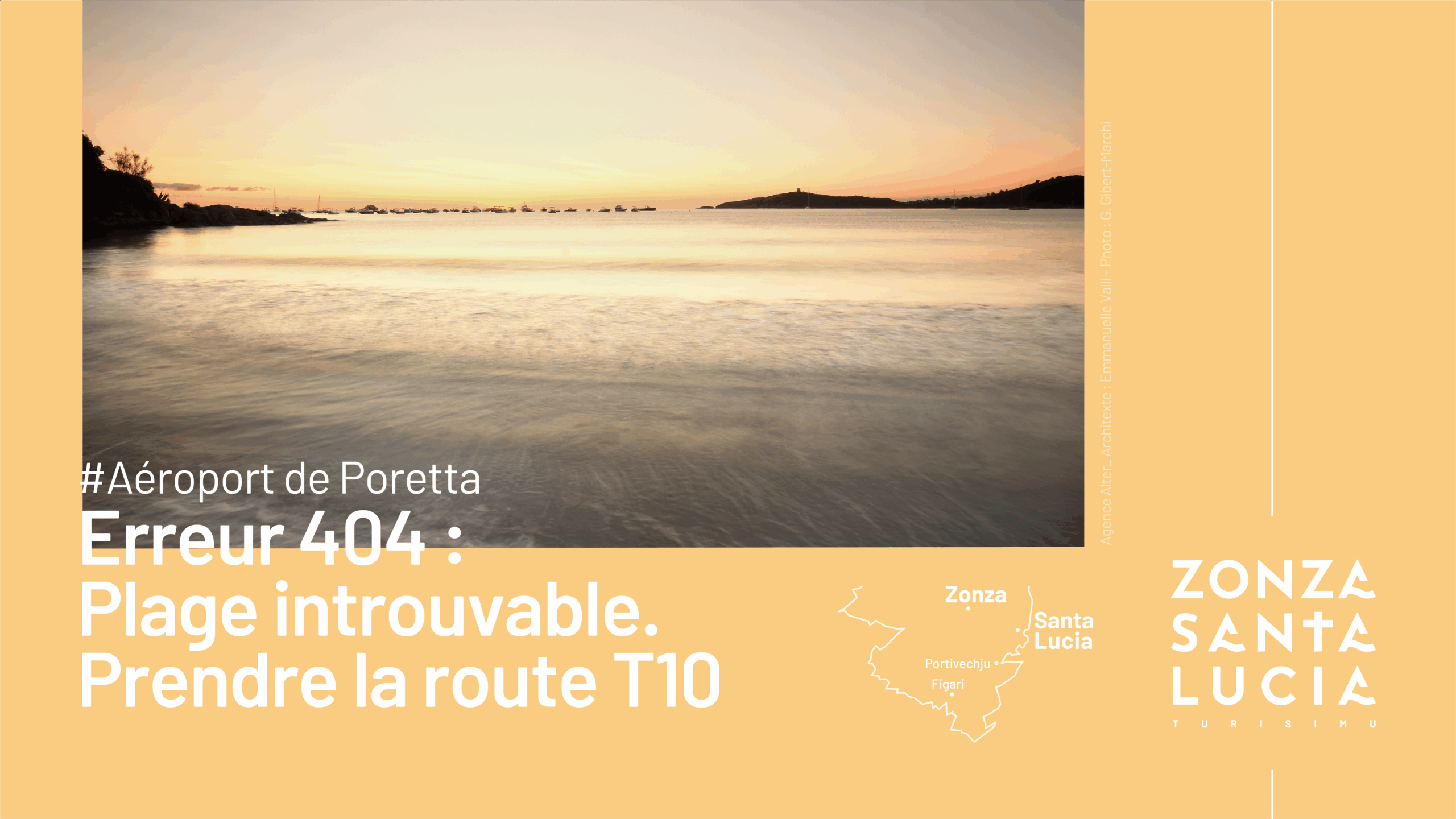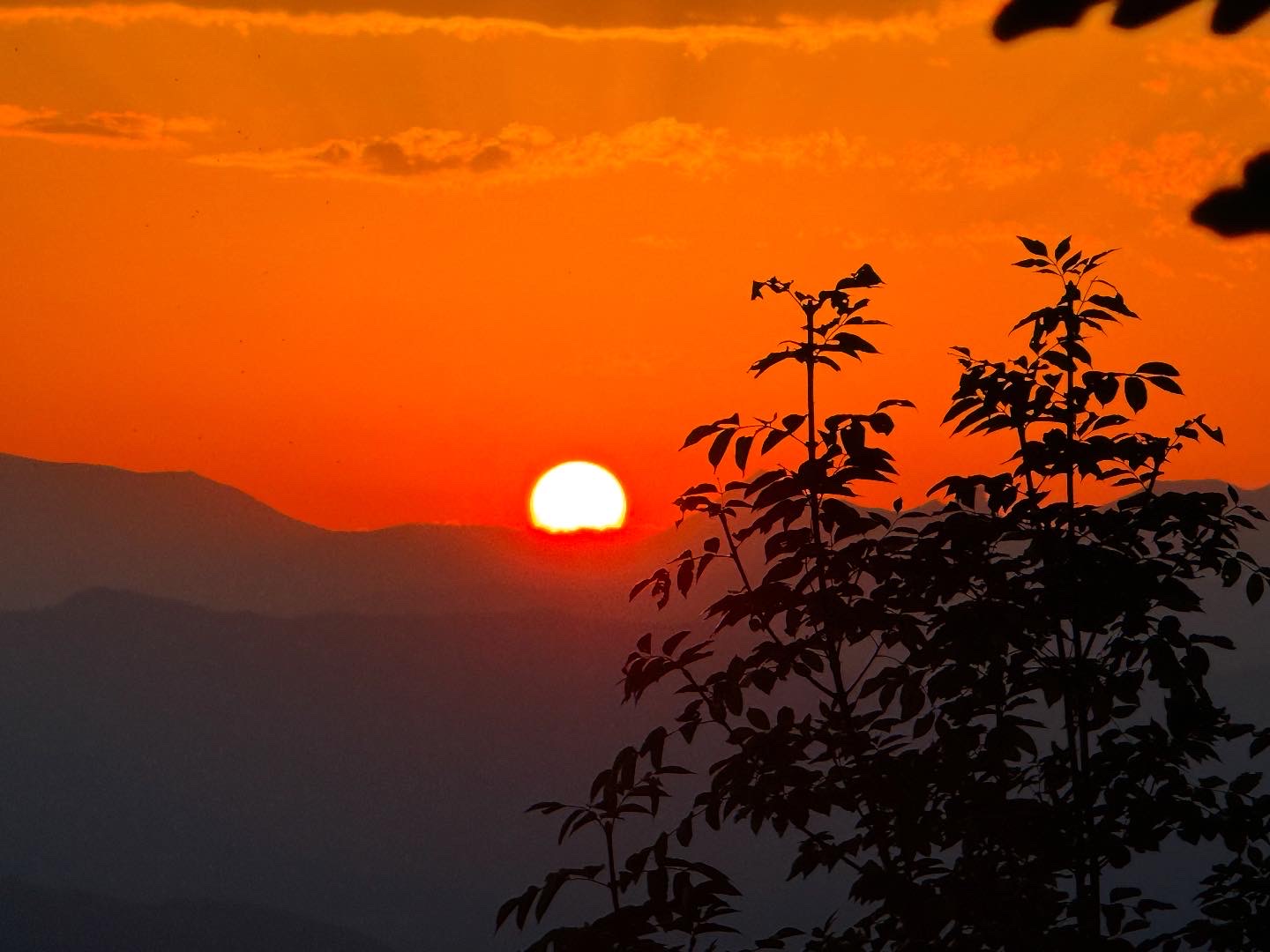L’écrivaine et traductrice Ryoko Sekiguchi était l’invitée des Midis de Culture, à l’occasion de la sortie de son dernier livre, L’Appel des odeurs (2024). Elle y parlait de la perception des odeurs, bien sûr, mais aussi des goûts.
Comme une invitation à voyager dans l’altérité, à travers une furtive exploration des sens communs et à interroger les mots qui les transportent : si le sens commun est une manière de juger commune et raisonnable, qui équivaut au bon sens, comment se développent les 5 sens individuels ?

Ryoko Sekiguchi a souvent écrit sur les cinq sens : l’audition dans La Voix sombre, le goût dans plusieurs ouvrages, comme Nagori ou 961 heures à Beyrouth (et 321 plats qui les accompagnent), comme sur l’éphémère et l’impalpable. Avec ce nouveau livre, elle fait de l’odeur une héroïne de roman. Si « l’odorat, constate Ryoko Sekiguchi, n’a que peu de place en Occident dans les productions de l’esprit, et rares sont les œuvres, littéraires ou philosophiques, qui y sont consacrées », l’odeur est pourtant l’extension de la présence, elle précède et poursuit une apparition. Elle nous offre surtout une lecture plus riche et romanesque du monde.
Pour Ryoko Sekiguchi, les odeurs ont la capacité de devenir des personnages, capables de provoquer un drame, délivrer un message, révéler des sentiments et raconter notre passé ou notre avenir. L’Appel des odeurs est un roman composé de plusieurs récits, un peu à la façon des Mille et Une Nuits. La narratrice tient un « carnet d’odeurs », au travers d’histoires ou de contes oniriques. On ignore si ces récits ont été inventés par la narratrice, ou si elle les a « vécus » en voyageant dans l’espace et le temps, à la manière de l’Orlando de Virginia Woolf. Récits ancrés dans des lieux différents et des époques variées : Grenade en Espagne, Spoleto en Italie, dans un opéra à Ferrare au XVIIIe siècle, au Palais-Royal à Paris sur trois siècles consécutifs, en Corse dans l’entre-deux-guerres, au Japon, à Taipei, dans une imprimerie de Téhéran au XIXe siècle, à New York et Los Angeles… Chaque odeur a un corps et un langage, une présence susceptible de bouleverser notre rapport au temps et à l’espace. Puanteurs, miasmes, ou parfums si délicats qu’il faut « prêter le nez » pour les remarquer. La narratrice découvre aussi l’expérience douloureuse de la perte de l’odorat, un exil du monde dont souffrent les personnes atteintes d’anosmie. Source : éditions P.O.L.
Selon Ryoko Sekiguchi, en Occident et en France en tout cas, le fade est vraiment perçu comme le comble de l’insipide, du lisse, de la platitude, de ce qui n’a pas de goût et donc pas d’intérêt.
Pierre Bourdieu a largement contribué à la compréhension du goût comme phénomène social, à travers ses concepts de « capital culturel » et d' »habitus ». Il définit l’habitus comme un système de dispositions durables et transférables, structurées par l’environnement social et influençant les perceptions, les appréciations et les actions des individus. Cela inclut la langue comme vecteur de distinction et de reproduction des goûts.

« Pour distinguer si une chose est belle ou ne l’est pas, nous n’en rapportons pas la représentation à son objet au moyen de l’entendement et en vue d’une connaissance, mais au sujet et au sentiment de plaisir ou de déplaisir. (…) Le jugement de goût (…) est donc esthétique. »
Ainsi commence la Critique du jugement dans laquelle Kant se livre à une « critique du goût » pour arriver à une définition du beau comme une « finalité sans fin ». D’après lui, quand nous disons c’est beau, nous ne voulons pas dire simplement c’est agréable, nous prétendons à une certaine objectivité, à une certaine nécessité, à une universalité.
En faisant de La Distinction une critique sociale du jugement, Pierre Bourdieu bouleverse d’emblée des catégories sur le Beau, l’art et la culture, qui n’avaient jamais été remises en question. Non seulement le beau n’est pas un concept a priori, mais, au contraire, « les gens ont le goût de leur diplôme » et, les catégories de la distinction dépendent de la position que l’on a dans le tableau des classes sociales. Ainsi, selon que l’on a fait des études supérieures ou que l’on a passé le B.E.P.C., que l’on est issu de la bourgeoisie ou d’une classe populaire on aime le Clavecin bien tempéré, la Rhapsodie in blue ou le Beau Danube bleu.
Mais, dit Bourdieu, à l’intérieur de la classe dominante, le capital économique ne correspond pas toujours au capital culturel et un tableau montre comment, dans la classe dominante, selon que l’on a un niveau inférieur au baccalauréat ou que l’on a passé une agrégation, on achète plus facilement ses meubles chez un antiquaire qu’aux Puces ou dans un magasin spécialisé.
En s’interrogeant donc sur les causes des préférences esthétiques, Pierre Bourdieu étudie ce qui les détermine, c’est-à-dire d’une part « le capital culturel » autrement dit le niveau d’instruction, et, d’autre part, « le capital économique », soit la situation sociale. Et, en analysant ensuite les transformations du rapport entre les différentes classes sociales et le système d’enseignement, il distingue, à l’intérieur de chaque classe, des principes généraux de conduite que l’on retrouve dans chaque domaine et qui permettent d’établir un « système » des styles de vie. Ainsi, de la même façon que l’on aime tel peintre, on a telle attitude politique et, selon que l’on a fait telles études, on pratique tel sport, on consomme tels aliments et l’on s’habille de telle façon.
En fait, quand on parle de culture, on parle, sans le savoir, de classe sociale, et la politique ne fait pas exception aux lois de la culture et du goût.
Source : éditions de Minuit.
Il semblerait, pourtant, que quelque chose se joue justement dans ces creux du mot « fade », qu’un palais non avisé ne saurait soupçonner.
En effet, à partir du moment où l’on prononce le mot « fade », on renonce souvent à goûter ce qu’il (dis)qualifie : « on renonce à l’effort d’aller sentir ce goût qui murmure« , dit-elle, avec poésie. On pourrait voir le fade comme « un goût pastel », qui a lui-aussi son charme et sa particularité. Alors, même si c’est subtil, Ryoko Sekiguchi suggère de prendre le temps de le regarder, de le sentir. Elle avance qu’on a peut-être besoin de davantage de fade dans nos vies, où nous voulons toujours plus d’éclat et de clinquant. La métaphore qu’elle convoque pour l’exprimer est on ne peut plus limpide :
« Oui, on a besoin de plus de fade dans notre vie, parce que c’est comme si on était devenus un peu sourds et qu’on voulait des sons de plus en plus bruyants1, des goûts qui tapent de plus en plus, des odeurs marquantes, mais on n’est pas si vieux que ça, quand même. On peut se fier à nos 5 sens. »
Tout le monde aura déjà expérimenté, au moins une fois, l’efficacité qui résulte du fait de faire silence ou de parler plus bas, dans un auditoire bruyant ; lorsque vouloir parler plus fort que les autres est souvent un échec.
Par ailleurs, en termes d’odeurs, quelle est la pire, pour Ryoko Sekiguchi ? C’est celle sur laquelle les gens collent une mauvaise image. Parce qu’elle pense qu’il n’y a pas de bonne ou de mauvaise odeur, tout comme il n’y a pas non plus de bons plats ou mauvais plats, de bons goûts ou de mauvais goûts. À partir du moment où il y a du mépris, la pire odeur, c’est l’odeur qu’elle veut défendre.
« Il n’y a pas d’odeur qui me répugne, parce qu’en fait, je me l’interdis. Comme le goût, j’ai décidé que je ne dirai jamais que c’est mauvais ou que je n’aime pas. »
Peut-on véritablement rééduquer nos sens, notre système de représentation et nos (dé)goûts ?
Existe-t-il une revanche du « moche » ? C’est justement ce qu’interrogeait Philosophie magazine, dans l’un de ses articles, pas plus tard que ce matin : la déferlante Ugg, illustration du mou, du moche mais confortable.
Umberto Eco, propose des pistes de réponses, dans l' »Histoire de la beauté » et l' »Histoire de la laideur », où il explore les concepts du beau et du laid à travers l’histoire, démontrant que ces notions sont profondément ancrées dans les contextes culturels, sociaux, et philosophiques. Il révèle que les standards de beauté et de laideur varient grandement entre les différentes époques et cultures, remettant en question l’universalité de ces idéaux et démontre que la beauté a souvent été liée au bien, à la vérité, et à la moralité, tandis que la laideur a été associée à leurs opposés, mais aussi à une force qui défie les normes esthétiques établies. Dans son analyse sémiotique, Eco illustre notamment la complexité et l’interdépendance qui relie le beau et le laid.

En apparence, beauté et laideur sont deux concepts qui s’impliquent mutuellement, et l’on comprend généralement la laideur comme l’inverse de la beauté, si bien qu’il suffirait de définir l’une pour savoir ce qu’est l’autre. Mais les différentes manifestations du laid au fil des siècles s’avèrent plus riches et plus imprévisibles qu’on ne croit. Or, voici que les extraits d’anthologie, ainsi que les extraordinaires illustrations de ce livre, nous emmènent dans un voyage surprenant entre les cauchemars, les terreurs et les amours de près de trois mille ans d’histoire, où la répulsion va de pair avec de touchants mouvements de compassion, et où le refus de la difformité s’accompagne d’un enthousiasme décadent pour les violations les plus séduisantes des canons classiques. Entre démons, monstres, ennemis terribles et présences dérangeantes, entre abysses répugnants et difformités qui frôlent le sublime, freaks et morts-vivants, on découvre une veine iconographique immense et souvent insoupçonnée. Si bien que, en trouvant côte à côte dans ces pages laideur naturelle, laideur spirituelle, asymétrie, dissonance, défiguration, et mesquin, lâche, vil, banal, fortuit, arbitraire, vulgaire, répugnant, maladroit, hideux, fade, écœurant, criminel, spectral, sorcier, satanique, repoussant, dégueulasse, dégradant, grotesque, abominable, odieux, indécent, immonde, sale, obscène, épouvantable, terrible, terrifiant, révoltant, repoussant, dégoûtant, nauséabond, fétide, ignoble, disgracieux et déplaisant, le premier éditeur étranger qui a vu cette œuvre s’est exclamé : « Que la laideur est belle !« . Source : éditions Flammarion.
Le « savoir-vivre » – qui s’oppose aux « mauvaises manières » – en français, désigne une connaissance et une pratique des bonnes manières et du comportement approprié en société. Ce concept englobe une gamme de comportements et de préférences esthétiques considérés comme raffinés ou de bon goût dans la culture française, influençant ainsi la perception des normes sociales et culturelles.
L’adage ne dit-il pas « de gustibus et coloribus non est disputandum« , des goûts et des couleurs on ne dispute point ? L’histoire démontre en tout cas que c’est un sujet !
David Hume, dans son essai Of the Standard of Taste (1757), s’interroge sur les jugements de goût et sur le fait qu’ils puissent être objectifs ou purement subjectifs. Il soutient qu’il existe un standard universel de goût malgré la subjectivité individuelle. Selon lui, bien que les goûts varient, l’accord entre les juges expérimentés et qualifiés pour estimer la valeur d’une œuvre d’art, indique l’existence d’un standard de goût objectif.

« Tous les goûts, dit-on, sont dans la nature » et « des goûts et des couleurs on ne dispute pas ». S’ensuit-il pour autant que la beauté se réduise à ce que chacun en perçoit ? Si tel est le cas, le barbouillage le plus grossier vaut la toile du maître… Devant une telle inconséquence, le philosophe écossais David Hume (1711-1776) montre qu’il est légitime de rechercher une règle du goût, une manière commune de juger du beau et du laid. Car avoir du goût, ce n’est pas seulement sentir, c’est savoir sentir. Et pour comprendre la genèse de ce savoir pratique, le philosophe nous invite, à la lumière du double rapport de la sensibilité et de l’éducation, à reconsidérer sans préjugés notre expérience de la beauté. Source : éditions Fayard.
Hume réconcilie ainsi la subjectivité du goût avec l’idée d’un standard objectif d’appréciation artistique.
Pourquoi opposer le goût standard, acquis, identitaire, commun à une culture et les goûts subjectifs, acquis eux aussi, à partir d’expériences individuelles, alors qu’on peut les additionner et que chaque perspective différente constitue un trésor supplémentaire ?
Ryoko Sekiguchi, constate que son pays d’origine, le Japon, est complètement différent, si on l’observe depuis Paris, mais elle souligne que cette distance est possible à franchir, car on peut justement être deux choses en même temps.
En tant que traductrice, elle voudrait croire, en tout cas, que tout est traduisible. Si elle écrit sur les cinq sens, dit-elle, c’est parce qu’on dit que c’est subjectif et qu’on ne peut pas le partager ; mais elle pense, justement, que c’est seulement par les mots qu’on peut créer ce territoire où toutes les sensations deviennent partageables et partagées.
Quelle est l’odeur d’un tableau ? Quelle est l’odeur d’une fiction qu’on se raconte ? Peut-être qu’elle ne peux pas tout traduire, certes. Mais si ne pas pouvoir tout dire est une chose, on peut toujours réfléchir, on peut toujours s’interroger, selon elle, et à ce moment-là, apparaît ce terrain, ne fut-ce qu’imaginable, qui se crée et sur lequel on peut échanger. C’est le contraire de l’identité, de ce qui est statique ou intemporel.
Ainsi, ce qui intéresse Ryoko Sekiguchi, c’est l’éphémère. Pour elle, tout a changé à partir de la triple catastrophe de Fukushima, en 2011. Elle dit avoir cessé d’être la même écrivaine, quelque chose en elle a changé et soudain, c’était l’éphémère qui l’intéressait, tout ce qu’on ne peut pas saisir. Ses écrits racontent les nuages, le vaporeux, le fade, l’astringent, toutes ces choses qui nous semblent justement insaisissables. Un peu comme un traducteur qui veut toujours traduire des textes qui semblent impossibles à traduire, mais qui pense que c’est possible, dit-elle.
« Cuisiner les nuages ou sentir l’odeur des tableaux, c’est vraiment faisable ! Dans un portrait, on peut sentir l’odeur du velours de la veste, etc. C’est nous qui nous interdisons. C’est un problème d’éducation, d’à priori. »
Finalement, traduire les différentes perceptions des senteurs et saveurs de l’altérité, quelque part, c’est inventer un territoire ouvert, au-delà des normes et des frontières érigées par les représentations propres à chaque culture et à chaque époque, au-delà des identités figées.
En tant que traductrice de singularités, je trouve aussi que c’est dans les creux, dans l’insaisissable et dans le pas de côté, dans ces subjectivités humaines, si foisonnantes et si complexes à traduire, que réside sans doute la richesse la plus intéressante à mettre en valeur. Une incitation à se connaître soi-même mais à toujours se réserver des surprises ? Alors, laissons-nous surprendre, par notre petite madeleine et par les autres.

Ryoko Sekiguchi est auteur d’une dizaine de livres en français et en japonais. Traductrice littéraire, elle organise également des événements qui relient littérature et cuisine. Parmi ses ouvrages : Le nuage, dix façons de le préparer, Nagori, Le Club des Gourmets.
- Cela pourrait questionner l’utilisation d’images chocs, dans les médias, qui semblent avoir de moins en moins d’effet, à mesure que leur présence s’accroît, les privant de leur effet de surprise qui fonctionne davantage sur la rareté. ↩︎