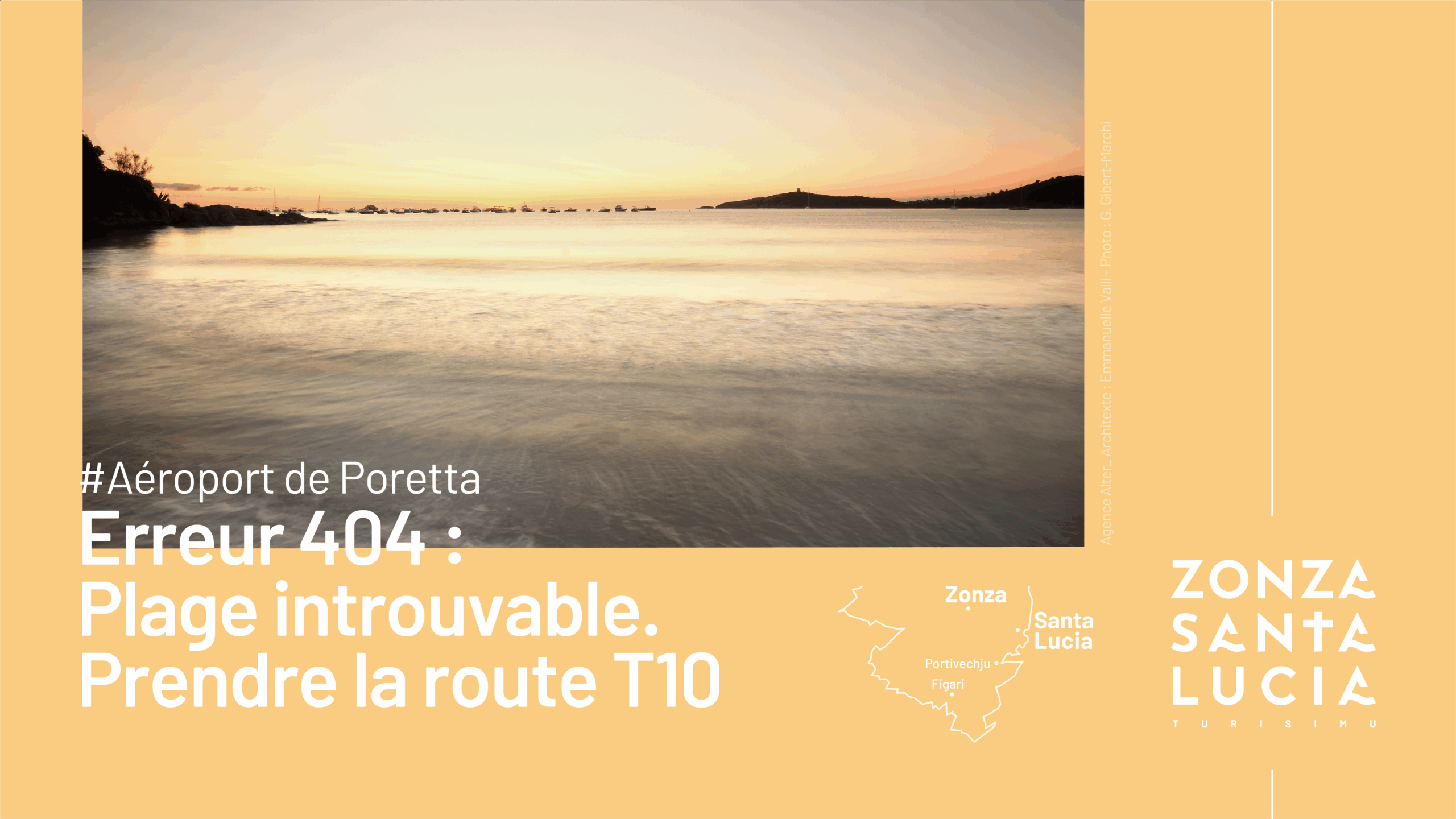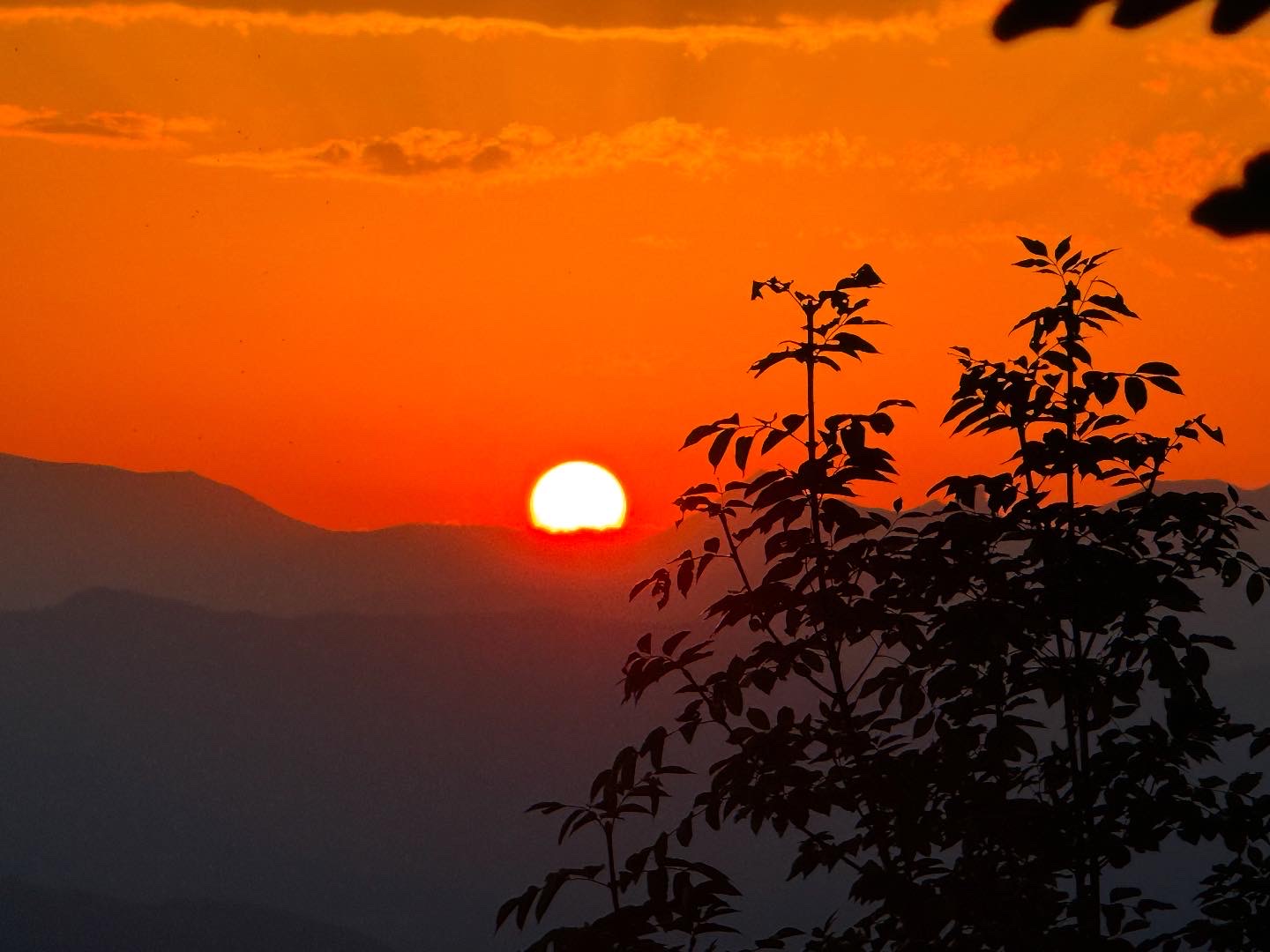À l’ère du « réarmement » civique, académique et démographique annoncé par le président Macron, lors de la grand-messe médiatique pour « dire au pays d’où nous venons et où nous allons » , prenons quelques minutes, afin d’interroger le super pouvoir des mots.
« La natalité baisse aussi parce que l’infertilité progresse. Et je parle là d’une forme de tabou du siècle, mais les mœurs changent, on fait des enfants de plus en plus tard. L’infertilité masculine, comme féminine, a beaucoup progressé ces dernières années et fait souffrir beaucoup de couples. Un grand plan de lutte contre ce fléau sera engagé pour permettre justement ce réarmement démographique. »
Source : Conférence de presse d’Emmanuel Macron du 16 janvier 2024.
En effet, si – par extension – le terme « réarmement » signifie munir à nouveau de ce qui est nécessaire – au sens de dispositif – à son fonctionnement, l’image à laquelle il renvoie en premier lieu ne s’inscrit-elle pas immédiatement dans le champ sémantique de la guerre ? Réarmement, arme, armement, armée : guerre. Encore.
Sans surprise, puisque le lexique belliqueux et le recours aux métaphores filées est désormais chose courante dans le verbiage du pouvoir politique. Souvenons-nous néanmoins de l’effarement produit par le « nous sommes en guerre », du président Macron, dans son discours du 16 mars 2020, durant la pandémie de Covid 19 ; « l’ennemi est là, invisible, insaisissable », « toute la Nation est engagée dans ce combat », « en première ligne », et hop, « confinement ».
Comme l’écrivait Léopold Sédar Senghor, le mot est « plus qu’image, il est image analogique sans même le secours de la métaphore ou de la comparaison. Il suffit de nommer la chose pour qu’apparaisse le sens sous le signe« .
Alerte spoiler : Nommer, ce n’est pas seulement désigner, c’est également rendre présent à l’esprit, représenter. Aussi, comment imaginer que les mots dont on parle puissent être anodins ? Et si tel n’est pas le cas, alors, que penser de la performativité attendue dans cet énoncé de réarmement ovarien ? Cela pourrait-il ressembler à une tentative d’Emmanuel Macron de renforcer son pouvoir en tant que président de la République ? Cette stratégie de communication vise-t-elle à dramatiser les enjeux, à travers un vocabulaire martial, afin de créer l’union autour d’un chef de guerre – lui – le muant en puissance incontestée sur l’échiquier politique ?
Si nous ne sommes pas là pour apporter des réponses à ces questions rhétoriques, c’est cependant l’occasion rêvée de faire le point sur les mots en tant qu’instruments – parfois sous-estimés – de pouvoir, capables d’influencer et de façonner notre perception de la réalité. Car le langage et ses mutations sémantiques ne se contentent pas de refléter le monde tel qu’il est, ils jouent un rôle actif dans la construction et la compréhension de notre environnement et de nos expériences.
« Il n’y a pas de pouvoir nu et muet » écrivait Georges Balandier, dans Pouvoir sur scène (1980), soulignant l’importance des mots employés par les hommes politiques, notamment à des fins de conquête du pouvoir.
« Mal nommer un objet, c’est ajouter au malheur de ce monde. […] la grande tâche de l’homme est de ne pas servir le mensonge. »
Albert Camus, Sur une philosophie de l’expression (1944)
Aussi, reprenons l’exemple du mot « guerre ». En choisissant ce terme, on attribue une gravité certaine à la situation que l’on qualifie. À contrario, lorsque d’aucuns ont pu nommer « événements » ou « opérations de maintien de l’ordre » en Algérie (1954-1962), ne minimisaient-ils pas ce qui n’était autre qu’une guerre ? La dénomination « guerre d’Algérie » n’a été officiellement adoptée en France qu’en 1999.
Notons qu’il existe différentes interprétations concernant la définition des « guerres » et des « conflits ». L’UCDP, par exemple, utilise comme paramètre le nombre de morts : sont définies comme « guerres » les conflits qui entraînent au moins un millier de morts dans les batailles par an.
Si l’on se réfère au choix des mots des dernières annonces présidentielles en date, il semblerait que nous soyons toujours « en guerre ». Mais est-ce bien raisonnable, quand on pense aux territoires où l’on parle de véritables pertes humaines – comme en Israël, dans la bande de Gaza, en Ukraine, au Burkina Faso, en Somalie, au Soudan, au Yémen, en Birmanie, au Nigeria et en Syrie ?

« La logique du révolté est […] de s’efforcer au langage clair pour ne pas épaissir le mensonge universel. »
Albert Camus, L’homme révolté (1951)
À un autre niveau, que doit-on penser du fait de nommer « agent de propreté urbaine » une personne anciennement désignée par « éboueur » ? Cette nouvelle appellation participe-t-elle au moins à adoucir la dureté de la tâche ou les représentations négatives liées à ce métier difficile ? Force est de constater, que la substitution du mot « avortement » par « Interruption Volontaire de Grossesse » (IVG) a été fondamentale dans son processus de normalisation. La modification lexicale peut donc, parfois, changer la perspective. En éliminant toute connotation négative, via le changement de terminologie, on peut transformer la norme et, de fait, la perception de la réalité. Voilà qui donne encore à réfléchir.1
« La langue, comme performance de tout langage, n’est ni réactionnaire ni progressiste ; elle est tout simplement : fasciste ; car le fascisme, ce n’est pas d’empêcher de dire, c’est d’obliger à dire »
Roland Barthes
Roland Barthes, nous enseigne que le langage est un système de signes et que chaque mot est un signe, un symbole qui renvoie à une réalité. Ainsi, selon lui, nommer, c’est exercer un pouvoir de classification, de catégorisation. Il soutient que la langue, en tant que système, n’est pas intrinsèquement progressiste ou réactionnaire, mais qu’au contraire, elle est « fasciste », dans le sens où elle impose des modes de pensée et d’expression. Ce « fascisme », selon lui, ne réside pas tant dans l’interdiction de la parole que dans l’obligation de parler d’une certaine manière.
À son sens – et nous sommes bien d’accord – la littérature octroie la possibilité de subvertir et de remettre en question les normes linguistiques et culturelles, offrant ainsi un espace de liberté et de créativité. D’où l’importance des arts en général comme formes de résistance et d’innovation dans la communication humaine.

Roland Barthes (1915-1980) Sémiologue, essayiste, il a élaboré une pensée critique singulière, en constant dialogue avec la pluralité des discours théoriques et des mouvements intellectuels de son époque, tout en dénonçant le pouvoir de tout langage institué. Il est notamment l’auteur du Degré zéro de l’écriture (1953) et de Fragments d’un discours amoureux (1977).
Il entre au Collège de France en 1977 pour y occuper une chaire de sémiologie littéraire. Ce texte reproduit la leçon inaugurale qu’il y prononça le 7 janvier. Il y opère une véritable synthèse des différents volets de son œuvre. Du pouvoir inscrit dans la langue comme code, à ce qui dans la langue même l’esquive : la littérature. Et du signe comme objet de science autorisée, au texte comme plaisir d’être par le signe imaginairement capturé. Source : éditions Points.
Toute opportunité de subvertir les conventions linguistiques et de défier les structures de pouvoir établies, ouvrant la voie à de nouvelles formes d’expression et de pensée, est donc à saisir sans hésiter. Et si la littérature est le lieu de cette émancipation, nous nous en emparerons, ici aussi, avec espièglerie, chaque fois que l’occasion nous sera donnée de résister.

Le discours n’est pas seulement un message destiné à être déchiffré ; c’est aussi un produit que nous livrons à l’appréciation des autres et dont la valeur se définira dans sa relation avec d’autres produits plus rares ou plus communs. (…) Instrument de communication, la langue est aussi signe extérieur de richesse et un instrument du pouvoir. Et la science sociale doit essayer de rendre raison de ce qui est bien, si l’on y songe, un fait de magie : on peut agir avec des mots, ordres ou mots d’ordre. La force qui agit à travers les mots est-elle dans les paroles ou dans les porte-parole ? On se trouve ainsi affronté à ce que les scolastiques appelaient le mystère du ministère, miracle de la transsubstantiation qui investit la parole du porte-parole d’une force qu’elle tient du groupe même sur lequel elle l’exerce. Ayant ainsi renouvelé la manière de penser le langage, on peut aborder le terrain par excellence du pouvoir symbolique, celui de la politique, lieu de la prévision comme prédiction prétendant à produire sa propre réalisation. P. B.
Source : éditions Fayard.
Dans Ce que parler veut dire (1982), Pierre Bourdieu explore comment le langage est utilisé dans les interactions sociales et comment il reflète et renforce les structures de pouvoir au sein de la société.

Fils de rabbin,Victor Klemperer (1881-1960) fut professeur de philologie et de littérature française avant d’être destitué en 1935 pour être affecté à un travail de manoeuvre dans une usine. Il échappa de justesse à la déportation, puis à la mort lors du bombardement de Dresde. Après la guerre, il redevint professeur d’université dans la nouvelle RDA.
À partir de 1933, il tient un journal dans lequel il consigne toutes les manipulations du IIIe Reich sur la langue et la culture de son pays. Offrant un décryptage inédit de la novlangue nazie qu’il baptise LTI : Lingua Tertii Imperii, ses notes montrent comment le totalitarisme et l’antisémitisme s’insinuent dans le langage courant et s’inscrivent au plus intime de chacun. Par l’adoption mécanique et inconsciente de l’idéologie que véhiculent les mots, les expressions et les formes syntaxiques, cette langue de propagande agit comme un poison. LTI est plus qu’un acte de résistance et de survie, c’est un classique et une référence pour toute réflexion sur le langage totalitaire.
Source : éditions Albin Michel.
Dans LTI – La langue du IIIème Reich (1947), Victor Klemperer analyse minutieusement comment la langue a été manipulée sous le régime nazi, afin de servir de puissant outil de propagande et de contrôle. Il y examine la façon dont les nazis ont transformé l’allemand pour inculquer leur idéologie, en modifiant le vocabulaire, la syntaxe et les expressions. Son travail met en lumière l’importance cruciale de la langue dans la formation de la pensée et de la perception, et comment elle peut être utilisée pour manipuler et contrôler la société, en distillant le poison à inoculer dans les mots.
Un exemple notable de la façon dont le langage a été utilisé par les Nazis pour imposer leur idéologie est l’utilisation du terme « Endlösung » – Solution finale -, qui a servi à désigner l’extermination des Juifs de manière euphémistique, dissimulant la brutalité de l’acte derrière un langage bureaucratique et technique. Ce type de manipulation linguistique était courant dans la propagande nazie destinée à façonner la pensée publique en accord avec son idéologie.

J. L. Austin (1911-1960) Professeur à Oxford, il fut l’une des plus éminentes figures de la philosophie du langage ordinaire.
Certains énoncés sont en eux-mêmes l’acte qu’ils désignent. Ainsi, lorsque le maire prononce la formule rituelle « je vous marie », il marie par la seule énonciation de cette phrase ; même chose lorsqu’on baptise un enfant ou un navire, lorsqu’on fait une promesse, etc. Ces énoncés particuliers qui constituent par leur profération même ce qu’ils désignent, Austin les nomme performatifs. Cette trouvaille de génie a bouleversé la linguistique, y ouvrant un champ nouveau – celui de la théorie des actes de langage.Ce livre, novateur et subtil, écrit avec grâce et humour, est devenu l’un des classiques de la philosophie analytique anglo-saxonne. Source : éditions Points.
Il existe de nombreux autres exemples illustrant que dire n’a rien de candide. En attestent les énoncés performatifs : John Langshaw Austin souligne que lorsqu’un officiant dit « je vous déclare mari et femme », il n’est pas seulement en train de décrire une situation, il réalise une action par ses paroles.
Dans un autre registre, lorsque l’on nomme « patois », « dialecte » ou « langue régionale » une langue – c’est-à-dire un « ensemble de signes linguistiques et de règles (…) qui constituent l’instrument de communication d’une communauté donnée » – ce n’est pas davantage anodin. La façon de (dis)qualifier une chose peut implicitement modifier les représentations qu’elle génère : par exemple, une langue dite « haute », institutionnalisée – comme le français – se passe, elle, aisément, de qualificatifs.
Par ailleurs, les prénoms et patronymes qui nous suivent tout au long de notre existence, sont-ils de simples étiquettes ou des clés de notre identité ? Chaque prénom ou patronyme n’est-il pas chargé de de significations culturelles, familiales et sociales ? Prenons, par exemple, le prénom « Victoire », qui évoque un triomphe, ou « Ange » qui renvoie à un être doux et pur. Nommer un enfant, n’est-ce pas déjà l’inscrire dans un réseau complexe de significations et d’attentes ?
C’est pourquoi le naming et le choix des mots sont d’autant plus fondamentaux. Car, le nom est la toute première interface avec le public. C’est l’image de marque au sens littéral du mot. Si une image vaut mille mots, un nom convoque aussitôt une image qui lui est associée. Ainsi, qu’il soit lu ou entendu, c’est ce nom qui sera perçu et étiqueté à la vitesse de l’éclair au chocolat. C’est pourquoi créer un nom et outiller avec les mots justes est un travail d’orfèvre, qui permet aux marques de se faire re-marquer en se dé-marquant dans le marché concurrentiel. Et ce pas de côté se fait souvent avec un brin d’audace et de goût pour la subversion du langage.
Alors réarmons la pensée en dehors des maux du pouvoir, parce que penser, c’est résister de façon désarmante.
- Ce vaste sujet s’inscrira dans un article à venir sur la différence entre le politiquement correct, la langue de bois et la novlangue. ↩︎