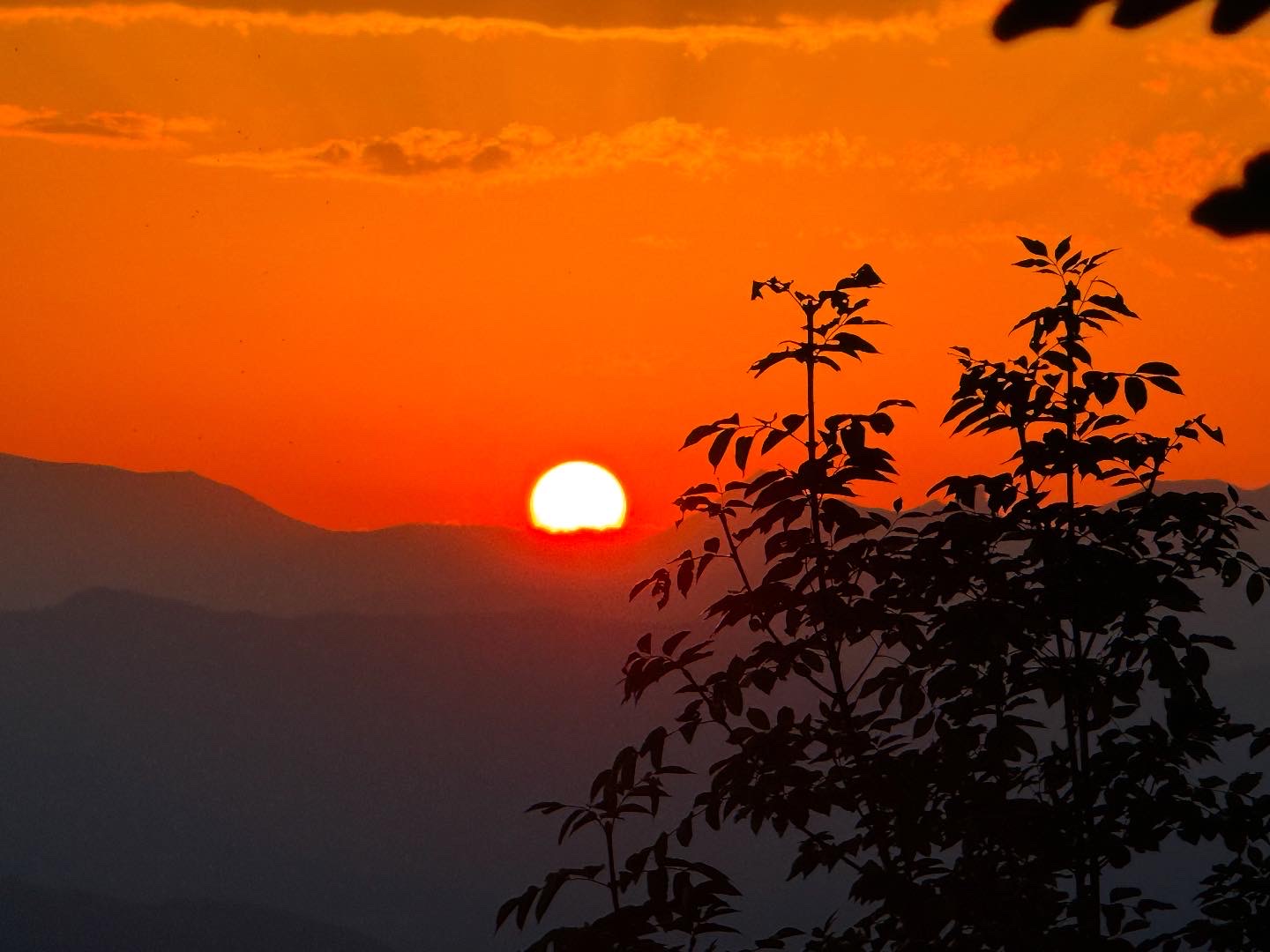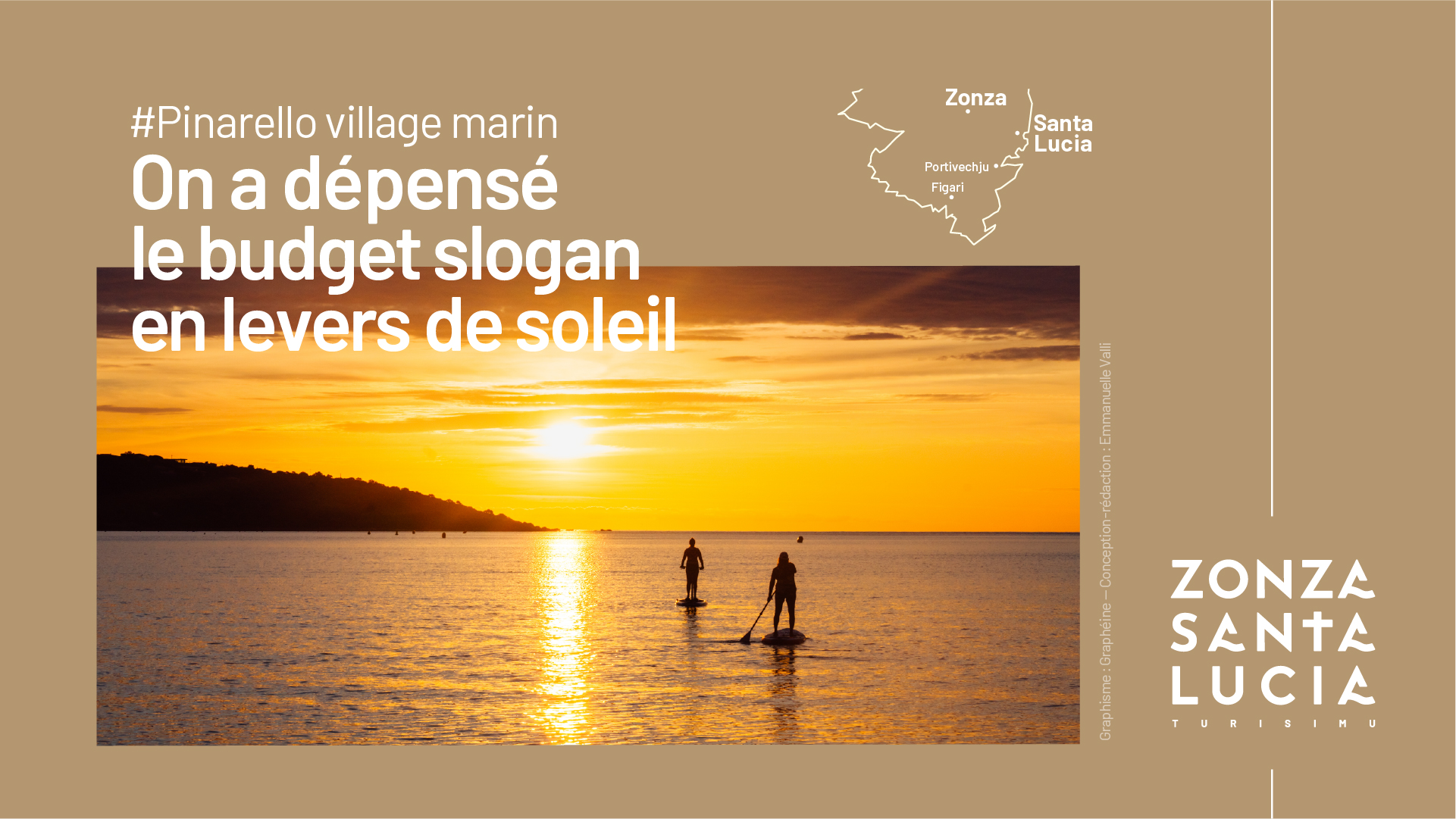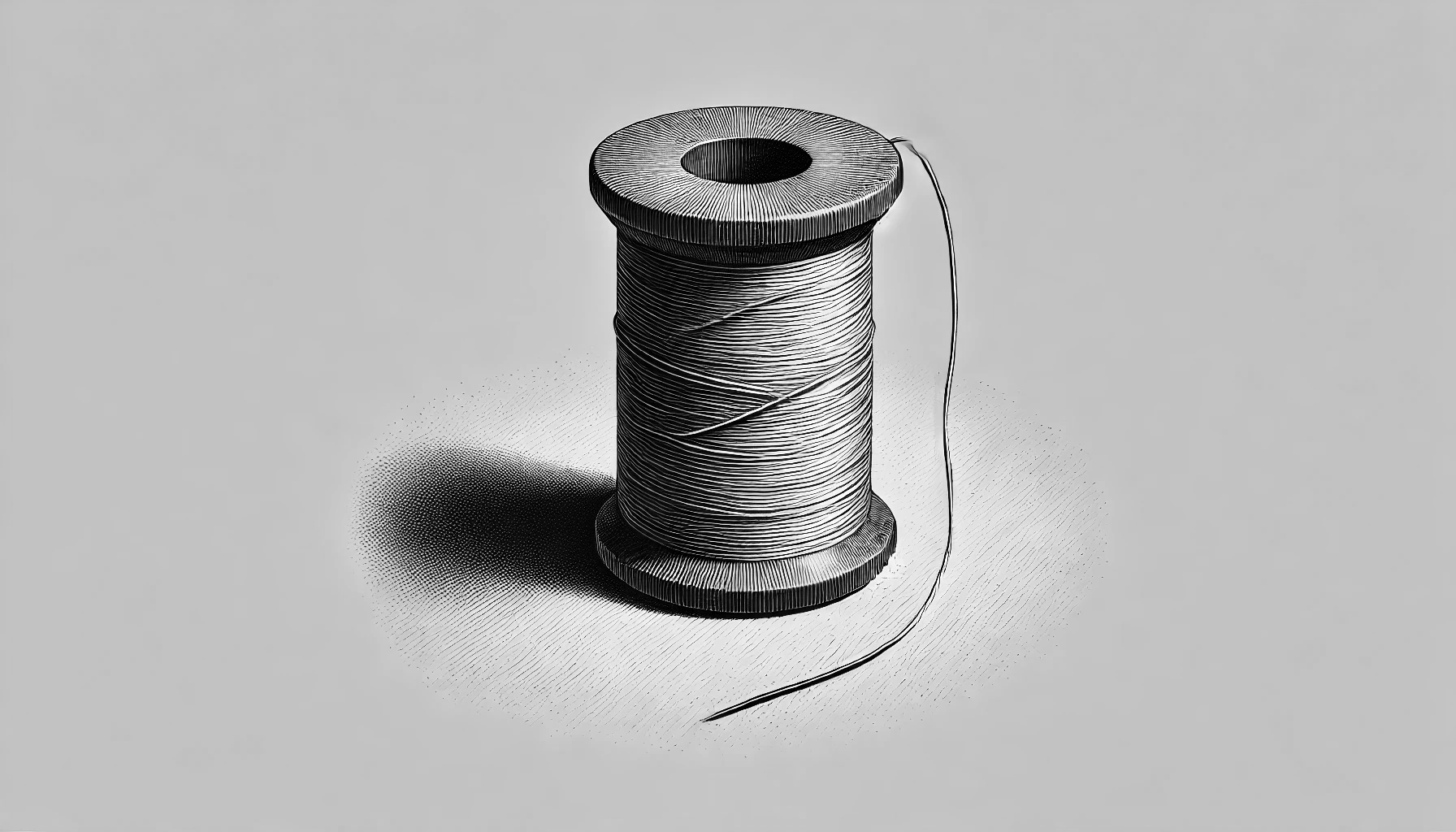Missak Manouchian, poète arménien et ouvrier communiste atypique, était le chef des résistants de l’Affiche rouge. Internationaliste ouvert à l’inclusion de tous dans la lutte contre l’oppression – y compris au-delà des clivages staliniens – il fera son entrée, ce jour – 21 février 2024 – avec son épouse Mélinée – résistante comme lui – au Panthéon.
En cette occasion, revenons un instant sur cette affiche, devenue symbole de résistance, de lutte, et aussi, on pourrait dire, de propagande râtée.
Dans les rues de Paris occupée par les nazis, une affiche déchirée flotte au gré du vent. Créée par l’appareil de propagande allemand, en février 1944, l’Affiche rouge exhibe les visages de ceux qui sont accusés de crimes et d’actes de sabotage contre l’occupant.
Elle est structurée en 3 parties : D’une part, une question, tout en haut : « Des libérateurs ? ». D’autre part, une réponse, tout en bas : « La libération par l’armée du crime ! ». Enfin, un triangle rouge pointe vers le bas, dans lequel figurent les photos de 10 résistants du groupe Manouchian. Sous chacune d’elle est inscrit leur nom, leur origine et les actions qu’ils ont mené. La pointe du triangle, telle une lame acérée, désigne des photos d’attentats et de saisies d’armes : autant de méfaits et de menaces que ces criminels font peser sur la France. Le message semble clair et sans appel : ces hommes sont des criminels.

L’Affiche Rouge est une affiche de propagande diffusée par les autorités d’occupation allemande et le régime de Vichy, en février 1944, visant à discréditer le groupe de résistants étrangers, membres de la FTP-MOI (Francs-Tireurs et Partisans – Main-d’OEuvre Immigrée), dirigé par Missak Manouchian. Le groupe mena plusieurs actes de résistance, notamment des attentats et des assassinats de hauts fonctionnaires nazis et de collaborateurs.
L’affiche représente les portraits de 10 hommes du groupe, dont Missak Manouchian, sous le titre accusateur « Des libérateurs ? La libération par l’armée du crime ! », s’attelant à stigmatiser ces résistants comme des criminels.
Tous ces hommes, ainsi que d’autres, furent fusillés, le 21 février 1944, au Fort du Mont Valérien.
21 février 1944 – 21 février 2024. 80 ans. Une vie humaine. Plusieurs, en réalité.
Afin de ne pas manquer sa cible, l’affiche sera soigneusement étayée de reportages filmés, d’articles de presse et de nombreux tracts.

1 image vaut mille mots, mais 1000 mots qui accompagnent l’image, c’est renforcer son pouvoir et encadrer son interprétation.
Elle utilise des codes visuels et textuels forts dans le but de communiquer son message lapidaire.
La couleur rouge, dominante, renvoie aux connotations de danger et de violence et l’on perçoit l’intention manifeste d’associer directement le groupe Manouchian à ces notions, dont les membres sont mis en avant comme de dangereux terroristes. Attention, ne résistez pas, tremblez !
Le rouge évoque également leur appartenance politique au parti communiste, ainsi que le sang qui a coulé. Louis Aragon dans « Strophes pour se souvenir » la décrira comme « l’affiche qui semblait une tache de sang », renvoyant aujourd’hui à celui versé par ces résistants aux noms étrangers morts pour la France.

« Vous aviez vos portraits sur les murs de nos villes
Noirs de barbe et de nuit hirsutes menaçants
L’affiche qui semblait une tache de sang
Parce qu’à prononcer vos noms sont difficiles
Y cherchait un effet de peur sur les passants »
Les photos des résistants, accompagnées de leurs noms, leurs origines et des crimes dont on les accuse, dans la manière dont elles sont agencées, font l’effet d’une galerie de terroristes. Ces portraits d’hommes hirsutes et sans doute de fatigue accablés, ont clairement vocation à capter le regard des passants mais, surtout, à les effrayer. Le contraste entre le noir, le blanc livide des portraits et le rouge flamboyant de l’affiche, participe à générer une tension oculaire immédiate.
En mettant en avant l’origine des résistants, l’intention manifeste est d’accentuer la peur de l’Autre, afin d’isoler la Résistance, suggérant qu’elle est l’œuvre d’étrangers malveillants, plutôt que d’un mouvement de libération nationale.

Le xénophobie – (dé)masquée – qui se nourrit de cette peur, en exploitant stéréotypes et préjugés, n’est pas sans rappeler certaines tendances que l’on a pu (re)connaître, des années plus tard, dans des affiches de propagande électorale, toujours promptes à convoquer l’effet haine derrière la menace de notre sécurité (cf. « Le FN : 40 ans d’affiches« ).
Ainsi, l’Affiche rouge illustre ces tentatives des nazis, vichystes et d’autres régimes autoritaires, qui utilisent la communication visuelle, comme arme de propagande, afin de tenter de légitimer leur autorité, d’asseoir leurs narrations et de discréditer leurs opposants.
Les moyens sont légions, d’autant plus aujourd’hui, pour qui centralise les pouvoirs et impose la terreur, d’effacer l’opposition et les velléités d’insurection. En atteste tristement la mort récente d’Alexeï Navalny, téméraire et principal opposant dans une Russie où la liberté d’expression est euphémiquement muselée et sévèrement punie.
Alexeï Navalny, principal opposant de Vladimir Poutine, est mort le 16 février 2024, à l’âge de 47 ans, dans sa prison sibérienne, où il purgeait une peine de dix-neuf ans « pour extrémisme« .
Sans surprise, service minimum dans la presse russe, qui évoque un « caillot de sang« . Quelques rares médias d’opposition, souvent basés à l’étranger, ont dénoncé la propagande du Kremlin au sujet de l’opposant.
Pour revenir à l’Affiche Rouge, elle nous remémore également les tensions extrêmes qui règnent dans une France occupée, où la résistance active est réprimée avec une brutalité impitoyable. C’est aussi la tentative désespérée de l’occupant de maintenir son contrôle sur un territoire qui s’effrite sous la pression de la résistance intérieure.
Fort heureusement, en février 1944, les Allemands ont essuyé d’importants revers militaires, dont la déroute de Stalingrad (février 1943) qui marque un tournant de la guerre. En juillet 1943, les Alliés débarquent en Sicile et deviennent pratiquement maîtres de l’Afrique du Nord et de l’Italie. La défaite paraît désormais possible, voire inévitable.
Aussi, l’effet de l’affiche ne fut pas celui escompté par ses odieux créateurs : au lieu de susciter la peur, la haine et le rejet, elle provoqua admiration et empathie envers les résistants, chez une partie de la population française. Le message intentionnel et initial de dénigrement fut détourné, élevant définitivement ces martyrs au rang de héros. Un détournement qui donne espoir en la capacité des sociétés à résister et à se réapproprier les tentatives de manipulation idéologique.
La dernière lettre de Missak Manoukian à Mélinée, donne également à voir cette beauté qui parvient parfois à s’extraire et émane, bouleversante et lumineuse, de la nature humaine.

21 février 1944. Dernière Lettre de Missak Manouchian écrite à son épouse, Mélinée, depuis la prison de Fresnes, quelques heures avant qu’il soit fusillé au fort du Mont Valérien.
« Ma Chère Mélinée, ma petite orpheline bien-aimée,
Dans quelques heures, je ne serai plus de ce monde. Nous allons être fusillés cet après-midi à 15 heures. Cela m’arrive comme un accident dans ma vie, je n’y crois pas mais pourtant je sais que je ne te verrai plus jamais.
Que puis-je t’écrire ? Tout est confus en moi et bien clair en même temps.
Je m’étais engagé dans l’Armée de Libération en soldat volontaire et je meurs à deux doigts de la Victoire et du but. Bonheur à ceux qui vont nous survivre et goûter la douceur de la Liberté et de la Paix de demain. Je suis sûr que le peuple français et tous les combattants de la Liberté sauront honorer notre mémoire dignement. Au moment de mourir, je proclame que je n’ai aucune haine contre le peuple allemand et contre qui que ce soit, chacun aura ce qu’il méritera comme châtiment et comme récompense.
Le peuple allemand et tous les autres peuples vivront en paix et en fraternité après la guerre qui ne durera plus longtemps. Bonheur à tous…
J’ai un regret profond de ne t’avoir pas rendue heureuse, j’aurais bien voulu avoir un enfant de toi, comme tu le voulais toujours. Je te prie donc de te marier après la guerre, sans faute, et d’avoir un enfant pour mon bonheur, et pour accomplir ma dernière volonté, marie-toi avec quelqu’un qui puisse te rendre heureuse. Tous mes biens et toutes mes affaires je les lègue à toi à ta sœur et à mes neveux. Après la guerre tu pourras faire valoir ton droit de pension de guerre en tant que ma femme, car je meurs en soldat régulier de l’armée française de la libération.
Avec l’aide des amis qui voudront bien m’honorer, tu feras éditer mes poèmes et mes écrits qui valent d’être lus. Tu apporteras mes souvenirs si possible à mes parents en Arménie. Je mourrai avec mes 23 camarades tout à l’heure avec le courage et la sérénité d’un homme qui a la conscience bien tranquille, car personnellement, je n’ai fait de mal à personne et si je l’ai fait, je l’ai fait sans haine. Aujourd’hui, il y a du soleil. C’est en regardant le soleil et la belle nature que j’ai tant aimée que je dirai adieu à la vie et à vous tous, ma bien chère femme et mes bien chers amis. Je pardonne à tous ceux qui m’ont fait du mal ou qui ont voulu me faire du mal sauf à celui qui nous a trahis pour racheter sa peau et ceux qui nous ont vendus. Je t’embrasse bien fort ainsi que ta sœur et tous les amis qui me connaissent de loin ou de près, je vous serre tous sur mon cœur. Adieu.
Ton ami, ton camarade, ton mari. Manouchian Michel.
P.S. J’ai quinze mille francs dans la valise de la rue de Plaisance. Si tu peux les prendre, rends mes dettes et donne le reste à Armène. M. M. »
Ainsi, l’Affiche rouge – s’est affranchie de la tentative de stigmatisation de départ de ses auteurs – en devenant un symbole de résistance, de courage et de la lutte contre l’oppression.
Elle nous rappelle le pouvoir paradoxal des images et des mots et la capacité indomptable de l’esprit humain qui décide de se battre pour la justice et la liberté, face aux plus grandes adversités.
Pour finir, « L’affiche rouge« , ce sont aussi des mots poétiques, mis en musique par Léo Ferré, en 1961. Devenue un classique, dont on ne compte plus celles et ceux qui en ont repris les paroles, la chanson a été reprise, il y a peu par Feu ! Chatterton. Mais c’est Louis Aragon, qui publie le texte pour la première fois, dans L’Humanité, en 1955. Il sera intégré, l’année suivante, au Roman inachevé, sous le titre « Strophes pour se souvenir ».
Parce que je l’affectionne tout particulièrement et que je la trouve tout à fait épidermiquement bouleversante, je partage également la version corse « Quellu affissu zifratu« , interprétée par Jacky Micaelli.