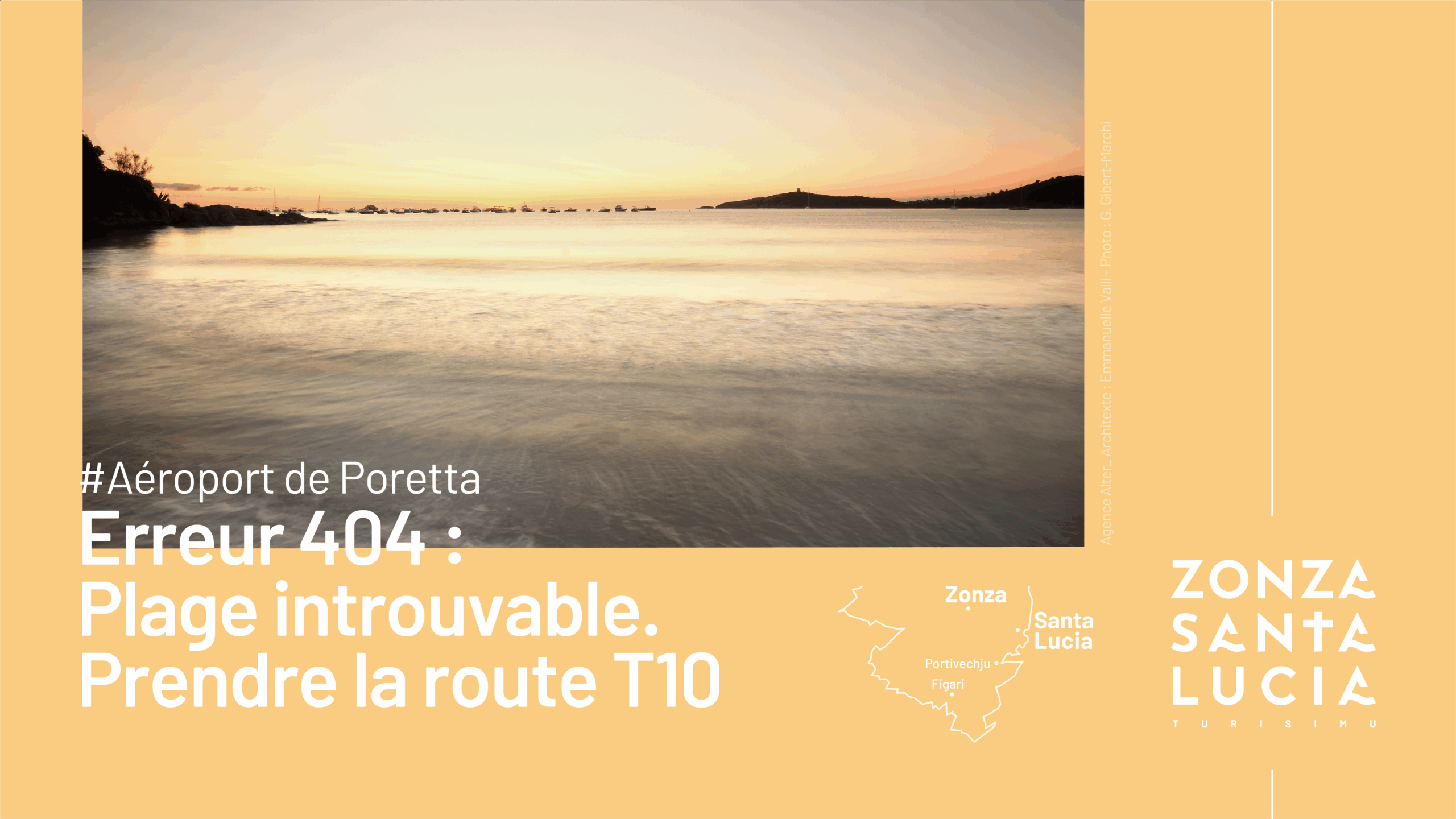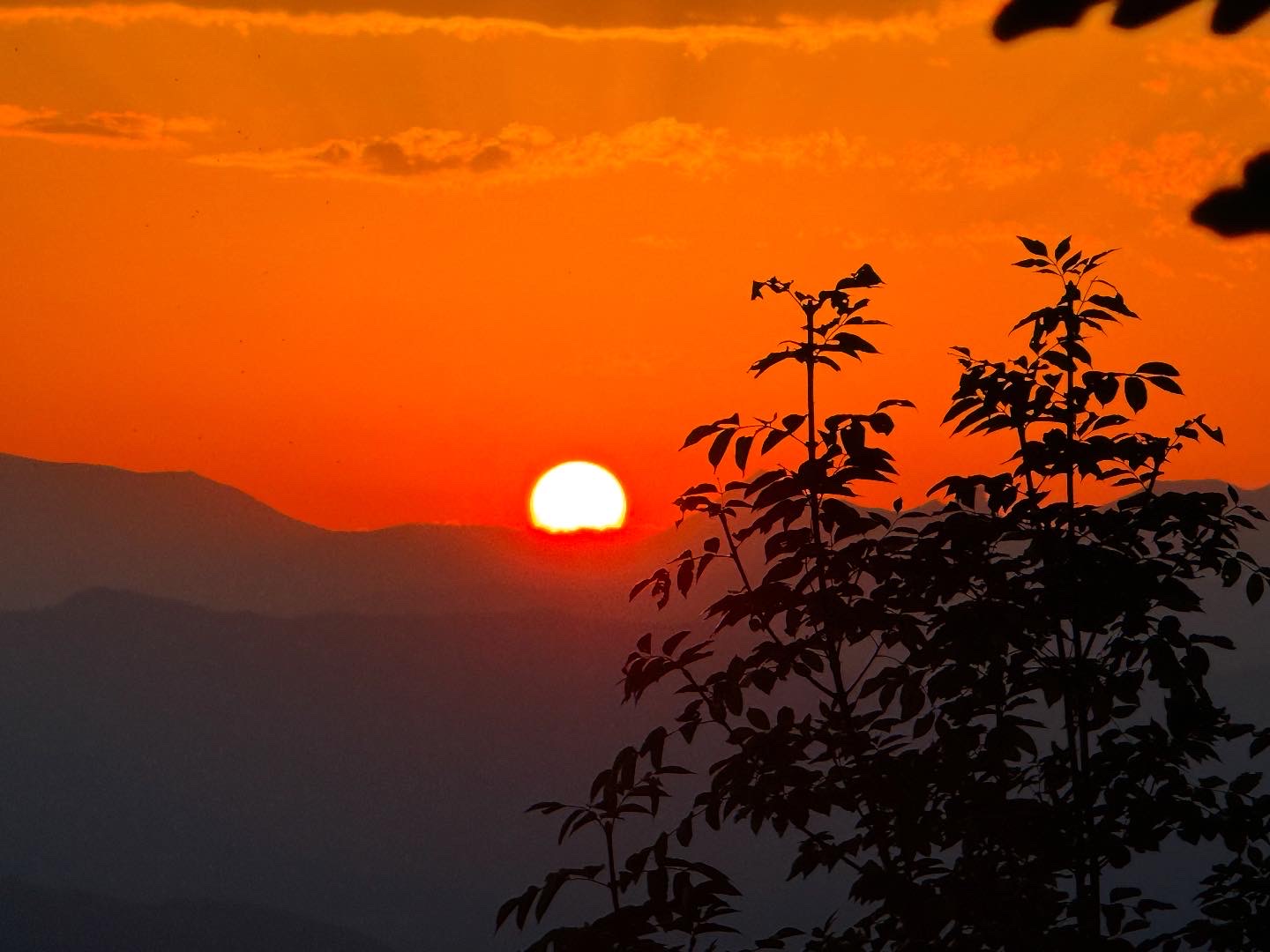Enfant, je vivais dans un petit village, désormais très acquis à l’extrême droite. J’ai eu la chance d’avoir accès à des livres qui m’ont transportée des pages d’images, aux Trésors légendaires des pays lointains (1979), aux Fleurs du Mal (1857), aux portraits ciselés de Stefan Zweig, en passant par l’absurde de Samuel Beckett ou le réalisme magique de Gabriel García Márquez et par une montagne de classiques – divers et variés. Des contrées littéraires immenses où la découverte de l’altérité la meut en trésor et où les méandres de l’esprit humain ne sont pas blancs ou noirs mais teintés de nuances, et la liberté d’ambivalences et de complexité, où le regard apprend à rester humble face au vivant et à respecter nos (dis)semblables même les plus éloignés.

Contes d’Egypte, Babylonie, Inde, Océanie, Corée, Chine, Mongolie, Terre de Feu, Afrique noire…
Les livres et la finesse des plumes que j’ai eu le bonheur de lire au cours du voyage m’ont ouvert l’esprit. Donnez des livres aux enfants. Des lettres et de la poésie, des mots pour pouvoir dire N-O-N aux « passions tristes« et aux thèses simplistes ou réductrices. Pour préférer lire que l’ire, même si la colère doit pouvoir s’exprimer sainement.
« Les plus beaux versets de la charité, les voici : supporter les défauts d’autrui, non point les juger. Être juste, ce n’est pas juger, c’est comprendre. »
[ Victor Hugo. Les Misérables, 1862 ]
Dans Eichmann à Jérusalem (1963), Hannah Arendt développe son concept sur la « banalité du mal » en mettant en évidence que le mal – loin d’être banal – peut s’enraciner dans le vide de la pensée de l’humain lambda, de monsieur Toutlemonde, si l’on n’y prête pas garde, parce que c’est plus facile.

Voici un texte qui, par la controverse qu’il suscita dès sa parution chez les historiens, eut le mérite essentiel de contraindre ceux-ci à entreprendre des recherches nouvelles sur le génocide des Juifs par les nazis.
En effet, le reportage d’Hannah Arendt, envoyée spéciale du New Yorker au procès de Jérusalem, philosophe américaine d’origine juive allemande, auteur d’un ouvrage célèbre sur les origines du totalitarisme, fit scandale à New York et à Londres, en Allemagne comme en Israël.
Dans son procès du procès, l’auteur – qui ne fait siens ni tous les motifs de l’accusation ni tous les attendus du jugement – est entraîné d’abord à faire apparaître un nouvel Eichmann, d’autant plus inquiétant qu’il est plus « banal » ; puis à reconsidérer tout l’historique des conditions dans lesquelles furent exterminés des millions de Juifs. Et à mettre en cause les coopérations, voire les « complicités », que le lieutenant-colonel S.S. a trouvées dans toutes les couches de la population allemande, dans la plupart des pays occupés, et surtout jusqu’au sein des communautés juives et auprès des dirigeants de leurs organisations.
La personnalité de l’auteur, la controverse qu’elle a partout suscitée et qu’analyse Michelle-Irène Brudny-de Launay dans sa présentation, contribuent à faire de ce livre brillant un témoignage que l’on ne peut ignorer sur une des énigmes majeures du monde contemporain.
Source : éditions Gallimard.
Parce que de fatigue harassé, le désespoir se nourrit parfois de haine, puisant dans les recoins les plus sombres pour alimenter son fiel. Lorsque l’épuisement étreint le quotidien et la pensée, la facilité se drape d’un voile séduisante, nous invitant à déléguer nos décisions à un autre, à nous ranger derrière un nouveau (re)père. Cet autre, auréolé de promesses incroyables et du bénéfice de sa nouveauté – à qui on croit n’avoir encore jamais « donné sa chance », car on ignore sa propre histoire -, semble alors offrir une issue là où tant d’autres ont échoué. Même lorsqu’il clame que la haine est la « solution finale« .

« Par lassitude devant l’effroyable multiplicité des problèmes, la complexité et les difficultés de la vie, la grande masse des hommes aspire à une mécanisation du monde, à un ordre définitif, valable une fois pour toutes, qui leur éviterait tout travail de pensée. »
[Stefan Zweig]
Pourtant, l’amour et la pensée complexe sont des chemins plus féconds et plus dignes que la peur et le rejet de l’Autre. Là où la stratégie du bouc émissaire divise, l’amour unit et élève. Un choix juste, éthique et moral, permet à chacun de se tenir devant le miroir et de se regarder droit dans les yeux, sans pâlir ou rougir de honte. Cette intégrité constitue une richesse infiniment plus fondamentale que tous les miracles promis par des prophètes d’occasion.
« Nous sommes seuls sans excuses. C’est ce que j’exprimerai en disant que l’homme est condamné à être libre. Condamné, parce qu’il ne s’est pas créé lui-même, et cependant libre, parce qu’une fois jeté dans le monde, il est responsable de tout ce qu’il fait. »
[ Jean-Paul Sartre, L’existentialisme est un humanisme, 1946 ]
S’il est difficile et éreintant d’être un sujet responsable, il n’existe pas d’autre voie pour rester humain. Chaque individu possède non seulement le droit, mais surtout le devoir de penser en conscience, de brandir son esprit critique et éclairé face aux ténèbres qui grondent.
« Chaque génération, sans doute, se croit vouée à refaire le monde. La mienne sait pourtant qu’elle ne le refera pas. Mais sa tâche est peut-être plus grande. Elle consiste à empêcher que le monde se défasse. »
[ Albert Camus, Discours de Suède, 1957 ]
On a besoin de mots qui font sens. D’un « mot » qui s’écrit – et s’écrie ! – avec M [aime] et non avec N [haine], qui le transformerait en « not », la négation de tout. Si chaque lettre conte, chaque voix compte : aux urnes, pour dire N-O-N à l’extrême droite !