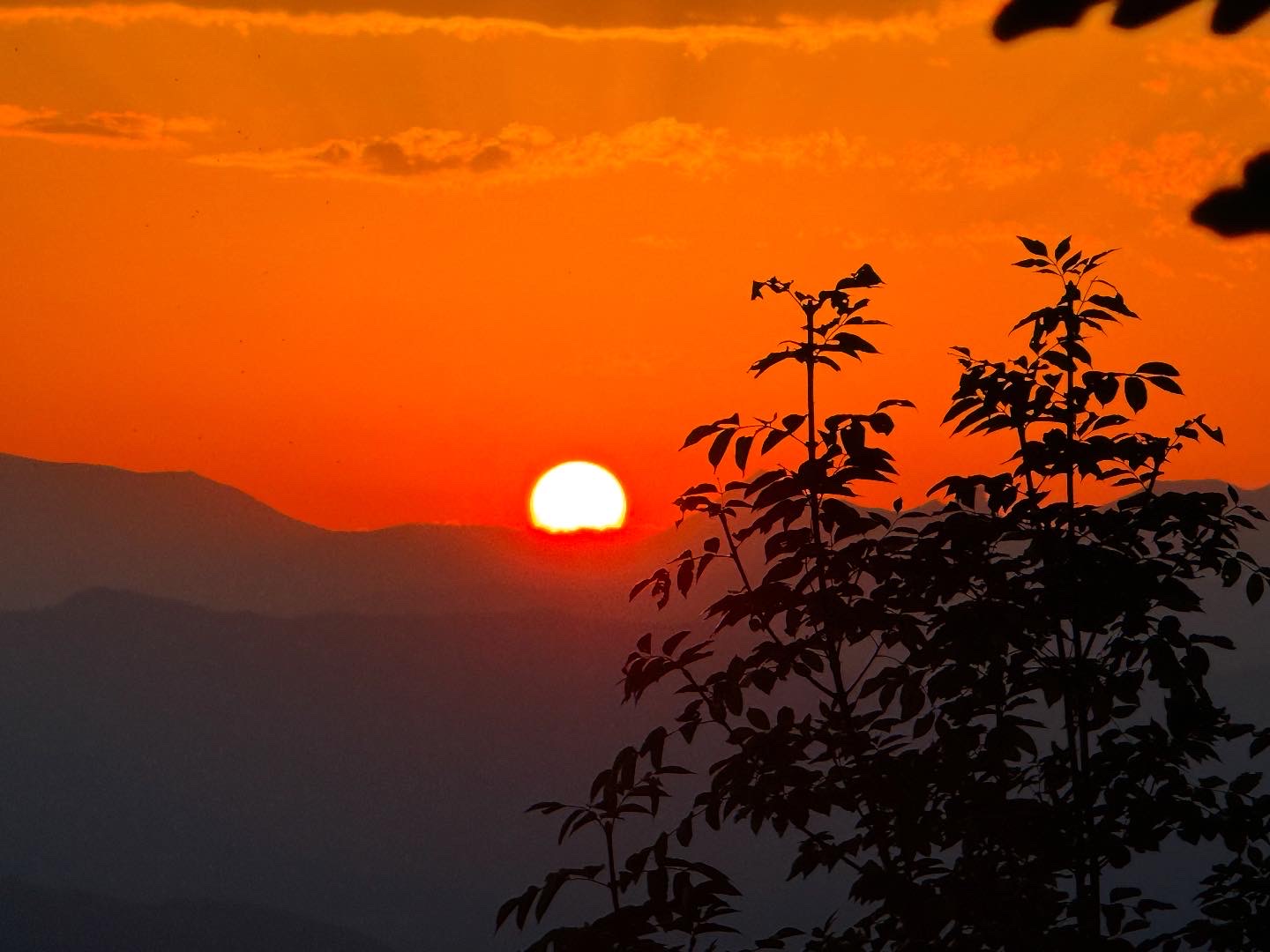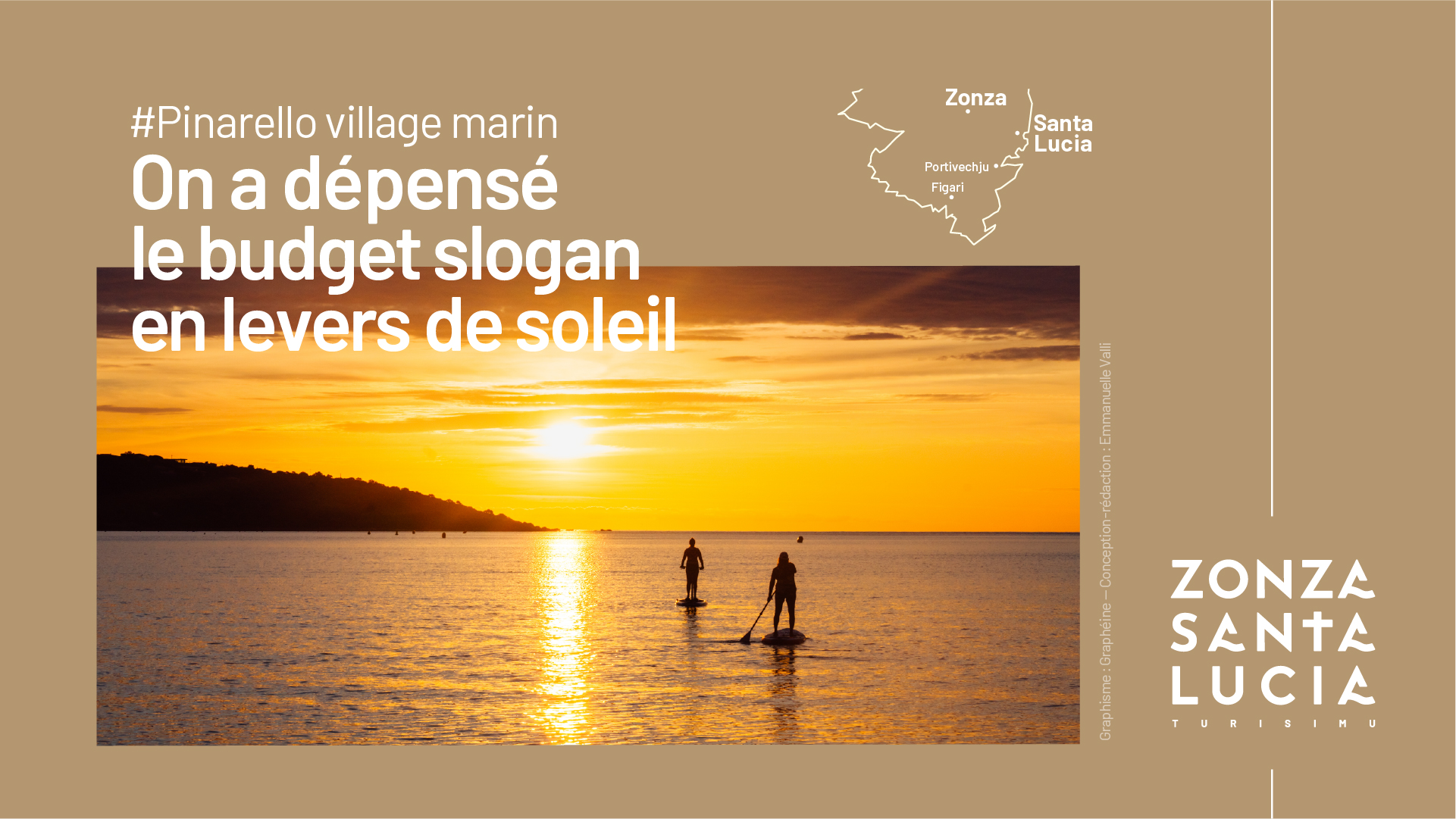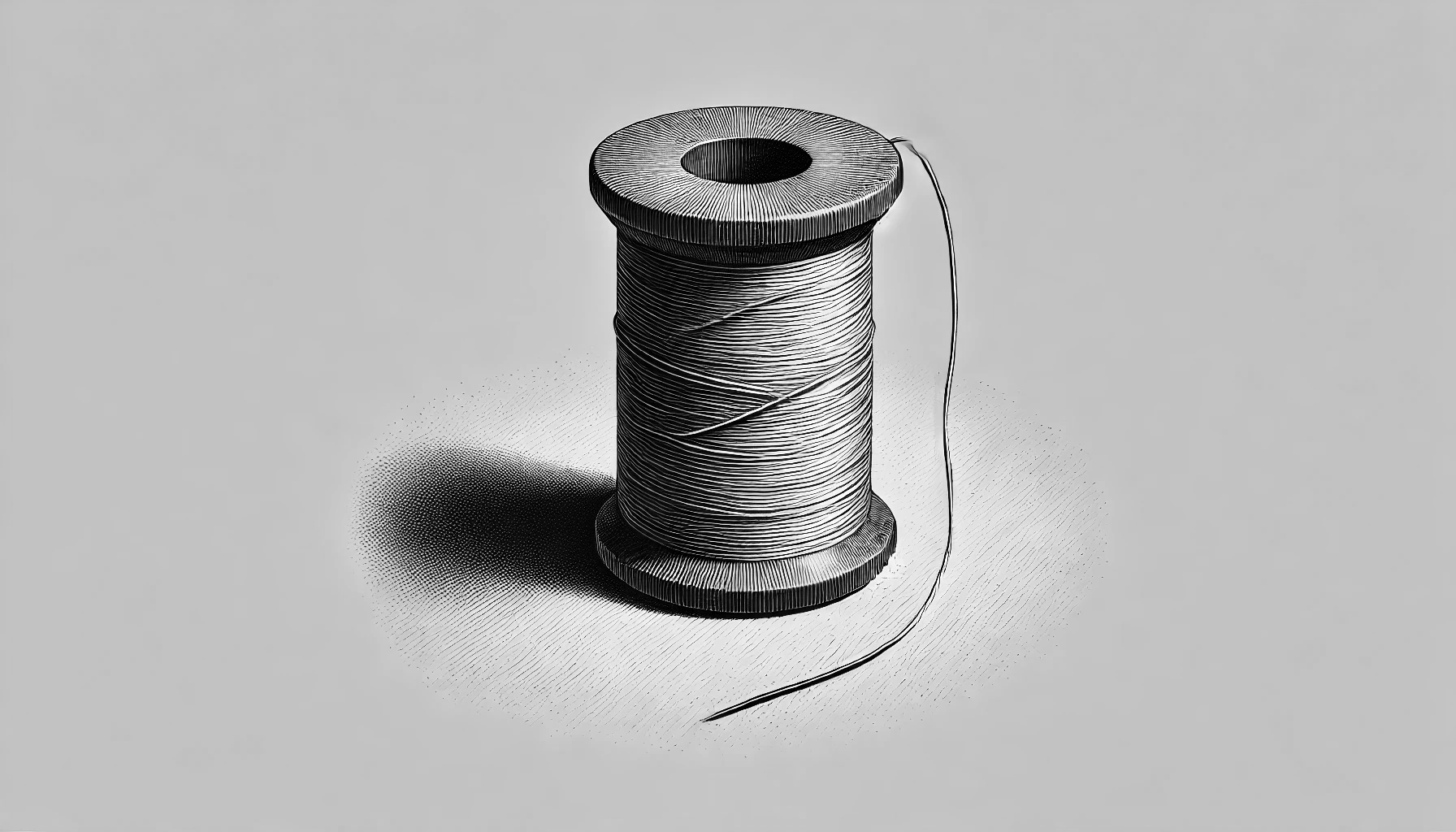Voici une sorte de « compte-rendu » opportuniste d’un entretien entre Dominique de Villepin et Edwy Plenel – dans l’émission « L’Échappée », sur Mediapart – que j’ai trouvé profondément sensé et poétique. C’est assez rare pour avoir envie de lui donner de la visibilité, le transmettre, puis l’archiver ici, pour ne pas le perdre de vue.
L’émission est enregistrée au musée du Quai Branly – Jacques Chirac. Un choix qui n’est sans doute pas anodin, car c’est « un lieu qui fait vivre la diversité, la richesse et la beauté des cultures du monde, des arts lointains, des arts premiers et qui nous rappelle qu’il n’y a pas de civilisations paraissant supérieures à d’autres, de nations, de peuples qui peuvent prétendre dominer d’autres nations et d’autres peuples », comme le dit si bien Plenel.
« À l’heure où les tenants de la hiérarchie des humanités ont le vent en poupe, à l’heure où ils rodent partout, à l’heure où ils sont même à la tête de la première puissance militaire mondiale, les États-Unis d’Amérique », il n’est pas superflu de s’interroger sur le devenir de ce monde dont le sens semble parfois vouloir échapper à notre entendement.
« Un monde meilleur » : le 14 février 2003, lorsque de Villepin prend la parole devant les Nations Unies, il clame qu’il faut savoir se tenir debout, face à l’histoire et devant les hommes. C’est encore tellement vrai aujourd’hui.
Dans cette magnifique émission, plusieurs thèmes fondamentaux émergent et se croisent pour tisser un fil rouge entre la fragilité humaine, la quête de puissance et l’impérieuse nécessité de réinventer notre rapport au monde, à l’Autre, et c’est notre identité humaine qui est en « Je » et surtout en « Nous ».
L’Europe est-elle encore là pour garder vivante cette conception d’une idée de l’homme, d’une fraternité, d’une solidarité possible. Sommes-nous capables de tirer des leçons de l’histoire ?
“Make America Great Again” (Donald Trump) et “We are the greatest nation on off” (Kamala Harris) illustrent un illimitisme de l’accumulation, de puissance de pouvoir, de conquête, d’argent. Est-ce qu’il ne faudrait pas revoir cet imaginaire de la surenchère et défendre plutôt un imaginaire de la précaution ?
Dès le début, De Villepin invoque Paul Celan et son poème « Confiance », extrait du recueil Grille de parole, (1955) :
Il y aura encore un œil
Il y aura un cil
Planté au-dedans de la roche
Durci à l’acier du non-pleuré
Devant nous, il fait son ouvrage
Comme si, parce que la pierre existe
Il y avait encore des frères.
Selon Dominique de Villepin, c’est aujourd’hui ce qu’il faut sauver : la pierre qui est la réalité irréfragable et la fraternité. C’est ce fil qui court entre des choses si fragiles et dont il faut prendre soin, c’est ce qu’il faut aujourd’hui défendre..
À une époque obsédée par la grandeur et la domination – thèmes défendu par Hubert Védrine, dans les années 90, avec son concept d’ »hyperpuissance » – dans ce rapport entre la fragilité et la puissance, la réflexion de De Villepin sur la « vanité de la puissance » souligne bien ce mirage dont l’Histoire ne cesse de rappeler l’inanité. Selon lui, toute hyperpuissance, quelle qu’elle soit, ne peut jamais rien contre des forces qui la dépassent et la débordent. Chaque fois, il y a une résistance sociale, une résistance du peuple qui triomphe à la fin.
De Villepin appelle à doter l’Europe de réseaux sociaux, afin de donner une éthique aux technologies. Il revient sur l’idée de « multi-alignement », issue du gaullisme, pour défendre l’indépendance de la France dans un monde fragmenté, où les logiques transactionnelles à la Donald Trump semblent triompher.
À quoi servent la poésie, la philosophie et la littérature si c’est pour se comporter de façon inhumaine ? À quoi bon avoir un Levinas et connaître sa théorie sur le visage de l’Autre, si ce n’est pas pour la faire résonner ?
De Villepin évoque également l’esprit d’Ubuntu – « Je suis parce que nous sommes » – pour souligner l’interdépendance et la pluralité des voix humaines, menacée par les résurgences d’une pensée ségrégationniste. L’apartheid, légiféré en Afrique du Sud dès 1948, semble encore tristement posséder ses adeptes nostalgiques d’un monde séparé, comme Elon Musk, par exemple.
Il pointe également le risque de l’essentialisation de l’Autre – qu’elle vise des groupes ou des individus, y compris des hommes politiques – pour ce qu’ils symbolisent et donc, le risque de leur diabolisation. Accentuée par les conséquences de la technologie qui tendent à dissoudre le lien social, la méconnaissance de l’Autre nourrit la peur, qui mène à l’ignorance, jusqu’à parfois aboutir à son effacement.
En outre, à son sens, la vanité de la puissance traversera le XXIe siècle – Shoah, Hiroshima, apocalypse climatique, etc. Ce qui va se transformer le plus, au cours des prochaines années, est l’arsenal de la guerre – robots, quantique, etc. – mais la limite de cette évolution est qu’il y aura toujours des gens pour produire des antidotes : l’homme possèdera toujours l’esprit de ruse – cf. Ulysse – mais De Villepin insiste : il faut transmettre aux jeunes l’indépendance d’esprit, car il suffira toujours de quelques individus du peuple, issus de la diversité, pour se muer en sentinelles capables de résister.
Il exhorte aussi à relire Jan Patočka, Albert Camus, Hannah Arendt et Walter Benjamin, et à puiser dans leurs enseignements pour éclairer nos actions. La transformation ne viendra pas des élites mais du peuple, des gens simples, par des actions aussi simples que le fait de mettre un bulletin de vote dans l’urne, pour qu’elle ne soit devienne pas funéraire.
Ce qui est certain selon lui, c’est que l’on ne peut pas prétendre parler au monde en employant le langage de la surenchère – encore plus de vues, likes, etc. : la politique doit permettre d’établir un lien entre un homme et un peuple, de part et d’autre, fondé sur la satisfaction créatrice et l’éloge du doute cartésien, pour avancer.
Petrus Borel, Stanislas Rodanski, Antonin Artaud, Gérard de Nerval, Jeanne Vacher, ces gens, dans le chemin douloureux qu’ils ont choisi, sans aucune forme de compromis – fidélité à une révolte, fidélité à une souffrance – n’ont jamais transigé et ils ont appris quelque chose qu’ils transmettent à travers la poésie qu’il faut aller boire, car nous nous trouvons dans des mondes où il y a trop de compromissions, où il y a une trop grande banalisation, selon De Villepin.
Si nous avons bien intégré le concept de la « banalisation du mal« , grâce à Hannah Arendt, il n’en demeure pas moins un autre danger qui est l’absolutisation du bien : dans les combats théologiques pour un dieu, dans ceux absolutistes pour éloigner ou exclure l’Autre, il existe aussi un danger épouvantable. C’est pourquoi, il ne faut pas perdre de vue l’idée que les horreurs que nous avons connues au XXe siècle peuvent renaître. Cependant, elles ne renaîtront pas forcément là où nous les attendons. Et c’est en cela qu’il faut rappeler à tous les intégristes – qu’ils soient républicains ou islamistes – de toujours s’ouvrir à la réalité de l’Autre, de toujours être capable de s’ouvrir au doute et toujours accepter de s’ouvrir à cette remise en cause de soi-même.
Aimé Césaire dans son poème « Nouvelle bonté » proclame : « il n’est pas question de livrer le monde aux assassins d’aube« . De même que quand il rend hommage à un grand vaincu, Toussaint Louverture, il cite une petite note posthume de Victor Hugo : « .un abîme est là, tout près de nous, nous, poètes, nous rêvons au bord, vous, hommes d’Etat, vous y dormez« .
À la question « quelle est la qualité principale d’un homme politique ? », François Mitterand avait répondu « l’indifférence », or, selon De Villepin, il faut bel et bien être traversé des malheurs du monde. C’est finalement Edouard Glissant qui le traduit le mieux en évoquant la nécessité de s’inscrire dans « le tremblement du monde ».
Aussi, c’est peut-être dans cet équilibre, entre ouverture au doute et capacité d’action, que réside la clé pour affronter les défis de notre siècle, sans que le pouvoir ne mue en despotes aux égos surdimensionnés les dirigeants que nous avons promus par les urnes.