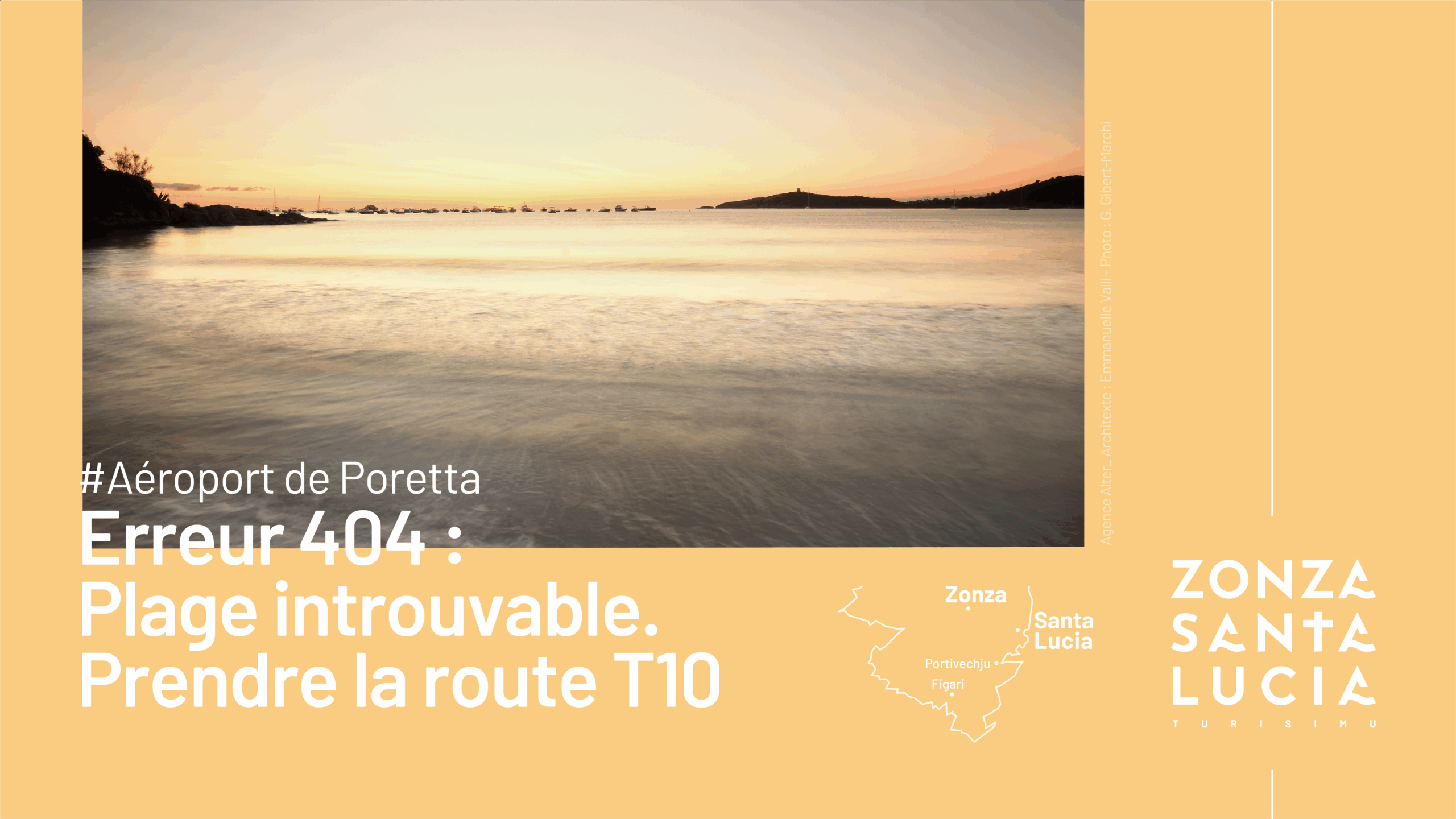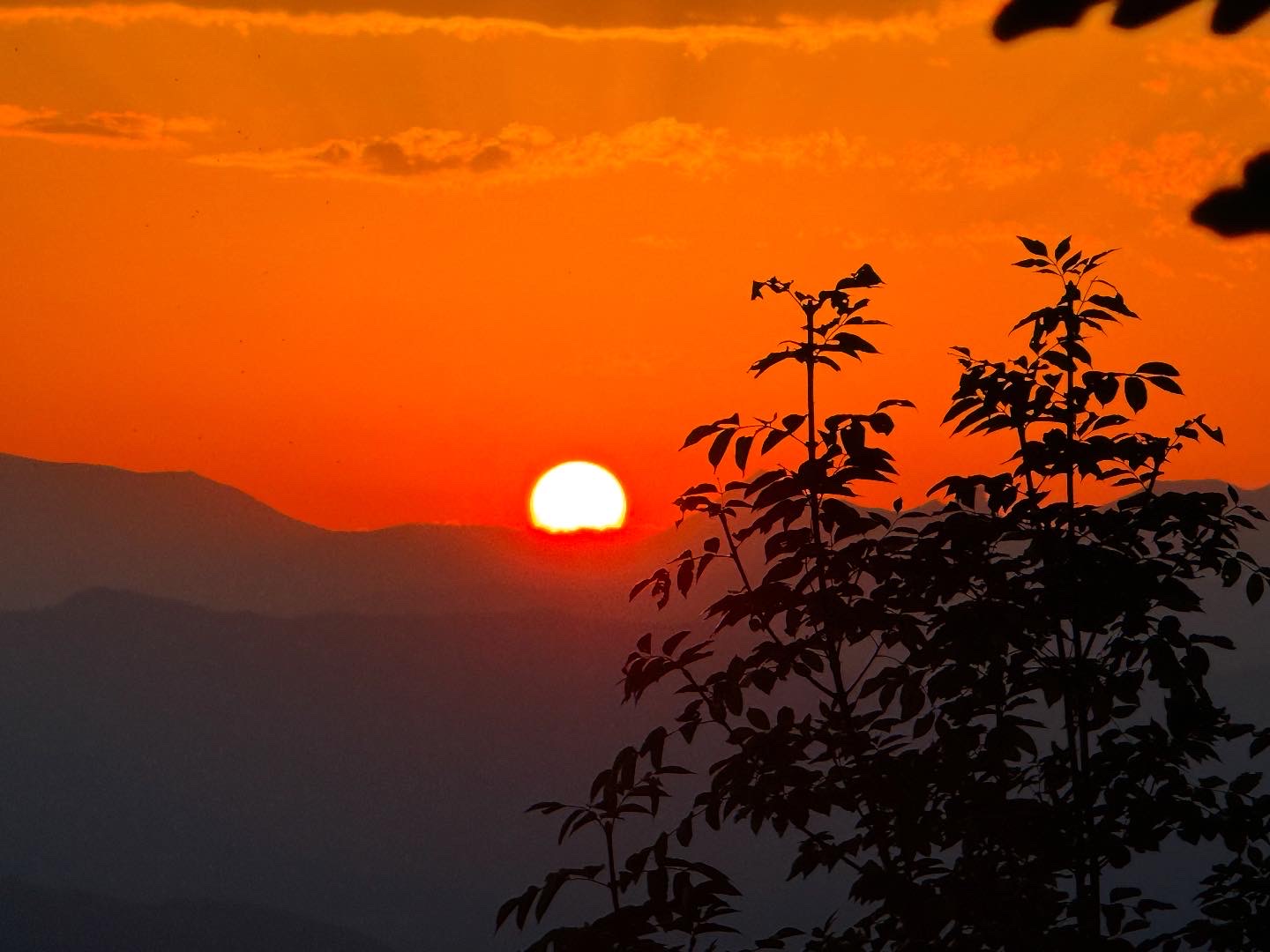L’illusion du choix ou quand nos décisions trahissent nos influences.
Alors que les résultats de Parcoursup sont aujourd’hui dévoilés – et que les parents, dont les enfants intègrent la crèche dès la rentrée, commencent déjà à élaborer des stratégies pour contourner l’implacable sentence de l’outil – le sujet est propice à l’interrogation des forces sous-jacentes qui meuvent nos décisions. En effet, la plateforme française tant redoutée, destinée à orienter les parcours universitaires sur le territoire, illustre parfaitement les intrications complexes entre choix individuels et influences extérieures. Car si ce moment – charnière dans la vie de nombreux étudiants – semble être, à première vue, le résultat de choix personnels guidés par leurs compétences et leurs aspirations profondes, il est également le reflet de mécanismes, éminemment plus complexes et souvent invisibles, qui les orientent. Une occasion toute désignée pour nous permettre d’explorer quelques-uns des multiples facteurs – la plupart du temps non-conscientisés – qui façonnent nos choix, jamais anodins.
Cela ferait sans doute sourire Ivan Pavlov car aussitôt que je pense « choix », je pense « déterminisme » – à tord ou à raison – puis, consécutivement, à la manière d’un vieux réflexe longuement conditionné, je pense à Pierre Bourdieu. Dans ses travaux sur la formation des goût et des opinions, le père de la sociologie comme sport de combat avance que les gens sont nettement moins libres qu’ils ne le croient.
Dans La Distinction : critique sociale du jugement (1979), il introduit le concept d’habitus : un produit de l’histoire, une inscription du social dans le corps et dans l’esprit des individus qui oriente leurs perceptions, leurs actions et leurs choix, de manière inconsciente.

« Pour distinguer si une chose est belle ou ne l’est pas, nous n’en rapportons pas la représentation à son objet au moyen de l’entendement et en vue d’une connaissance, mais au sujet et au sentiment de plaisir ou de déplaisir. […] Le jugement de goût […] est donc esthétique. »
Ainsi commence la Critique du jugement dans laquelle Kant se livre à une « critique du goût« , pour arriver à une définition du beau comme une « finalité sans fin« .
D’après lui, quand nous disons c’est beau, nous ne voulons pas dire simplement c’est agréable, nous prétendons à une certaine objectivité, à une certaine nécessité, à une universalité.
En faisant de La Distinction une critique sociale du jugement, Pierre Bourdieu bouleverse d’emblée des catégories sur le Beau, l’art et la culture, qui n’avaient jamais été remises en question. Non seulement le beau n’est pas un concept a priori, mais, au contraire, « les gens ont le goût de leur diplôme » et, les catégories de la distinction dépendent de la position que l’on a dans le tableau des classes sociales. Ainsi, selon que l’on a fait des études supérieures ou que l’on a passé le B.E.P.C., que l’on est issu de la bourgeoisie ou d’une classe populaire, on aime le Clavecin bien tempéré, la Rhapsodie in blue ou le Beau Danube bleu.
Mais, dit Bourdieu, à l’intérieur de la classe dominante, le capital économique ne correspond pas toujours au capital culturel et un tableau montre comment, dans la classe dominante, selon que l’on a un niveau inférieur au baccalauréat ou que l’on a passé une agrégation, on achète plus facilement ses meubles chez un antiquaire qu’aux Puces ou dans un magasin spécialisé.
En s’interrogeant donc sur les causes des préférences esthétiques, Pierre Bourdieu étudie ce qui les détermine, c’est-à-dire d’une part « le capital culturel » autrement dit le niveau d’instruction, et, d’autre part, « le capital économique« , soit la situation sociale. Et, en analysant ensuite les transformations du rapport entre les différentes classes sociales et le système d’enseignement, il distingue, à l’intérieur de chaque classe, des principes généraux de conduite que l’on retrouve dans chaque domaine et qui permettent d’établir un « système » des styles de vie.
Ainsi, de la même façon que l’on aime tel peintre, on a telle attitude politique et, selon que l’on a fait telles études, on pratique tel sport, on consomme tels aliments et l’on s’habille de telle façon.
En fait, quand on parle de culture, on parle, sans le savoir, de classe sociale, et la politique ne fait pas exception aux lois de la culture et du goût.
Au terme de cet ouvrage, on constate que la critique de la culture, et les usages que l’on en fait comme moyen de domination, font de La Distinction un document d’un intérêt tout à fait nouveau : non seulement pour la sociologie – au niveau de la précision de l’enquête (chaque questionnaire comporte une question par domaine : musique, peinture, vêtements, etc.), mais, également, au niveau politique, où l’on s’aperçoit, au travers des schémas et de l’unification toutes les questions, qu’il s’agit, pour la première fois, de donner plusieurs chances de comprendre la même chose : la cohérence de la conduite de chaque classe et l’usage qu’en font, consciemment ou pas, les partis politiques.
Source : Les Éditions de Minuit.
Bernard Lahire rompt, lui, avec une vision homogène de l’homme, qui serait façonné par un ensemble stable de principes – habitus, schèmes, normes, style de vie, etc. – et conduit la réflexion plus avant, dans L’homme pluriel : les ressorts de l’action (1998), où il souligne que chaque individu internalise non pas un, mais plusieurs habitus, en fonction des différents groupes sociaux auxquels il appartient. Il se trouverait ainsi à l’intersection de diverses influences et ses choix seraient, selon lui, le résultat d’un agencement complexe de dispositions parfois contradictoires. Ainsi, nos décisions peuvent être envisagées comme le résultat de la confrontation entre ces différents scripts internes, chacun tirant ses origines de différentes parties de notre vie sociale.

L’homme que les sciences humaines et sociales prennent pour objet est le plus souvent étudié dans un seul contexte ou à partir d’une seule dimension. On l’analyse en tant qu’élève, travailleur, consommateur, conjoint, lecteur, pratiquant d’un sport, électeur, ect. Or, dans des sociétés où les hommes vivent souvent simultanément et successivement des expériences sociolisatrices hétérogènes et parfois contradictoires, chacun est inévitablement porteur d’une pluralité de dispositions, de façons de voir, de sentit et d’agir.
S’interroger sur les manières dont la pluralité des mondes et des expériences s’incorpe au sein de chaque individu, observer son action sur une diversité de scènes, voilà l’horizon scientifique vers lequel tend cet ouvrage.
Sociologue, l’auteur noue un dialogue avec une partie de la psychologie, de l’histoire, de l’anthropologie et de la philosophie. Ses réflexions débouchent sur le programme d’une sociologie et s’attachent à mettre en évidence les plis les plus singuliers du social.
Source : éditions Dunod.
Dans La mise en scène de la vie quotidienne (1959), Erving Goffman examine comment nous modifions notre comportement en fonction des attentes sociales. Par exemple, lorsqu’on est invité à dîner chez quelqu’un pour la première fois, on participerait, selon lui, à une véritable mise en scène, dans laquelle chacun s’efforce de tenir le rôle qui lui est prescrit par la situation. Cependant, est-ce véritablement un choix de porter un masque dans ce contexte ? Ce qui semble, en tout cas, intéressant, c’est que dit de nous le choix de certains masques

Rencontres fortuites, échanges de paroles, de regards, de coups, de mimiques, de mots, actions et réactions, stratégies furtives et rapides, combats ignorés de ceux-là mêmes qui se les livrent avec l’acharnement le plus vif, telle est la matière première qui constitue l’objet, inhabituel, de La Présentation de soi. Pour ordonner ces miettes de vie sociale – résiduelles pour la sociologie canonique qui les néglige – sur lesquelles il concentre l’attention la plus minutieuse, Goffman prend le parti de soumettre à l’épreuve de l’explicitation méthodique une intuition du sens commun : Le monde est un théâtre. Le vocabulaire dramaturgique lui fournit les mots à partir desquels il construit le système des concepts propre à abstraire de la substance des interactions quotidiennes, extérieurement dissemblables, les formes constantes qui leur confèrent stabilité, régularité et sens. Ce faisant, Goffman élabore dès La Présentation de soi, son premier livre, les instruments conceptuels et techniques à partir desquels s’engendre une des œuvres les plus fécondes de la sociologie contemporaine et qui sont peut-être aussi au principe de la constitution des catégories fondamentales d’une nouvelle école de pensée : en rompant avec le positivisme de la sociologie quantitative en sa forme routinisée et en s’accordant pour tâche de réaliser une ethnographie de la vie quotidienne dans nos sociétés, La Présentation de soi peut être tenu pour un des ouvrages qui sont au fondement du courant interactionniste et, plus généralement, de la nouvelle sociologie américaine.
Source : Les Éditions de Minuit.
Judith Butler, dans Trouble dans le genre : Le féminisme et la subversion de l’identité (2005), propose que nos identités de genre sont performées en réponse aux normes culturelles. Le genre serait construit à travers des performances sociales répétitives, défiant ainsi la vision commune qui prétend que le genre est une réalité biologique ou naturelle. Selon elle, il serait un phénomène performatif, donc produit et entretenu par des actes et gestes récurrents, qui s’inscrivent dans des cadres normatifs. Ces performances de genre seraient régulées par des normes sociétales qui renforcent des identités de genre binaires, en excluant – de fait – ceux qui ne s’y conforment pas. Cette théorie a ouvert la voie à une compréhension plus flexible et inclusive des identités de genre et remet en question les catégories auparavant fixes de « masculin » et « féminin ».

Dans cet ouvrage majeur publié en 1990 aux États-Unis, la philosophe Judith Butler invite à penser le trouble qui perturbe le genre pour définir une politique féministe sans le fondement d’une identité stable. Ce livre désormais classique est au principe de la théorie et de la politique queer : non pas solidifier la communauté d’une contre-culture, mais bousculer l’hétérosexualité obligatoire en la dénaturalisant. Il ne s’agit pas d’inversion, mais de subversion.
Judith Butler localise les failles qui témoignent, à la marge, du dérèglement plus général de ce régime de pouvoir. En même temps, elle questionne les injonctions normatives qui constituent les sujets sexuels. Jamais nous ne parvenons à nous conformer tout à fait aux normes : entre genre et sexualité, il y a toujours du jeu. Le pouvoir ne se contente pas de réprimer ; il ouvre en retour, dans ce jeu performatif, la possibilité d’inventer de nouvelles formations du sujet.
La philosophe relit Foucault, Freud, Lacan et Lévi-Strauss, mais aussi Beauvoir, Irigaray, Kristeva et Wittig, afin de penser, avec et contre eux, sexe, genre et sexualité – nos désirs et nos plaisirs. Pour jeter le trouble dans la pensée, Judith Butler donne à voir le trouble qui est déjà dans nos vies
Source : éditions La Découverte.
Par ailleurs, lorsque les parents ou le milieu familial n’offrent pas la possibilité de bâtir une structure psychique solide, basée sur l’amour et un climat sécurisant qui permet la confiance en soi, certains individus peuvent être amenés à faire des choix qui s’apparentent davantage à des « non-choix », découlant de leur besoin de réparation et de reconnaissance. Ces décisions peuvent également être élaborées en contradiction avec les modèles reçus. De plus, les personnes ayant un défaut de confiance, envisagent souvent une version du futur exclusivement pessimiste, en raison d’une image de soi dévalorisée et d’un narcissisme défaillant. Heureusement, il est souvent possible de pallier cette carence structurelle par un travail introspectif, notamment via une analyse psychanalytique, permettant de mettre au jour et de travailler sur les mécanismes de défense et parfois d’introjecter une structure, grâce à la posture neutre et au regard bienveillant de l’analyste, sachant occuper comme il se doit le fauteuil du transfert.
La confiance en soi est prépondérante, dans la manière de faire des choix. C’est également ce que corrobore le concept d’espaces transitionnels, chez Donald W. Winnicott, qui met en évidence comment ces zones intermédiaires entre Le jeu et la réalité (1975) facilitent la prise de décision. En permettant des expérimentations dans un cadre sûr, ces espaces aident à explorer symboliquement divers scénarii et possibilités. Ce processus de « répétition » dans un espace protégé est crucial pour développer la capacité de faire des choix réfléchis dans la vie réelle. En jouant et en imaginant, enfants et adultes apprennent à évaluer les conséquences, à gérer l’incertitude, et à ajuster leurs décisions, cultivant ainsi une flexibilité psychologique essentielle pour s’adapter aux défis et (ac)cueillir les opportunités de l’existence.

Ce livre, le dernier qu’ait écrit Winnicott, prend pour point de départ l’article, devenu classique, que l’auteur a consacré aux « objets transitionnels ». Il a pour fil conducteur une conception du jeu, par quoi il faut entendre une capacité de créer un espace intermédiaire entre le dehors et le dedans, capacité qui ne s’accomplit pas dans les jeux réglés, agencés comme des fantasmes ou des rituels, mais qui se situe à l’origine de l’expérience culturelle. Il énonce enfin une théorie des lieux psychiques – une nouvelle topique – dont nous commençons à apercevoir l’originalité, par rapport aussi bien à Freud qu’à Mélanie Klein. La consultation thérapeutique et l’enfant montrait sur le vif comment opérait Winnicott, dans l’actualité de la relation. Nous découvrons, avec ce livre-ci, comment une théorie psychanalytique – cet objet transitionnel dont nous ne saurions nous passer – s’invente, se cherche et se trouve. Ce n’est pas seulement notre intelligence du discours mais notre perception du réel, de nous-même et de l’autre, qui se voient alors renouvelées.
Source : éditions Gallimard.
En outre, Vilayanur S. Ramachandran, dans The Tell-Tale Brain (2011), avance que les neurones miroirs sont essentiels au développement de l’empathie et à l’apprentissage social, car ils nous permettent de « vivre » les actions, émotions et expériences des autres indirectement. Ce mécanisme, qui sous-tend la manière dont nous adoptons les normes et comportements de notre entourage, joue sans doute également un rôle dans la manière dont nous prenons des décisions.

In this landmark work, V. S. Ramachandran investigates strange, unforgettable cases–from patients who believe they are dead to sufferers of phantom limb syndrome. With a storyteller’s eye for compelling case studies and a researcher’s flair for new approaches to age-old questions, Ramachandran tackles the most exciting and controversial topics in brain science, including language, creativity, and consciousness.
De fait, l’entourage, qu’il s’agisse des enseignants, des amis ou des personnages fictifs qui peuplent les livres ou les films à portée de main, représentent des modèles dont l’influence ne devrait pas être minimisée.
En premier lieu, les enseignants, à travers leur approbation ou leur censure, orientent les intérêts académiques et professionnels. Les mentors et les modèles jouent un rôle déterminant, notamment dans le parcours des transfuges de classe. Ils peuvent procurer un soutien émotionnel et servir de guide à travers les normes complexes de nouveaux champs sociaux à défricher. Les enseignants, en particulier, peuvent agir comme ces agents du changement, en facilitant ou en entravant cette transition.

Ils enseignent la liberté. Ils sont les bâtisseurs du monde de demain, d’une société fraternelle, diverse et égalitaire. Ils travaillent à un monde plus juste.
40 personnalités se souviennent d’un professeur qui a changé leur vie.
Abd Al Malik, Aline Afanoukoe, Albert Algoud, Anouk F., Jérôme Attal, Charles Berling, Nicolas Beuglet, Sophie Blandinières, Anne-Laure Bondoux, Françoise Bourdin, Cali, Marie Darrieussecq, Rokhaya Diallo, Irène Frain, Raphaëlle Giordano, Héloïse Guay de Bellissen, Serena Giuliano, Marius Jauffret, Jul, Caroline Laurent, Marc Levy, Henri Lœvenbruck, Mathias Malzieu, Agnès Martin-Lugand, Nicolas Mathieu, Fabrice Midal, Bernard Minier, Thibault de Montaigu, Plantu, Josef Schovanec, Romain Slocombe, Tatiana de Rosnay, Camille Pascal, Christiane Taubira, Sylvie Testud, Franck Thilliez, Philippe Torreton, Séverine Vidal, Jacques Weber, Bernard Werber.
Source : Actuallité.
Les médias et les livres, en proposant des modèles de comportement, peuvent également élargir la perception des possibles, des rêves en stock et des choix auparavant inenvisageables.
Les amis – surtout au moment de l’adolescence – agissent tels des miroirs réfléchissant les normes sociales du groupe qui, à leur tour, façonnent les comportements et décisions de leurs membres. Les relations amicales offrent un cadre de référence pour l’acceptabilité sociale des actions, influençant autant les décisions que la perception de soi.
Harry Potter (1997), de J.K. Rowling – jeune sorcier de la série de romans éponymes – ainsi que ses amis, Hermione Granger et Ron Weasley, sont élèves à l’école de sorcellerie de Poudlard. L’élément de l’aventure qui nous intéresse tout particulièrement, ici – en sus de l’amitié indéfectible qui lie les trois personnages – est le « choixpeau magique », un chapeau enchanté qui détermine la maison – Gryffondor, Serdaigle, Poufsouffle, ou Serpentard – à laquelle chaque nouvel élève appartient (cf. encadré). Ce choix est crucial, car il définira – en partie – le développement de leur identité et leur appartenance au sein de l’école. Toutefois, notons que si le choixpeau prend en compte les qualités de chaque élève, il tient compte également de leurs choix personnels. Par exemple, alors qu’il envisage de placer Harry à Serpentard, il finit par l’envoyer à Gryffondor, après que ce dernier exprime une préférence pour cette maison. Ce qui fait passer un message – à peine voilé – sur l’importance des choix personnels dans la construction de la destinée de chacun.

- Gryffondor, connue pour la bravoure et la chevalerie.
- Serdaigle, réputée pour la sagesse et l’intelligence.
- Poufsouffle, célèbre pour la loyauté et le travail acharné.
- Serpentard, souvent associée à la ruse et à l’ambition.
En parlant de destinée… et le fatum alors ? Ou comment déléguer nos choix et s’en remettre à une puissance supérieure, quand on ne trouve pas en soi la force de décider ? Le fatum – destin – est parfaitement illustré par le mythe d’Oedipe et met en scène un thème récurrent dans la littérature et la mythologie grecque : l’inévitabilité du destin. « Tout est écrit » sous-entend clairement l’impotence des humains face aux volontés divines, souvent cruelles. En somme, inutile de faire des choix, ce n’est pas toi qui décides.

Œdipe Roi incarne le mythe grec le plus radical sur l’homme et la tragédie la plus accomplie du plus classique des tragiques grecs.
Condamné par le destin à tuer son père et à épouser sa mère, Œdipe a fui loin de ceux qu’il croit ses parents pour aller tuer un homme au carrefour de deux routes – son père -, puis épouser la reine de Thèbes – sa mère.
L’homme aux pieds tuméfiés paraît lentement au seuil du palais : il est seul, en plein jour, face à son peuple frappé par la pestilence. Il poursuivra le criminel qui souille la lumière du soleil. Son regard exprime la clairvoyance qui lui a permis de vaincre la Sphinx. Mais les trous de son masque annoncent aussi les orbites qu’il percera devant l’évidence : Œdipe rendra son visage conforme à son masque.
Source : éditions Les Belles Lettres.
Par ailleurs, des psychologues sociaux comme Daniel Kahneman et Amos Tversky ont démontré, dans leurs travaux sur la prise de décision, comment même nos jugements les plus réfléchis peuvent être sujets à des biais cognitifs qui échappent à notre conscience. Dans Thinking, Fast and Slow (2011), Kahneman détaille comment notre cerveau utilise des raccourcis pour prendre des décisions rapides, en vue d’économiser de l’énergie, en se fiant à des heuristiques, souvent au prix de la précision et de la rationalité.

System 1 is fast, intuitive, and emotional; System 2 is slower, more deliberative, and more logical. The impact of overconfidence on corporate strategies, the difficulties of predicting what will make us happy in the future, the profound effect of cognitive biases on everything from playing the stock market to planning our next vacation–each of these can be understood only by knowing how the two systems shape our judgments and decisions.
Engaging the reader in a lively conversation about how we think, Kahneman reveals where we can and cannot trust our intuitions and how we can tap into the benefits of slow thinking. He offers practical and enlightening insights into how choices are made in both our business and our personal lives–and how we can use different techniques to guard against the mental glitches that often get us into trouble. Topping bestseller lists for almost ten years, Thinking, Fast and Slow is a contemporary classic, an essential book that has changed the lives of millions of readers.
[ oui, tout à fait, j’ai eu la flemme de traduire ! ]
Sans doute dans le but de s’épargner, parce que le choix est trop difficile pour eux, d’aucuns consultent des psychotérapeutes, afin d’identifier les causes de leur paralysie décisionnelle, lorsque d’autres font des tableaux avec des « pour » et des « contre », se documentent, demandent conseil, voire en appelle aux prédictions de cartomanciennes ou encore, s’en remettent à un dieu dans leurs prières, afin qu’il les assiste. Il y a même ceux qui lancent une pièce en l’air en attendant que la réponse (re)tombe du ciel : et hop, alea jacta est – le sort en est jeté ! Une façon particulière de « franchir le Rubicon« . Il apparaît cependant, que les amateurs de réponses à pile ou face se décident finalement assez souvent avant que la pièce ne touche le sol. Un moyen de leurrer leur cerveau et se contraindre, en refusant de laisser le verdict entre les mains du hasard ?
L’Homme-Dé (1971) de Luke Rhinehart – pseudonyme de George P. Cockcroft – est un roman qui explore le thème de la liberté et du hasard à travers l’histoire de son protagoniste, le Dr. Rhinehart, psychanalyste. Ce dernier décide de faire de sa vie un jeu en se soumettant aux décisions prises par le lancer de dés, challengeant ainsi les normes sociales et les contraintes de la vie quotidienne. À travers cette expérience radicale, le roman questionne l’identité, le contrôle et le destin, proposant une réflexion sur la nature de la liberté et les limites de la responsabilité individuelle. Le style de vie anarchique de Rhinehart entraîne un mélange de conséquences imprévisibles, tout en suscitant des réactions variées de la part de son entourage et de la société.

Depuis qu’il a décidé de jouer aux dés chacune de ses décisions, le Dr Rhinehart, un psychiatre new-yorkais, a transformé sa vie en un immense jeu de hasard. Très vite le « syndrome du dé » se répand. Expérimentateur en chambre, pionnier du chaos, le Dr Rhinehart a peut-être inventé sans le savoir le moyen d’en finir une fois pour toutes avec la civilisation. Mais le FBI veille…
Source : éditions de l’Olivier.
Ainsi, chacun possède une façon qui lui est propre d’opérer un choix. Même si pour certains, choisir – c’est à dire renoncer à quelque chose – est plus difficile que pour d’autres.
Il est assez aisé d’imaginer que la peur de la perte et du changement peuvent s’accompagner d’une difficulté à effectuer des choix, dans la mesure où toute décision implique généralement de renoncer à certaines possibilités au profit d’autres. Selon Sigmund Freud, le processus de prise de décision peut activer des angoisses profondes liées à la peur de perdre des aspects du Soi ou des objets d’attachement surinvestis. C’est ce qu’il développe dans ses travaux sur les mécanismes de défense et le deuil. Il propose que « le Moi se défend contre la perte d’objet ou contre la perte de l’amour de cet objet en déniant la signification de ce qui a été perdu ». Cette défense peut donc paralyser la prise de décision, car chaque choix signifie – de fait – abandonner une partie de ce que l’on connaît ou que l’on désire, ouvrant la possibilité de faire croître l’anxiété, la résistance au changement, dans la perspective d’un (dé)plaisir possible (cf. Thanatos, pulsion mortifère).
En fin de compte, le refus ou l’incapacité de faire un choix, ne constituent-t-il pas déjà un choix en soi ?
Pour conclure ce propos – si tant est que l’on puisse -, comprendre comment nos décisions sont construites nécessite une approche holistique qui considère l’individu non pas isolément, mais comme un nœud dans un réseau de multiples facteurs. À l’instar de l’arbre qui ne peut être compris isolément de la forêt qui l’entoure, nos choix ne sauraient être pleinement appréhendés sans prendre en compte le tissu complexe de la vie sociale dans lequel ils s’imbriquent. Tel cet arbre dans une forêt dense qui, tout en possédant ses propres caractéristiques, est façonné par son environnement : le sol dans lequel il prend racine, le climat, les autres plantes et animaux de la forêt.
Aussi, identifier et reconnaître les multiples couches d’influences qui fabriquent nos prises de décisions est essentiel en vue d’éclairer – autant que possible – à quel degré ces choix individuels constituent des réponses à un réseau complexe d’attentes intériorisées. En démystifiant les sources qui meuvent ces choix, peut-être pourrons-nous aspirer à une plus grande autonomie décisionnelle. C’est en tout cas souhaitable.