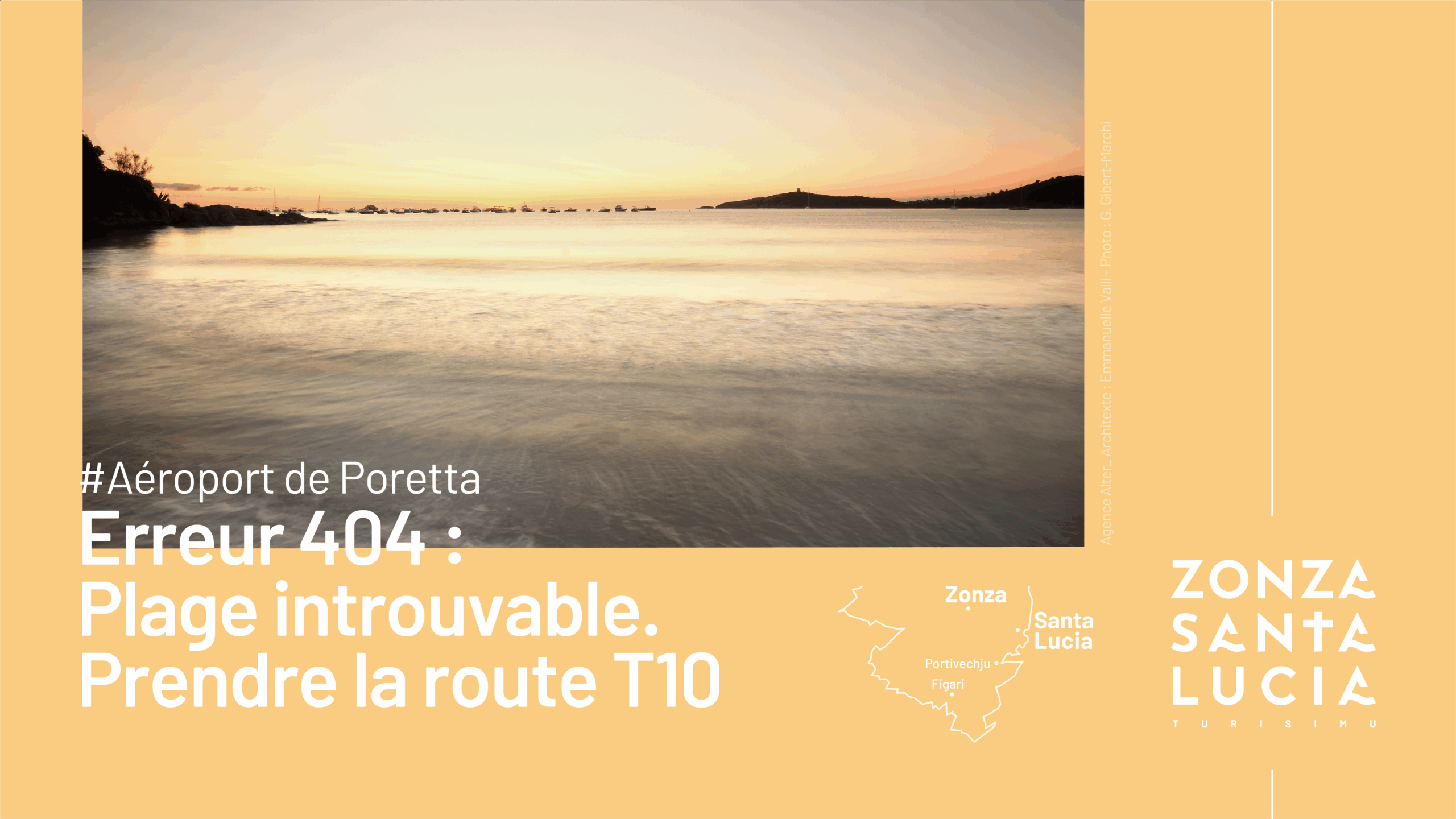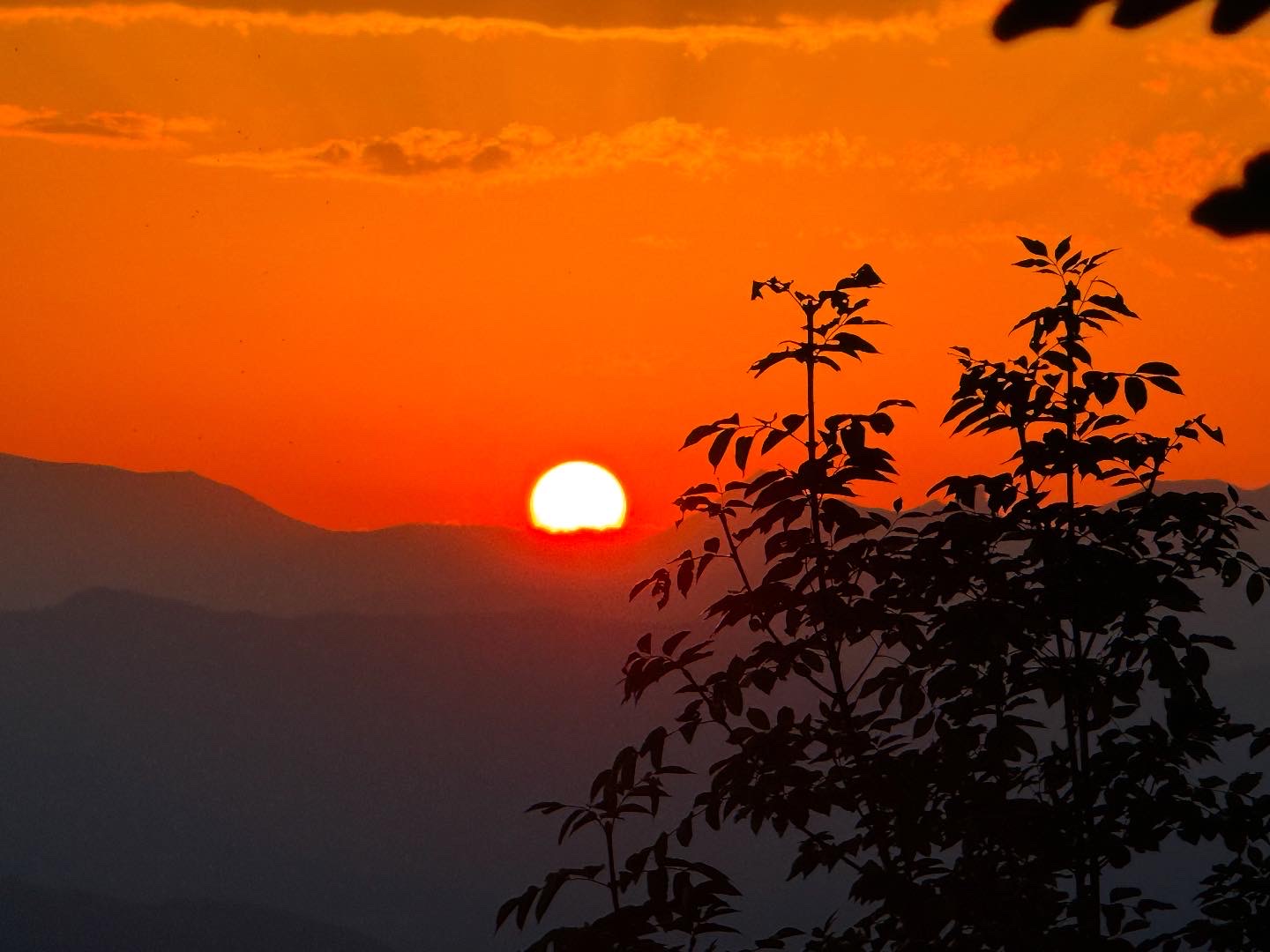Trigger warning : âmes sensibles s’abstenir (contenu sarcastique).
Aaah, Noël ! Période chargée – je pèse les maux ! – de magie et d’incantations aux réjouissances des retrouvailles familiales. Le voilà qui revient à nouveau, paré de ses belles promesses, tel un rituel immuable.
Une allégorie enveloppante et rassurante consommée sans modération, dans un décor à prédominance rouge, vert et doré, au milieu des sapins en plastique et de la neige artificielle qui ornent les temples de la vente ; parce qu’on veut nous faire croire « Que le bonheur c’est d’avoir, De l’avoir plein nos armoires » – chantait Alain Souchon, dans « Foule sentimentale » (1993) – pour ensuite revendre les cadeaux qui n’auront pas été à la hauteur des attentes sur Le Bon Coin ou Vinted.
On ne s’attardera pas ici sur la notion de « présent« , de don et de contre don – cf. Maurice Godelier et Marcel Mauss -, de son rôle et son importance dans le fonctionnement des sociétés et dans la constitution du lien social. Disons seulement que l’esprit consumériste de Noël ne date pas d’hier.

« Petit Papa Noël,
Quand tu descendras du ciel,
Avec des jouets par milliers,
N’oublie pas mon petit soulier. »
Chanson « Petit Papa Noël » de Tino Rossi (1946)1
En outre, à quoi tient cette ferveur pour les « Marchés de Noël« , dont le nom exprime clairement la fonction : vendre ? C’est tout de même un paradoxe lorsqu’on sait que ceux et celles qui les fréquentent sont parfois là pour oublier leurs difficultés quotidiennes, dans des pays encalminés dans la récession et l’inflation.
Rien n’arrête l’esprit de Noël et alors que le cyclone Chido vient de ravager Mayotte, le Père-Noël s’apprête encore à inonder les foyer les plus aisés d’une profusion de cadeaux tout droits sortis de sa hotte d’abondance.
Ma grand-mère, née en 1926, me contait que pour Noël, elle recevait des oranges, parfois du chocolat, jusqu’à ce fameux jour où on lui avait offert une poupée de chiffon qui avait porté sa joie d’enfant à son comble. Sans aller jusqu’à avancer que le désir et le plaisir naissent exclusivement du manque, que dit de notre époque cette surabondance de cadeaux jetables et échangeables ? Dépenser pour mieux donner : que révèlent ces rituels de fin d’année – même dans les familles qui ne sont pas toujours les plus aisées ? Je m’interroge.
Par ailleurs, si à présent nous envisageons la traditionnelle bûche de Noël sous sa forme pâtissière ou glacée, auparavant c’était surtout celle qui se consumait dans l’âtre du foyer autour duquel se réunissaient les familles, autant pour cuisiner que pour veiller.
Notons que le feu de cheminée appartient encore aux représentations et stéréotypes que véhiculent allègrement les films « nunuches » de Noël qui envahissent les petits écrans. Mais pourquoi ces contes modernes édulcorés sont-ils autant plébiscités ? Ils semblent procurer de douces parenthèses – prodiguant les mêmes effets que le fait de regarder des petits chats sur Instagram ? – où l’inévitable heureux dénouement scintille comme les guirlandes lumineuses sur un sapin trop chargé. Leurs intrigues prévisibles déroulent des récits où le citadin surmené trouve l’amour dans un village enneigé et où les familles éclatées se réconcilient au son des cloches de minuit. Ces fables cinématographiques, loin d’une réalité qui peut être rugueuse, constituent de véritables anxiolytiques – sans effets secondaires – qui enveloppent l’âme, rappelant que dans leur monde feutré tout chagrin finit par fondre comme neige au soleil. Pourquoi pas, si ça soulage.

« Love Actually » (2003), réalisé par Richard Curtis, est devenu l’un des films de Noël emblématiques. Spoiler alert : tout finit bien.
« En cette veille de Noël, l’amour est partout, mais souvent imprévisible. Pour le nouveau Premier ministre britannique, il va prendre la forme d’une jeune collaboratrice. Pour l’écrivain au coeur brisé, il surgira d’un lac. Pour le témoin de mariage de son meilleur ami, pour ce veuf et son beau-fils, pour cette jeune femme qui adore son collègue, l’amour est l’enjeu, le but, mais aussi la source d’innombrables complications. »
Source : AlloCiné.
Notons que de façon tout aussi cathartique, à mon sens, il existe d’autres remèdes qui tentent, eux, de démasquer le réel. C’est ce qui semble être le propos de « Christmas Eve in Miller’s Point » (2024), le dernier film tendre de Tyler Taormina, qui raconte l’histoire d’une tribu italo-américaine de Long Island, réunie le soir du réveillon.

Le film dépeint une réunion familiale italo-américaine lors de ce qui pourrait être leur dernier Noël dans la maison ancestrale.
À travers des scènes fragmentées et une narration chorale rococo, Taormina explore les dynamiques intergénérationnelles, les tensions latentes et la nostalgie liée au passage du temps.
Voilà qui pourrait constituer un contre-point intéressant et offrir une bonne illustration du côté moins glamour de Noël car, les réunions familiales de Noël ravivent aussi, dans de nombreux cas, les tensions au sein des familles dites « dysfonctionnelles ». Ces familles caractérisées par des conflits chroniques et des joutes mortifères qui transforment inexorablement les célébrations en sources de stress plutôt qu’en moments de joie où la seule question qui demeure est « quand est-ce que la situation va déraper ?« .
Une légende urbaine raconte que dans certaines familles, il n’existe pas de conflit. En réalité, c’est vrai, ça existe. Aussi, je m’interroge quant à la mystérieuse structure de cette famille fonctionnelle idéale. Comment se passent les relations, dans une famille sans embûche de Noël ? Si la famille Bisounours tient presque du mythe, dans ma conception des relations familiales, se pourrait-il que « famille dysfonctionnelle » puisse relever du pléonasme et que ce ne soit pas si grave, tant que – de la même façon que comme pour toute dynamique de groupe – on a encore la possibilité de s’en extraire ?
Ainsi, exacerbée par l’intense contexte émotionnel des fêtes, dans lesquelles réside implicitement une pression afin que tout soit parfait et, souvent aussi, par une dose d’alcool désinhibante, plus importante que de coutume, les principales raisons des mésententes familiales sont bien souvent assez banales : des ressentiments passés et conflits non résolus qui ressurgissent, notamment lorsqu’on se retrouve ensemble après une longue séparation. Des différences de choix de vie – carrière, relations, sexualité, parentalité, éducation des enfants, etc. – sont parfois jugées ou critiquées. Des divergences politiques avec le vieil oncle raciste, macho et libidineux. L’organisation et la logistique : Qui cuisine ? Qui met le couvert ? La répartition inégale des tâches ou chez qui fêter Noël peut également générer des tensions. La présence de certains membres de la famille, de « pièces rapportées » ou d’amis non désirés peut être source de stress. Sapin ou pas sapin ? Repas vegan ou foie gras ?
Toutefois, il me semble que cette liste non-exhaustive de querelles pourrait se concentrer sur deux points majeurs : la jalousie face à un sentiment de distribution inéquitable de l’amour et par extension, des biens matériels entre les enfants – le loser ou la brebis galeuse au regard de sa famille, au motif qu’il n’est pas comme les autres membres du groupe ; l’enfant prodige bien sous tous rapport, consensuel, qui recherche l’amour à travers la réussite professionnelle et l’adhésion aux normes ; l’enfant surprotégé auquel on passe tous les caprices et qui bénéficie d’une immunité totale, juste parce qu’il est irresponsable – et les incompréhensions dues à une communication défaillante, absente – « non-dits » -, voir improductivement surabondante – « toute vérité n’est pas bonne à dire ». Je me trompe peut-être.

« Un conte de Noël » d’Arnaud Desplechin est un drame familial mêlé de mélancolie et d’humour au cordeau. Il se déroule pendant les fêtes de Noël, où la famille Vuillard se réunit dans la maison familiale, à Roubaix. Une réunion qui sera marquée par des tensions, des secrets, mais aussi par des moments de grâce et de réconciliation.
Source : AlloCiné.
Cependant, si chaque année, Noël enchante encore les petits et les grands, il charrie également avec lui son lot de sentiments mêlés, de souvenirs et de moments qui ne reviendront plus.
La nostalgie met la barre très haut car, ce sentiment entre douceur et mélancolie, associé au regret d’un passé magnifié par la distance temporelle et ce que les souvenirs en ont fait, nous fait tendre à retrouver cet objet idéal irrémédiablement perdu.
L’étymologie est éclairante : le terme provient du grec ancien « nostos » (retour) et « algos » (douleur), signifiant littéralement « douleur du retour », de l’impossible retour. C’est une émotion complexe qui peut être déclenchée par des stimuli sensoriels, des lieux ou des événements significatifs. Les fêtes de fin d’année, qui renvoient souvent à un moment vécu magique de l’enfance – pour les plus chanceux – sont donc toutes désignées pour la convoquer.
Noël et Nostos sont sur le même bâteau. Noël tombe à l’eau. Qui reste-t-il ?
Nostos, « le fantôme des Noëls passés » – A Christmas Carol.

Dans « A Christmas Carol » (1843) de Charles Dickens, le personnage principal, Ebenezer Scrooge, incarne l’avarice et le mépris des valeurs humaines.
Vieil homme solitaire et aigri, il rejette avec cynisme l’esprit de Noël et refuse toute forme de générosité ou de compassion.
Sa transformation débute lors d’une nuit mystique où il reçoit la visite de trois esprits : le Fantôme des Noëls passés, qui lui rappelle les joies et les blessures de son enfance ; le Fantôme du Noël présent, qui lui révèle la chaleur et la solidarité qu’il refuse aux autres ; et enfin, le Fantôme des Noëls futurs, qui lui montre un avenir sombre et isolé, marqué par l’oubli et l’indifférence après sa mort. Profondément bouleversé par cette triple révélation, Scrooge décide de changer radicalement sa vie. Dans un élan de repentir sincère, il devient généreux et bienveillant, offrant aide et réconfort à ceux qu’il avait jusqu’alors ignorés.
À travers ce parcours initiatique, Dickens illustre la puissance de la rédemption et rappelle que l’esprit de Noël réside dans la capacité à s’ouvrir aux autres et à renouer avec l’humanité, même lorsque tout semble perdu.
Il existe une adaptation que j’aime beaucoup et qui n’est pas exclusivement réservée aux enfants : « Le drôle de Noël de Scrooge« .
Ce qui est pour le moins étrange, c’est lorsque cette nostalgie surgit dans les familles aux structures conflictuelles. Elle surgit non pas du fait d’une idéalisation des conflits, mais du sentiment d’appartenance qu’ils impliquaient au-delà des défaillances. Les disputes, les désaccords et les imperfections familiales témoignaient malgré tout d’une dynamique relationnelle, d’un lien, aussi imparfait soit-il. Lorsque ces interactions disparaissent, il n’est pas rare d’apercevoir entre les lignes que le manque s’est installé en lieu et place de l’absence.
Lorsque les chaises sont vides, cette absence de contraintes familiales n’est pas non plus exempte d’une paradoxale nostalgie pour ces moments que l’on rêvait de fuir, alors que l’on avait encore la chance de pouvoir s’en plaindre et de les appréhender.
Aussi, je vous souhaite de pouvoir profiter des imperfections ou de vous affranchir de ces fêtes de Noël à votre manière, de cette tendre hystérie des longs repas de famille où les affects se mêlent grassement aux mets – et parfois aux discussions – les plus lourds. Je vous souhaite de pouvoir composer la mélopée qui vous rendra heureux, loin des attentes implicites de bonheur et de partage normalisées.
Grandir, c’est peut-être tenter de concilier la donne initiale avec les injonctions sociétales et une dose suffisante de transgression, ce petit pas de côté nécessaire pour tenter de savourer au mieux ces instants et tenter d’y survivre, aussi !
Bonus, pour les nostalgiques du Père Noël est une ordure (1982), la farce délicieuse et mythique de la troupe du Splendid : « Une serpillère, c’est formidable, Thérèse !« .

« Le Père Noël est une ordure », film culte réalisé par Jean-Marie Poiré en 1982, est une satire acide des fêtes de fin d’année, devenue un incontournable du cinéma français.
Adaptée de la pièce du Splendid, cette comédie grinçante suit les mésaventures absurdes des bénévoles de la permanence téléphonique « SOS Détresse Amitié », lors d’un réveillon cauchemardesque.
Entre un Père Noël dépressif et grossier, une épouse battue envahissante et un voisin psychopathe, les situations grotesques s’enchaînent dans un crescendo d’humour noir.
Derrière ses gags mémorables et ses répliques devenues légendaires, le film dresse un portrait caustique de la misère humaine et des faux-semblants de la solidarité festive, faisant de cette farce un miroir cruel mais hilarant des travers de notre société.
Alert spoiler : Les injonctions à être heureux, pailletés et à s’amuser le soir du réveillon du Nouvel An reviennent !
- Par ailleurs, « C’est la belle nuit de Noël, La neige étend son manteau blanc » raconte désormais une autre histoire que la nôtre. ↩︎