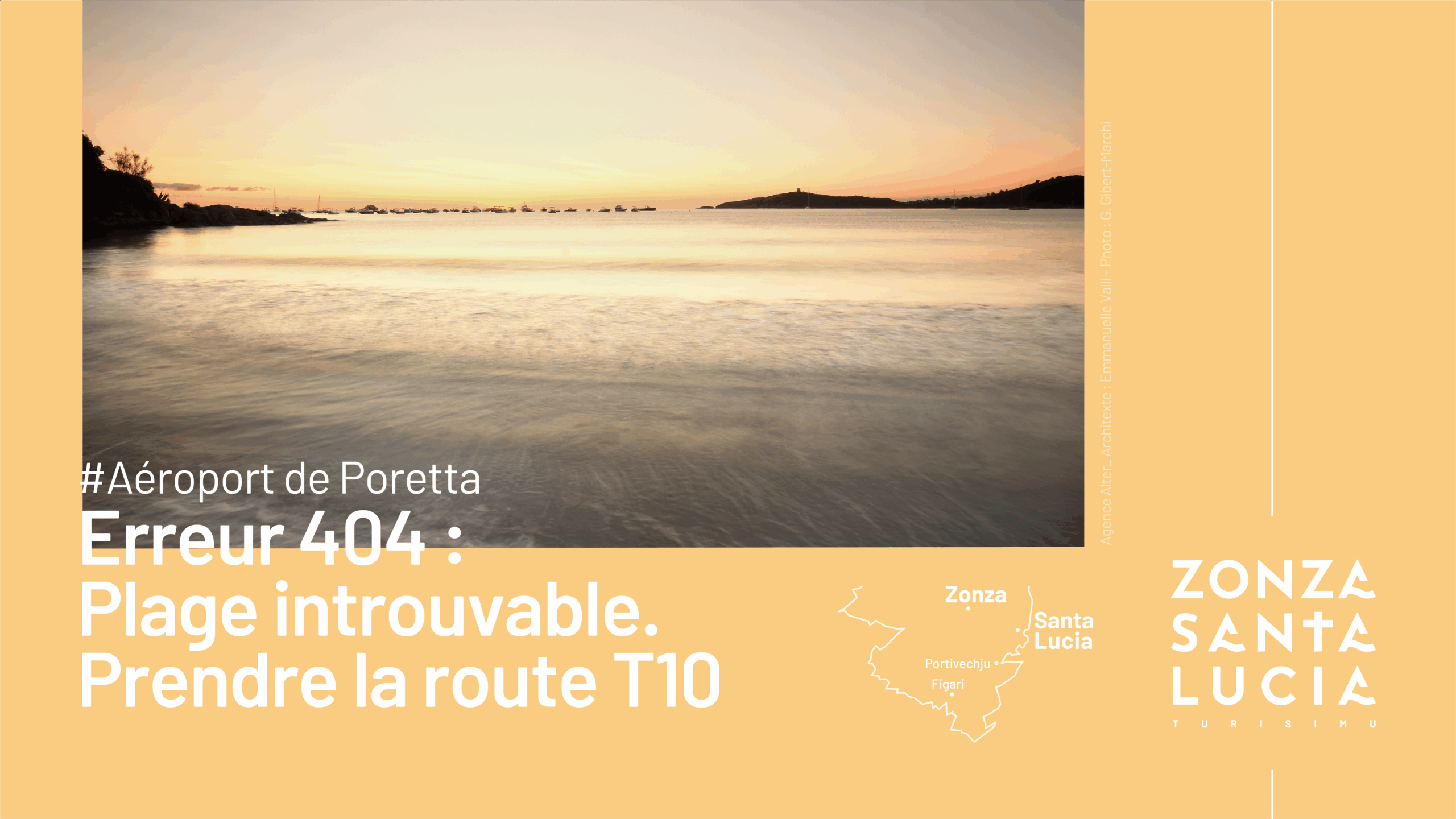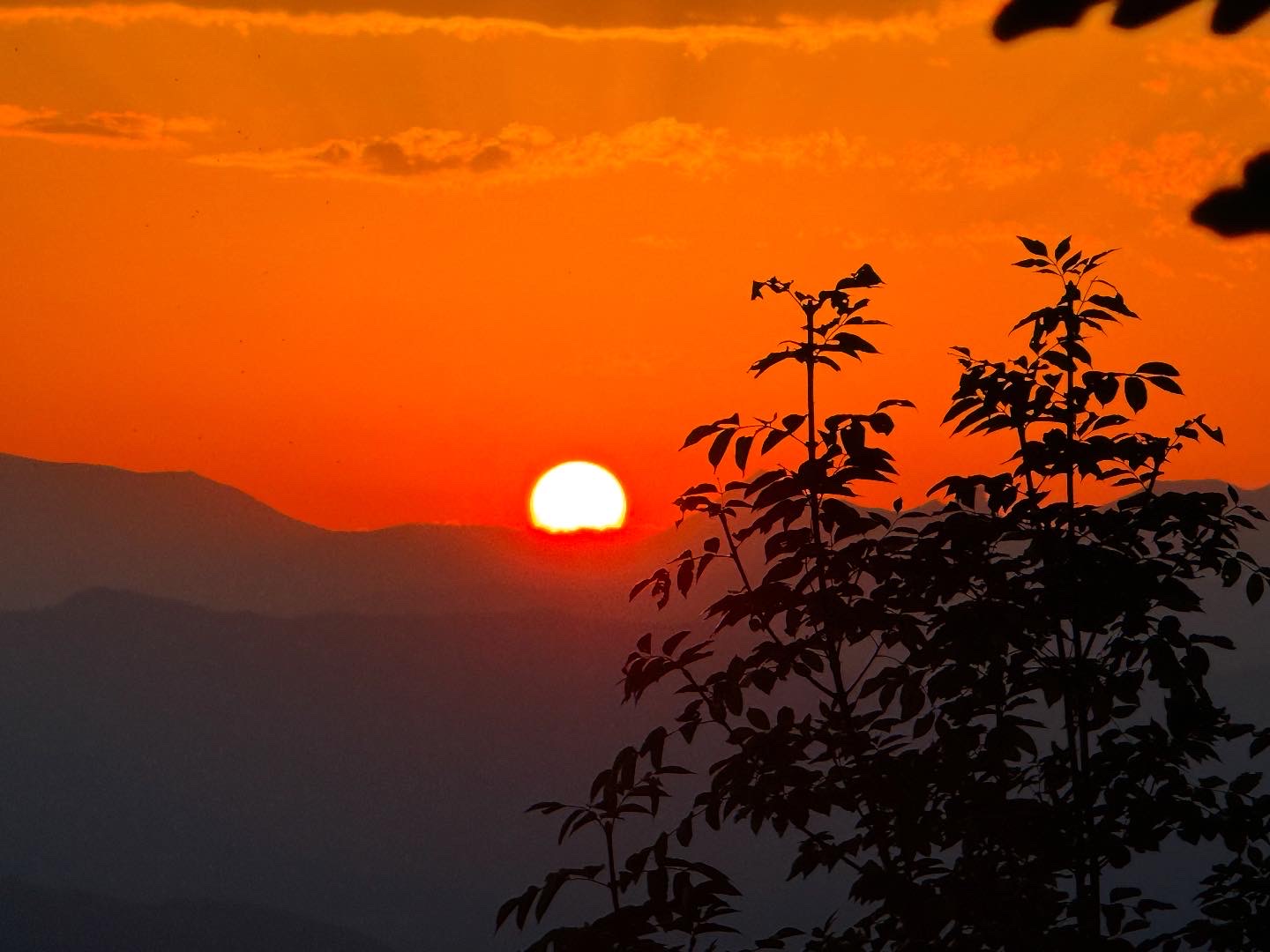AVERTISSEMENT : Cet article N’EST PAS un procès du kitsch en mauvais goût, sinon un appel à la nuance et au questionnement. Le kitsch est une revendication au service de la singularité culturelle, qui possède une dimension critique et peut être théorisé – du kitsch bourgeois au kitsch consumériste. Ce qui est communément désigné comme appartenant au mauvais goût est un jugement subjectif – c’est le (dé)goût de l’Autre.
Se pourrait-il que le retour du kitsch qui s’est invité en première place de l’extravagante cérémonie d’ouverture des JO 2024, à Paris, ce 26 juillet 2024, résonne un peu comme une symphonie baroque de contradictions ? Telle une coquille vide aux apparences de vitrine progressiste, sur laquelle chaque symbole viendrait se fracasser contre la réalité.
Ce choix esthétique, longtemps considéré comme symbole du mauvais goût et souvent relégué négativement au rang de l’ostentatoire, a redessiné les contours traditionnels de l’élégance et de la dignité olympiques, communément admises, avec une audace jubilatoire – à coup de feutres et de plumes colorées – générant pas mal de cancans.
Le retour du kitsch comme ingrédient principal dans cet événement mondial meut l’innovation en tradition et déguise la modernité en rétrospective – à moins que ce ne soit l’inverse.
« Kitsch se dit d’un objet, d’un décor, d’une œuvre d’art dont le mauvais goût, voire la franche vulgarité, voulus ou non, réjouissent les uns, dégoûtent les autres. »
Encyclopédie Larousse
Si j’affectionne tout particulièrement, dans le kitsch, cette idée d’une culture populaire où « La Joconde » et « La Cène » ou « Le festin des dieux » qui revisite les canons élitistes du « Beau », dans un souci de se rendre accessible à tou.te.s, j’apprécie la nuance apportée par Roger-Pol Droit, dans cette chronique sur « Le Nouvel Age du kitsch », de Gilles Lipovetsky et Jean Serroy :
« Traits distinctifs : gigantisme et clinquant, artifices sans nombre, outrances sans limites. Voilà ce que serait l’horizon indépassable du semblant. Dans cet empire du « trop », où chacun de nous vit désormais, fût-ce à son corps défendant, il faut s’ingénier sans fin à priser la saveur du mauvais goût. Ce qui compte, c’est la surenchère. Créer consisterait à toujours ajouter une couche supplémentaire, inventer une démesure inédite, provoquer un chaos insolite. Est-ce donc condamnable, méprisable ? Les deux observateurs […] ne se veulent ni ronchons ni réactionnaires. Ils insistent, au contraire, sur les aspects positifs de ce néokitsch qu’on ne pourrait plus éradiquer, et qui sait se montrer plaisant, imaginatif, récréatif, critique, voire contestataire. Malgré tout, en s’en tenant uniquement à l’idée du « trop », les analyses de Gilles Lipovetsky et de Jean Serroy laissent de côté une force de destruction que la dérision kitsch contient aussi et diffuse tous azimuts. Entre nihilisme achevé et pulsion de mort, quelque chose de mortifère est à l’œuvre dans cette surenchère permanente. Dans cette optique, la complaisance à son égard devient difficile, ou même impossible. Question d’éthique, plus que d’esthétique. »
Quoiqu’on en dise, le choix de cet hommage à la culture populaire1, associé à la transgression des canons esthétiques attendus, a capté l’attention, attisé la curiosité et offert un spectacle aussi éclatant que controversé.
C’est pourquoi, il serait intéressant de se demander quelles ont les les représentations qui vont naître de cette audace française, aux yeux du monde.
Dans sa flamboyance tapageuse, le kitsch aura-t-il terni la solennité sacrée des JO ? Les puristes, réfractaires au changement, pesteront-ils contre cette « frivolité« , craignant une banalisation de l’événement et une rupture avec la tradition de grandeur ? Cette recherche effrénée d’originalité et de différenciation laissera-t-elle le souvenir d’une esthétique qui, bien que mémorable, aura manqué de profondeur et de sincérité ? Retiendra-t-on l’image d’une fresque visuelle vibrante et d’une célébration inclusive de la diversité culturelle contemporaine ou d’un spectacle grotesque où l’on a frôlé la crise d’épilepsie et le mal de mer, par excès de motifs ?
L’équilibre est – par définition – fragile entre la justesse de la mise en scène et l’overdose de kitsch où le sublime se mue en grotesque. Pourtant, à trop se vautrer dans la prudence, l’innovation ne se fige-t-elle pas en monotonie ?
Les organisateurs de ces JO 2024 étaient donc face un défi de taille : celui de transcender les conventions sans les dénaturer, de surprendre sans choquer et de créer une cérémonie qui, dans toute son exubérance, reste fidèle à l’esprit olympique. Y sont-ils parvenus ? Il conviendra à chacun d’apporter sa réponse.
Toutefois, si l’on se demande dans quel but, les metteurs en scène ont porté leur choix vers cette marginalité, risquée et spectaculairement exacerbée, la réponse semble tout de même assez évidente et à la portée de tous. En outre, c’était sûrement l’objectif : rendre démocratique, populaire et accessible, cette cérémonie, afin de réunir autour de la fête cette France et ce monde, ô combien divisés.
Contrairement aux cérémonies traditionnelles, celle d’hier a, semble-t-il, cherché à éviter les discours édifiants sur la « France éternelle » – sans toutefois éviter ceux lénifiants du président du CIO et de celui de Paris 2024. Optant plutôt pour une série de « tableaux » – saturés de clins d’oeil premier degré à des références historiques et culturelles et à Paris « ville de l’amour » – allant jusqu’à mettre en scène un ménage à triolisme romantique à la « Jules et Jim », dans la Bibliothèque Richelieu.
Un spectacle vivant et inclusif abordant des enjeux sociétaux actuels et cherchant à représenter une « ville-monde » – sans la ruralité – dans laquelle chaque singularité – handicap, LGBTQIA+, etc. – peut trouver sa place. Rendant hommage à ses figures féminines – qui, espérons-le, ne replongeront dans la Seine de l’oubli, après ces minutes de visibilisation – et au travail des « artisans » comme Louis Vuitton (rire) ; symbole de l’empire LVMH – leader mondial du luxe – du milliardaire Bernard Arnaud, incrustant son monogramme dans un placement de produit pour le moins déplacé – “médaille d’or de la ruse publicitaire”.
Si la cérémonie a voulu éviter de glorifier un passé mythifié, jouant sur l’autodérision, il apparait indéniable qu’elle a également voulu en mettre plein les yeux en retournant la table des conventions. Et si l’on ne peut que louer l‘image de diversité et d’ouverture promue par ce spectacle, on peut se demander à quelle réalité cela correspond, dans les faits – l’accessibilité PMR de la ville, les sdf chassés des rues avant les Jeux, le vote massif des Français en faveur du RN, lors des élections européennes, puis législatives, etc.
Mais, au fond, est-ce que les imaginaires véhiculés doivent nécessairement se repaître de ce réel que la plupart des gens cherchent à fuir ?
La position Kitsch se situe entre la mode et le conservatisme comme l’acceptation du «plus grand nombre». Le Kitsch est à ce titre essentiellement démocratique : il est l’art acceptable, ce qui ne choque pas notre esprit par une transcendance hors de la vie quotidienne par un effort qui nous dépasse — surtout s’il doit nous faire dépasser nous-mêmes. Le Kitsch est à la mesure de l’homme, quand l’art en est la démesure, le Kitsch dilue l’originalité à un degré suffisant pour la faire accepter par tous.
Abraham Moles, Psychologie du kitsch, p.24
Finalement, tout dépend du but recherché : oublier le quotidien, l’espace d’un instant furtif de liesse et de rêverie collective ou poser les bases d’un récit dans lequel construire le Vivre-ensemble.
Par ailleurs, c’est assez fou de voir défiler toutes ces vedettes avec les nations du monde entier – enfin, pas la Russie – et de se dire qu’elles sont capables de s’amuser ensemble – sportivement – tous les quatre ans, mais ne sont pas foutues de maintenir la paix et l’harmonie de cette trêve, le reste du temps. Propos un peu naïf, sans doute.
Enfin, pour en revenir à notre point de départ, le kitsch va-t-il devenir le reflet le plus fidèle de notre époque ? Un miroir aussi déformant que fascinant des aspirations et des contradictions de notre société ?
Dans L’Insoutenable Légèreté de l’être, Milan Kundera l’interprète comme une exclusion systématique de tout ce qui est inacceptable dans l’existence humaine. Il évoque une utopie esthétique où les impuretés de la vie sont voilées par un rideau de couleurs criardes et de formes surannées.
« Kitsch, c’est le déni absolu de la merde, dans les deux sens du terme : la merde comme composante essentielle de la condition humaine, et la merde dans le sens métaphorique du terme ; c’est le rejet de tout ce qui est inacceptable dans la réalité humaine. »
Milan Kundera, L’Insoutenable légèreté de l’être (1984)
On pourrait effectivement envisager ainsi ce qu’il nous a été donné de voir hier soir.
Dans Apocalittici e integrati : comunicazioni di massa e teorie della cultura di massa (1964), Umberto Eco voit, pour sa part, dans le kitsch une esthétique marquée par la « nostalgie artificielle« , une distillation sucrée de souvenirs embellis, offrant un réconfort aussi superficiel que séduisant. Son analyse met en lumière comment le kitsch manipule les émotions par des moyens esthétiques exagérés et sentimentalistes, souvent en décalage avec la réalité culturelle et historique.
Là encore, certains points font écho.
Ainsi, en embrassant ce kitsch avec tant de ferveur, la cérémonie d’ouverture des JO de Paris 2024 a sûrement rêvé se muer en symbole éclatant de l’inventivité humaine, pour impressionner le reste du monde, tout en se veuillant rassurante et procurant un certain réconfort aux Français. À la croisée du trivial et du sublime.
Cependant, je m’interroge : est-ce que la profondeur, l’authenticité et la sobriété n’auraient pas pu servir le même dessein ? Doit-on toujours en faire des tonnes – de fric – spectaculaires, pour que ça ait du sens ? Les humains veulent-ils encore vraiment « du pain et des jeux » – panem et circenses -, du divertissement, pour oublier la misère ?
Pour ma part, j’aspire de plus en plus à une réduction du bruit, pas seulement des sons mais aussi des images. Du spectacle et de la performance. Une réduction du superflu au profit de l’essentiel. Du sens au détriment des faux-semblants.
J’aime la fête, la concorde et voir les gens heureux – comme tout le monde, à priori. J’ai trouvé drôle Jamel Debouze – comme toujours – et le décalage de Philippe Katherine, en Dionysos schtroumpfement bleu, qui apparait en chantant » Nu », sous une cloche, tel un met délicieux. Souri devant Aya Nakamura qui fait se déhancher la garde républicaine, devant l’académie française, puis, devant ces amours naissant sur les couvertures des classiques de la bibliothèque. J’ai apprécié les images teintées de mystère du porteur de flamme sur les toits de Paris et de la cavalière voguant sur l’eau. Des refrains de France Gall, Daniel Balavoine, Mylène Farmer et autres artistes aussi vintage que mon enfance. J’ai aimé les têtes à demi-immergées dans la Seine de tableaux du Louvre et la sortie des eaux de ces figures féminines emblématiques. J’ai pu être touchée par les passages où des sportifs, qui avaient peuplé les couvertures de magazines de mes jeunes années, relayaient la flamme et aussi, par Marie-Josée Pérec qui pleure d’émotion. C’était tendre et vrai.
« Quand on fait de la musique, on empile des pistes, des arrangements. Des fois, on se dit que le mieux, c’est d’être nu, guitare voix. Que c’est le plus parlant. Il en va de même dans la vie. On se pare de beaucoup d’artifices pour parler à autrui. Des artifices qui souvent prêtent à confusion. Le nu est parfois bien préférable.«
Philippe Katerine, dans Le Monde, le 30 juillet 2024.
Sans avoir jamais été « choquée », j’ai vu un spectacle, avec des choses que j’aimais et d’autres moins. Et si j’ai joué le jeu du divertissement, j’aurais préféré être transportée par une oeuvre (exemple : https://www.societe-alter.com/non-classe/baro-devel-reduction-du-bruit/).
Je n’ai guère été émue par l’interprétation de Céline Dion, malgré son comme-back (in)attendu, suite à sa terrible maladie. C’était presque malaisant d’éprouver de la peine pour elle. J’y trouvais là une forme d’impudeur. Cependant, nombre de personnes ont été heureuses de retrouver l’icône.
J’ai aimé la transmission, dans cette image du plus vieux champion olympique français encore en vie – Charles Coste, né en 1924 – comme antépénultième porteur de la flamme.
« Ils rêvaient de porcelaines précieuses, à décors d’oiseaux exotiques, de livres reliés de cuir […] de tables d’acajou, de vêtements de soie et de lin, souples et confortables, pleins de couleurs, de chambres spacieuses et claires, de brassées de fleurs, de tapis de Boukhara, de dobermans bondissants […].
Mais ils étouffaient sous l’amoncellement de détails. Les images s’estompaient, se brouillaient […], comme si ces images n’avaient jamais été que des reflets très lointains, démesurément obscurcis, des scintillations allusives, illusoires, qui s’évanouissaient à peine nées, des poussières.
Georges Perec, Les Choses (1965)
Les courants et les tendances s’enchaînent, inlassablement depuis des siècles, passant de la surabondance de motifs à la sobriété minimaliste. Chacun peut – cycliquement – y trouver son bonheur ou se reconnaître un peu moins dans un mouvement. Puis, changer d’avis, aussi.
Ce qui est doux, c’est d’avoir encore le droit de trouver qu’on peut faire du beau avec du sens ; qu’il y a de la beauté dans l’humain et l’ordinaire.
Et que la poésie n’est jamais superflue.
Tout du moins, je me plais à continuer de le penser.
« Splendide Tour Eiffel à paillettes bleues […], belle Vierge Marie pleine d’eau bénite (…), élégante Vénus de Botticelli en résine et en promotion à saisir […], éclatante robe de bal en rayonne verte agrémentée de nœuds et de rubans rose fuchsia […]. Le kitsch est partout, en tout. Il décore, il orne, il enrubanne, le tout dans une bonne conscience de soi. Il ajoute du mignon, du mignard, de la fanfreluche, comme si la vie était plus légère à porter avec cette parure insistante […]. Il diffuse son mauvais goût apparent dans tous les aspects de notre existence par son sentimentalisme facile et son imagerie stéréotypée. De la pacotille comme art de vivre. Il ravale tout effort de sincérité au rang de camelote vite échangée. Le kitsch commence par un coup d’éclat mais finit comme un dégonflement. »
Christophe Genin, Kitsch dans l’âme (2010), p. 9.
Bien sûr, les metteurs en scène de cette cérémonie ne représentent ni le Président de la République, ni le gouvernement. Bien sûr, leur objectif était de faire au mieux, de réparer, de réconcilier, de réunir, dans l’espoir d’offrir de la joie, de la fierté et de la concorde, afin d’honorer l’esprit des Jeux.
Pour autant, cela n’interdit pas d’analyser ce spectacle dans son contexte et donc, à l’aune de la politique menée par le gouvernement en place et des ses conséquences concrètes, dans le quotidien des Français.e.s. Puis, toute expression artistique n’est-elle pas un miroir de la société, témoignant également des fractures d’une époque ? L’art, par nature, n’est-il pas cet espace de liberté propice au questionnement ?
Si d’aucuns sont libres de penser qu’il faut dépolitiser le débat et ne pas confondre art et politique, c’est une posture qui peut s’entendre. Ce n’est pas, pour autant, appartenir aux « rageux », aux « fâcheux » ou au RN que de proposer un point de vue différent de celui des critiques dithyrambiques : cela permet d’interroger le tableau depuis un autre angle et, peut-être, d’y introduire une nuance, sans pour autant retirer son potentiel de joie à l’événement.
Il y a une forme d’ « ayattolisme » chez les gendarmes de la mono-pensée idoine, dans cette injonction à se réjouir de cette cérémonie à tout prix – 122 millions d’euros – même si l’on est, évidemment, heureux que ça fasse enrager l’extrême-droite.
Il me semblera toujours légitime de pouvoir exprimer une pensée différente, tant que cela se fait dans le respect des règles édictées par la loi sur la liberté d’expression. Il serait, à mon sens, bon de pouvoir encore se réjouir de ce signe de bonne santé démocratique.
« Je ne suis pas d’accord avec ce que vous dites mais je me battrai jusqu’à la mort pour que vous puissiez le dire »
Ce que j’aime par-dessus tout, c’est d’être encore libre d’aimer quelque chose, un peu, beaucoup, passionnément, à la folie ou pas du tout. Sans que l’on me dicte ce que je devrais penser pour être politiquement correcte ou ne pas être rabat-joie.
- Pour la playlist, je me suis demandé si c’était celle de la première dame. ↩︎