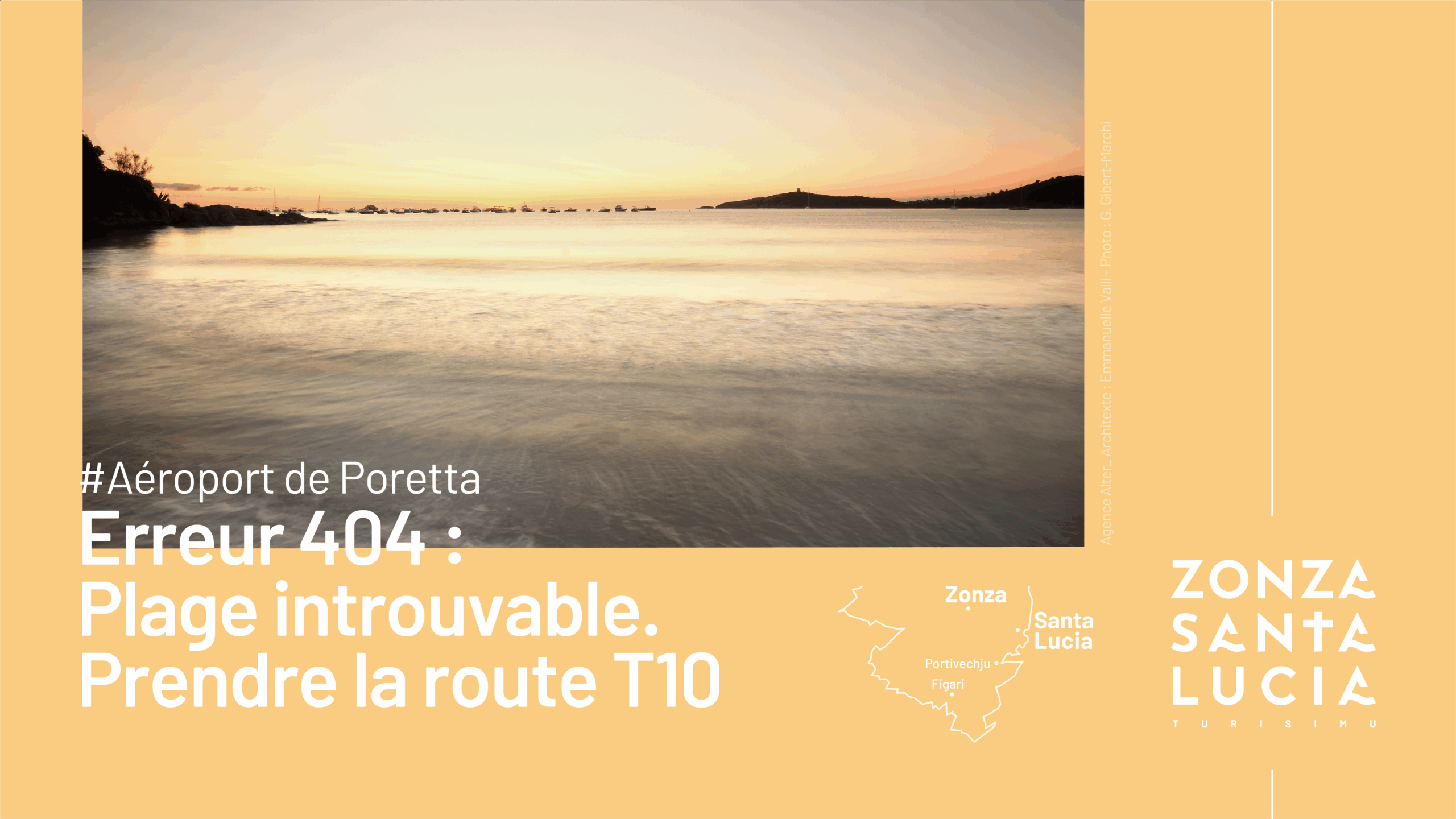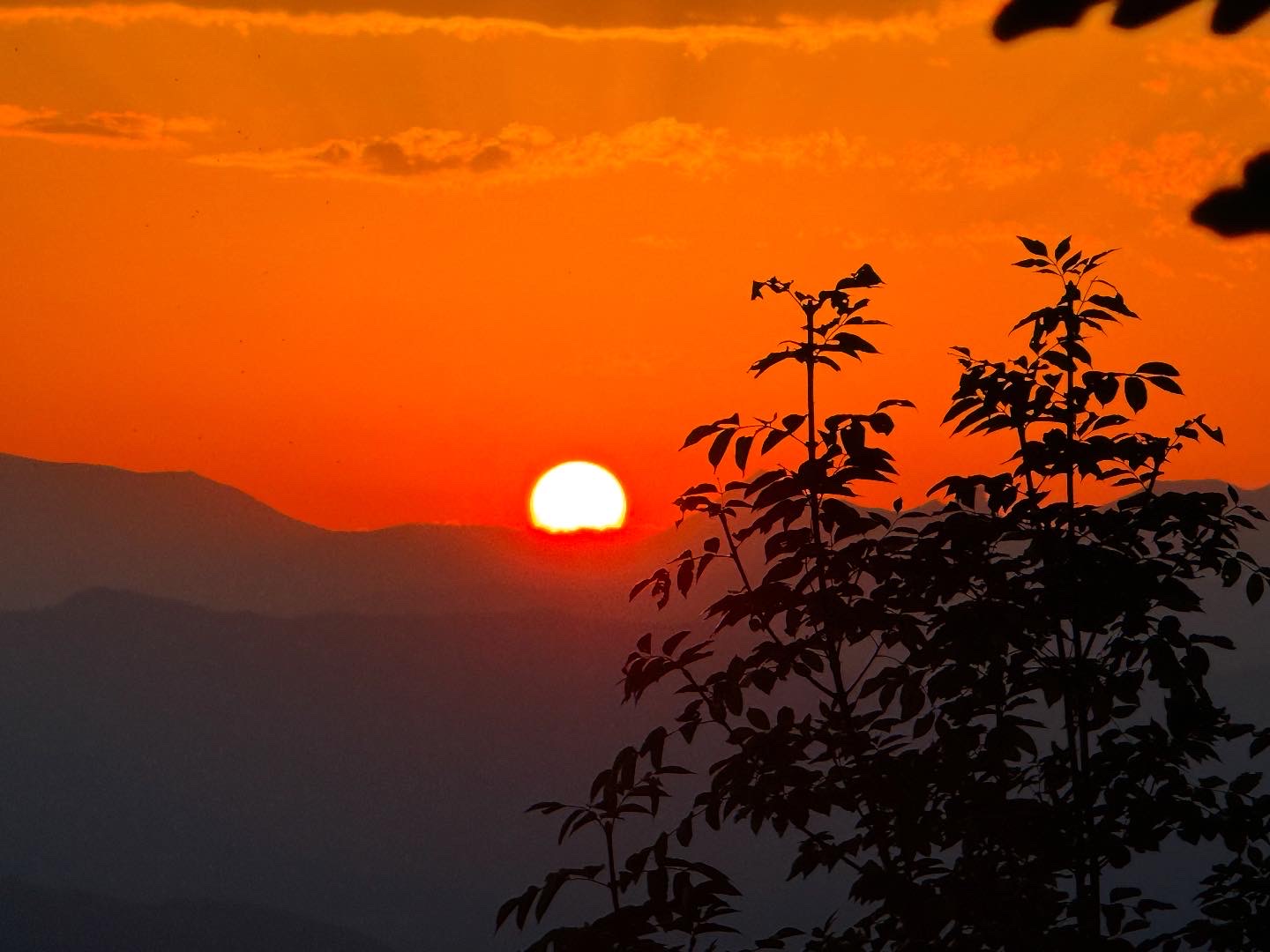Quand un nom imaginaire – ô combien transparent – donne naissance à une île grecque non moins fictive, mais surtout un prétexte à des questions sur le surtourisme et l’altérité, à travers un parallèle avec le nouveau roman de Jérôme Ferrari.
« Psimythos ne prétend pas tant induire les vacanciers en erreur qu’à agir comme un gigantesque défouloir. Entre caricature de l’été grec, tant vanté avec ses 33 millions de visiteurs étrangers l’an passé, dont 1,8 million de Français, et frustration de la population locale qui, faute de moyens doit restreindre ses vacances. Ou s’indigner en déclenchant, comme l’an passé, le « mouvement des serviettes » pour protester contre la privatisation sournoise des plages envahies par les chaises longues payantes. »
Source : « Mauvaise blague – Surtourisme en Grèce : ‘Psimythos’, une fausse île qui fait rire jaune les Grecs », Libération, 3 septembre 2024.
« Psimythos » ou la puissance évocatrice des mots. L’étymologie même de « Psimythos » aurait pu alerter sur la farce qui vantait ironiquement ce nouveau fief pour le surtourisme, pour dénoncer les réalités complexes de la Grèce contemporaine : une économie fragile, des inégalités accrues par le tourisme de masse, la privatisation des espaces publics et les difficultés croissantes pour la population locale.
En effet, psímuthos (ψίμυθος) désigne la céruse, un pigment blanc à base de plomb utilisé dans l’Antiquité, notamment pour le maquillage et pour masquer les imperfections de la peau. Ce pigment était apprécié pour sa capacité à donner un teint pâle et uniforme, mais était également très toxique en raison de sa composition à base de plomb. Par ailleurs, mythos (μῦθος) qui signifie « récit » ou « fable », semble renforcer l’idée d’afficher le côté fictif de l’objet dans le nom.
En outre, cette histoire airbnbienne n’est pas sans rappeler la thématique du nouveau roman de Jérôme Ferrari – Nord Sentinelle, paru le 24 août, chez Actes Sud.

Pour une banale histoire de bouteille introduite illicitement dans son restaurant, le jeune Alexandre Romani poignarde Alban Genevey au milieu d’une foule de touristes massés sur un port corse. Alban, étudiant dont les parents possèdent une résidence secondaire sur l’île, connaît son agresseur depuis l’enfance.
Dès lors, le narrateur, intimement lié aux Romani, remonte – comme on remonterait un fleuve et ses affluents – la ligne de vie des protagonistes et dessine les contours d’une dynastie de la bêtise et de la médiocrité.
Sur un fil tragicomique, dans une langue vibrante aux accents corrosifs, Jérôme Ferrari sonde la violence, saisit la douloureuse déception de n’être que soi-même et inaugure, avec la thématique du tourisme intensif, une réflexion nourrie sur l’altérité. Sur ce qui, dès le premier pas posé sur le rivage, corrompt la terre et le cœur des hommes. Source : éditions Actes Sud.
Dans une écriture poétique au scalpel, parée de violence – pour mieux la décrire -, toujours sublimée par des mots justes – parfois tendres et drôles – à la lucidité cathartique, l’auteur y explore les méandres entre les promesses déchues du capitalisme et la quête d’une vérité intérieure, à travers les errances d’un narrateur impuissant face à la destruction de son monde.
Dans tout son désabusement, semble demeurer toutefois une empathie d’appartenance pour ces autochtones ordinaires qui, inféodés au tourisme, ont fini par ressembler à ceux qu’ils honnissent et dont ils se sont rendus aussi dépendants que complices.
Oscillants sans fin entre la frénésie de la haute saison corse et le silence mortifère d’un paradis que des cohortes consuméristes ont laissé exsangue. Jusqu’à l’été suivant.
Au-delà de la fresque sur la faune touristique, la médiocrité humaine ou du constat de n’être que soi – ni plus ni moins qu’un autre – le roman et l’article sur la farce de Psimythos ouvrent un questionnement sur l’altérité.
C’est également ce qu’interroge Juliette Morice, à travers les réflexions et récits consacrés aux voyages, de l’Antiquité à nos jours, dans son ouvrage Renoncer aux voyages. Une enquête philosophique (mai 2024). Elle y éclaire cette tension entre l’authenticité et l’illusion du voyage, interrogeant sa valeur cognitive et morale et questionne la distinction entre voyageur et touriste, ainsi que les multiples facettes paradoxales de la notion de voyage, dont la définition même est une ébauche de réponse sur la labilité de l’objet.

Peut-on continuer à voyager comme avant ? Est-ce la fin des voyages ? Ces questions n’ont rien d’inédit. La philosophie, avant même l’apparition de l’avion et d’Internet, les a posées depuis longtemps. Car les voyages ont toujours eu un caractère ambigu et polémique.
À contre-courant des idées reçues, ce livre propose de penser le voyage, depuis ses tout débuts jusqu’à l’ère du tourisme de masse. Ce que l’on découvre alors, à travers les contradictions d’une telle pratique, ce sont les nôtres propres, révélatrices de notre difficulté à habiter le monde.
Source : PUF.
Un voyage est-il affaire de distance parcourue ? De durée du déplacement ? Qu’est-ce qu’un « vrai » voyage ? Un voyage « réussi » ? Celui où surgit l’imprévu, ou celui où « rien ne se passe » ?
Dans l’extrait suivant, Claude Lévi-Strauss restituait l’immense complexité du sujet des déplacements et ça n’a pas pris une ride.
« [Éribon :] les cultures veulent s’opposer les unes aux autres.
Claude Lévi-Strauss : À la fin de Race et histoire, je soulignais un paradoxe. C’est la différence des cultures qui rend leur rencontre féconde. Or ce jeu en commun entraîne leur uniformisation progressive […]
Que conclure de tout cela, sinon qu’il est souhaitable que les cultures se maintiennent diverses, ou qu’elles se renouvellent dans la diversité ? Seulement (…) il faut consentir à en payer le prix : à savoir, que des cultures attachées chacune à un style de vie, à un système de valeurs, veillent sur leurs particularismes ; et que cette disposition est saine, nullement – comme on voudrait nous le faire croire – pathologique. Chaque culture se développe grâce à ses échanges avec d’autres cultures. Mais il faut que chacune y mette une certaine résistance, sinon, très vite, elle n’aurait plus rien qui lui appartienne en propre à échanger. L’absence et l’excès de communication ont l’un et l’autre leur danger. »
Didier ÉRIBON, Claude LÉVI-STRAUSS, De près et de loin (1988)
Par ailleurs, dans une récente tribune parue dans Le Monde, intitulée « La notion de surtourisme relève du mépris de classe », Jean Pinard critique l’utilisation du terme « surtourisme », qu’il considère comme une forme de mépris de classe. Selon lui, cette notion stigmatise les vacanciers – « horde », « troupeaux », « nuée de criquets » – des classes populaires qui n’ont pas les moyens de choisir des destinations plus éloignées ou hors périodes de vacances scolaires. Il dénonce l’hypocrisie de ceux qui pointent du doigt les vacanciers locaux, tout en glorifiant ceux qui voyagent à l’autre bout du monde et met en lumière l’irresponsabilité politique face à l’offre touristique et aux vols low-cost. Un point de vue intéressant qui pose de bonnes questions, sans doute quelque peu parti pris, étant donné que l’auteur est le président de Futourism, un cabinet de conseil en développement touristique.