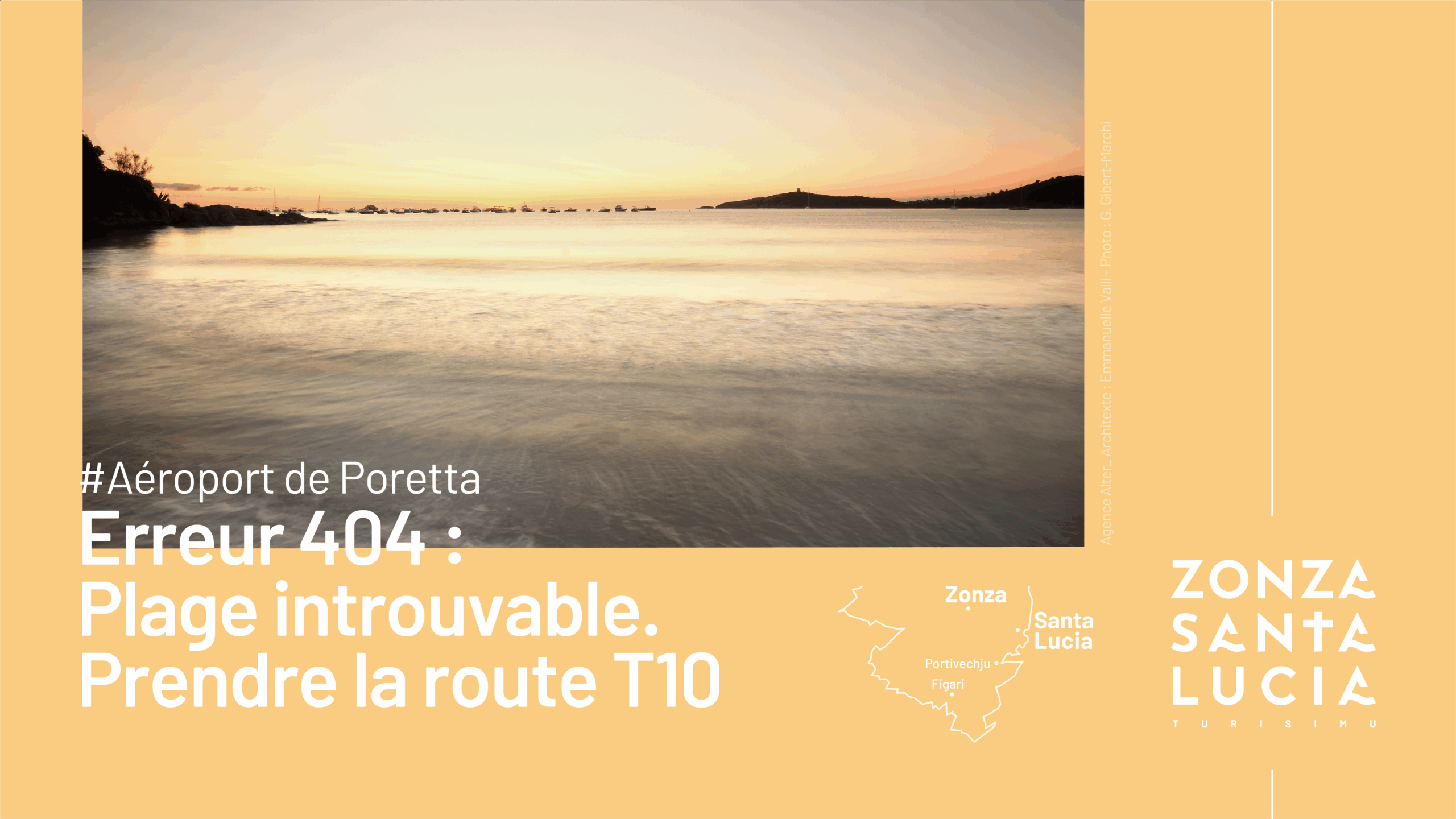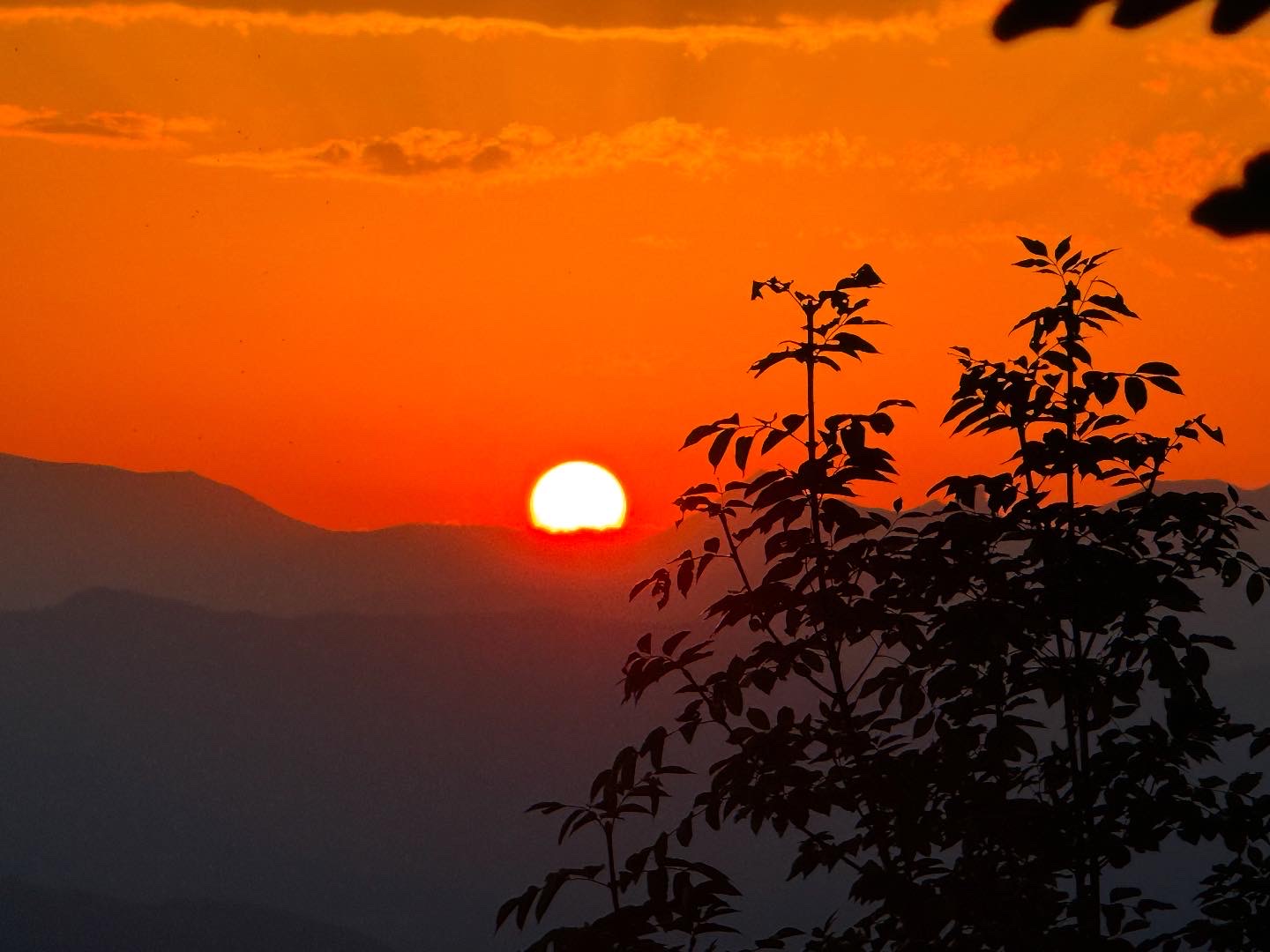Les fêtes de fin d’année offrent désormais l’occasion – et l’obligation implicite, au risque d’être taxé d’asocial ou aigri – de participer à un rituel très plébiscité : le Secret Santa. Importé d’outre-Atlantique, il consiste à offrir anonymement un cadeau à une personne désignée au hasard dans un groupe.
Si cette tradition consumériste issue du marketing semble légère, ludique et fédératrice, il est sans doute intéressant de tenter de l’éclairer à la lumière des théories de Marcel Mauss et de Maurice Godelier, sur le don.
Dans son Essai sur le don (1925), Marcel Mauss explore les systèmes de dons dans les sociétés traditionnelles. Selon lui, le don n’est jamais gratuit et obéit à une logique tripartite : donner, recevoir, rendre. Le don serait donc un acte social total, engageant la personne dans son intégralité.

Qu’est-ce qui pousse les individus, mais aussi les groupes, à faire des dons ? Pourquoi un présent reçu appelle-t-il une faveur en retour ? Quelle force y a-t-il dans la chose que l’on donne ? D’où vient la gêne que nous éprouvons parfois lorsque nous recevons un cadeau ?
Marcel Mauss répond à ces questions en analysant les différentes formes du don et de l’échange, des phénomènes certes économiques mais aussi politiques et religieux qui régissent nos relations en mettant en œuvre une triple obligation : donner, recevoir, rendre. Le père de l’anthropologie moderne montre surtout comment le don lie les individus entre eux, fonde l’alliance, construit la paix.
Par cet essai fondateur, Marcel Mauss livre l’un des plus célèbres textes de la littérature anthropologique, qualifié par Claude Lévi-Strauss de « révolutionnaire ».
Source : Éditions Flammarion.
D’aucuns diront que le don aux associations caritatives est purement gratuit et n’entre pas dans cette logique de donner, recevoir et rendre, cependant, se pourrait-il que ce soit justement une manière de manifester sa gratitude ou sa reconnaissance et de rendre un peu ce que l’on a « reçu » – même si cela n’est pas tombé du ciel ?
Par ailleurs, le don et le contre don étant au fondement de la construction du lien social, cela n’implique t-il pas que les cadeaux soient personnellement adressés et qu’ils aient été choisis à dessein, avec soin, démontrant la connaissance intime de leur destinataire par celui qui les offre, avec toute la responsabilité que cela implique – dont celle de se planter ?
Aussi, même si Secret Santa reste encadré par des normes explicites – notamment le petit budget pour les cadeaux qui leur confère d’autant plus leur dimension symbolique – le tirage au sort et l’anonymisation des destinataires auxquels les cadeaux sont destinés, ne dénature-t-il pas le don comme acte social total qui nécessite un engagement dans le geste d’offrir ?
Dans L’Énigme du don (1996), Maurice Godelier prolonge et nuance l’analyse de Mauss sur le don en avançant que l’échange ne concernerait pas seulement des biens matériels, mais également des éléments symboliques essentiels à la cohésion sociale.

Pourquoi doit-on donner, pourquoi doit-on accepter ce que l’on vous donne, et, quand on a accepté, pourquoi faut-il rendre ?
Cet ouvrage évalue le rôle et l’importance du don dans le fonctionnement des sociétés et dans la constitution du lien social.
Le terrain, bien entendu, n’était pas vierge : Marcel Mauss, le premier, l’avait défriché allant jusqu’à avancer l’idée que si les choses données sont rendues c’est qu’il y a dans la chose donnée un esprit qui la pousse à revenir entre les mains de son donateur originaire. L’hypothèse valut à Mauss la critique sévère de Claude Lévi-Strauss, qui lui reprocha d’avoir pris une théorie indigène pour une théorie scientifique et d’avoir manqué de reconnaître pleinement le fait que la société humaine entière est échange et que pour en comprendre le sens il faut partir du symbolique et de sa primauté sur l’imaginaire et le réel.
La perspective générale adoptée par Maurice Godelier renouvelle profondément notre compréhension du don. Il analyse en effet les choses qu’on donne ou celles qu’on vend à partir des choses qu’on ne donne pas ou ne vend pas, des choses qu’on garde et que l’on doit garder, au premier rang desquelles les objets sacrés. Réanalysant les pratiques du potlatch et du kula sur lesquelles Mauss s’était appuyé, il montre que les énigmes auxquelles Mauss a été confronté se dissipent lorsque l’on comprend qu’il est tout à la fois possible de donner un objet et de le garder. Ce qui est donné, c’est le droit d’en user pour d’autres dons, ce qui est gardé c’est la propriété, inaliénable. Mais il faut encore expliquer pourquoi cette règle de droit s’applique aux objets précieux qu’on donne et non aux objets sacrés qu’on garde. La chose s’éclaire lorsqu’on fait apparaître ce qui est enfoui dans l’objet, l’imaginaire associé au pouvoir.
Il apparaît donc que toute société renferme deux ensembles de réalités : les unes, soustraites à l’échange, aux dons, au marché, constituent autant de point fixes nécessaires pour que les autres circulent. Et c’est précisément la redéfinition des ancrages fondamentaux du fait social qui constitue la tâche majeure de la pensée politique aujourd’hui.
Source : Éditions Fayard.
En effet, les cadeaux possèdent souvent une valeur symbolique forte, bien supérieure à leur prix : un cadeau soigneusement choisi, évoquant un souvenir partagé ou une complicité, échappe à la logique d’échange strictement économique et devient un objet porteur de sens autant que de lien – sans parler de la symbolique des bracelets ou des colliers ! Dans le fait d’offrir un présent, où l’on se rend « présent » à l’autre à travers la permanence de l’objet, des éléments aussi immatériels que l’attention et l’intention sont donc essentiels.
Dans le cadre professionnel, le Secret Santa revêt une dimension toute particulière où l’échange de cadeaux au bureau constitue une forme de rituel censé fédérer en neutralisant les tensions hiérarchiques et en favorisant la convivialité.

Secret Santa, ou Noël canadien au Québec, ou Père Noël Secret dans les pays francophones, est une tradition de Noël, surtout dans les pays anglo-saxons, lors de laquelle les membres d’un groupe ou d’une communauté s’offrent au hasard des cadeaux.
Le tirage au sort est anonyme (il peut y avoir des variantes, mais souvent le nom de l’offrant est révélé seulement le jour de l’échange des cadeaux).
Cette tradition est souvent pratiquée sur les lieux de travail, dans les familles nombreuses ou entre amis et dans les classes dans les écoles. Sa participation est généralement volontaire. Elle offre un moyen pour beaucoup d’offrir et de recevoir un cadeau à un coût modéré (au lieu de multiplier les cadeaux, on reçoit un cadeau et on en fait un). Le secret du tirage encourage également, pour les groupes dont les membres ne sont pas assez proches, à faire participer les gens, et à rendre ainsi plus facile l’organisation et l’échange de cadeaux.
Source : Wikipédia.
Les règles implicites de ce Secret Santa professionnel imposent de trouver un équilibre délicat : le cadeau doit être neutre, approprié à la circonstance, ni trop personnel ni trop impersonnel.
En outre, s’il est parfois perçu comme une obligation sociale embarrassante qui fait apparaître ses réfractaires comme des personnes asociales ou aigries, il maintient cependant intacte toute l’ambiguïté du don : un acte libre en apparence, mais bel et bien soumis à de nombreuses attentes de part et d’autre.
À travers le Secret Santa, c’est toute une réflexion sur la nature du lien social et de l’échange qui se rejoue chaque année, mais qu’est-ce que ce nouveau mode de fabrication de lien social fondé sur une caricature du don dit vraiment de nous ? La convivialité pourra-t-elle émaner d’une obligation sociale ?
Et puis, doit-on vraiment vraiment ramener tout ça au travail ? Doit-on forcément partager ces moments hors-contrat de travail qui ne sont pas toujours souhaités pour tout le monde ? Quel est le bénéfice de supprimer les rapports hiérarchiques et d’abolir les limites le temps d’un Carnaval ou d’un Secret Santa ? Les rapports cordiaux et respectueux ne sont-ils pas ce qui maintient la paix sociale au travail en tenant les affects à bonne distance ?
Est-ce que la magie de Noël est forcément un « tour de magie » ? Plutôt que de feindre l’harmonie du lien social au travail là où coexistent les rapports de subordination et, parfois aussi, les absences d’affinités légitimes, ne pourrait-on pas simplement admettre que certains rituels pourraient se cantonner à la sphère de l’intime, à défaut de les faire disparaître ? Ne devrait-on pas tenter de comprendre où est notre place, selon le contexte et cliver davantage la sphère de l’intime ?

Alter_nativement attachée à la spontanéité et à la maladresse dans le geste d’offrir – quitte à être non politiquement corporate – je vous souhaite de vous creuser la tête pour trouver des cadeaux qui n’ont pas de prix – sens littéral : qui ne s’achètent pas – pour ceux et celles que vous chérissez.
Pour les autres, il reste la politesse et le respect et éventuellement les chocolats.